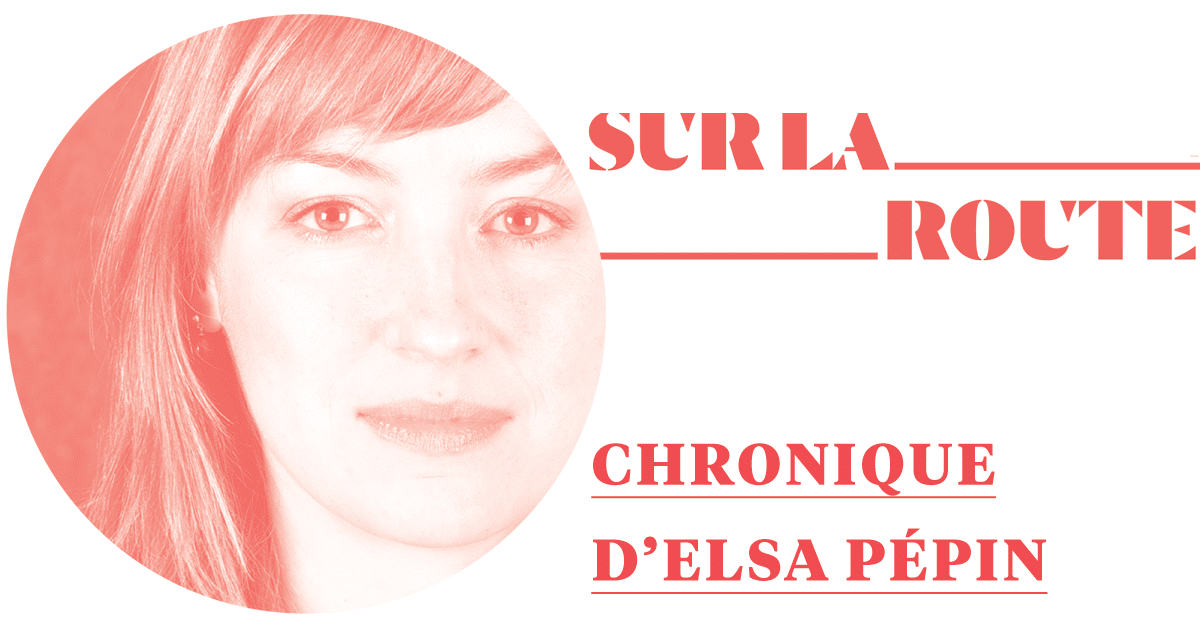La scène d’ouverture dit tout, et si bien. Une femme gît dans la steppe du Kamtchatka (Extrême-Orient russe), ensanglantée, après avoir été attaquée par un ours. Perdue dans le temps du mythe, elle parle d’une naissance, « puisque ce n’est manifestement pas une mort ». Nastassja Martin raconte dans Croire aux fauves les minutes qui ont suivi l’attaque d’un ours le 25 août 2015, ce basculement soudain vers un autre monde, un autre que soi, le fauve qui par sa morsure a déposé quelque chose en elle. Le défi sera désormais d’« arriver à survivre malgré ce qui a été perdu dans le corps de l’autre; arriver à vivre avec ce qui y a été déposé ».
Après avoir frôlé la mort, l’anthropologue française raconte le récit de sa survie, ou comment elle a dû apprendre à vivre avec le savoir d’un autre monde en elle. D’abord hospitalisée dans un hôpital russe où elle erre entre la vie et la mort, Martin est transférée à la Salpêtrière. Or, ce qui aurait dû être un soulagement se révèle l’apogée de sa descente aux enfers. Dans ce lieu aseptisé, elle se sent observée comme une bête sauvage et tout l’éloigne du sens que cet événement porte en lui. Elle doit notamment expliquer à la psychologue qui lui demande comment elle se sent, sans visage, alors que ce dernier désigne notre identité, qu’elle collecte justement depuis des années des récits sur les « présences multiples qui peuvent habiter un même corps pour subvertir ce concept d’identité univoque, uniforme et unidimensionnelle ». Exaspérée par les soins interminables qu’on lui prodigue, l’autrice décide de retourner sur le lieu de l’attaque, exactement « là d’où vient la menace », et de s’isoler pour guérir. Une sorte de pèlerinage où elle découvre qu’il existe un nom en russe, miedka, qui désigne ceux qui vivent entre deux mondes, les personnes « marquées par l’ours », qui ont survécu à sa rencontre. Ce terme renvoie à l’idée que la personne qui porte ce nom est désormais moitié humaine, moitié ours. Ainsi, Martin troque son statut de victime pour celui d’une survivante qui s’est mêlée à la bête. Une femme avec un savoir ajouté. Une guerrière.
L’autrice a tiré de cet événement extraordinaire un livre fascinant et subversif, où elle découvre qu’après avoir étudié pendant des années la zone frontière, « cet endroit spécial où il est possible de rencontrer une puissance autre, où l’on prend le risque de s’altérer, d’où il est difficile de revenir », elle vit cet interstice dans son propre corps, « devenu un territoire où des chirurgiennes occidentales dialoguent avec des ours sibériens ». Son retour de l’autre monde rejoint celui de Perséphone. « Six mois en haut, six mois en bas, pratique. » Mais que se passe-t-il si « hors du temps du mythe, le cycle se brise »? « Il faudrait que les deux visages du masque animiste cessent de s’entre-tuer, qu’ils créent la vie, qu’ils créent autre chose qu’eux-mêmes », suggère l’autrice.
Le récit alterne entre une écriture savante et une écriture pulsionnelle, hachurée et intime. En résulte une réflexion riche et lucide sur notre rapport à la mort, la violence, les forces de la nature qui nous dépassent, mais ne sont pas extérieures à nous, preuve qu’il en est de cet accident où la bête a traversé le monde humain. Le livre pose aussi la question du voyeurisme, du regard porté sur une femme de 29 ans, momentanément défigurée. « Les humains ont cette curieuse manie de s’accrocher à la souffrance des autres telles des huîtres à leurs rochers », écrit-elle, ne pouvant s’expliquer la foule voulant à tout prix la voir alors qu’elle est hospitalisée, en train de se faire refaire un visage.
Passée à la frontière de l’humanité, miraculeusement vivante après avoir été la proie d’un ours, Martin devient une sorte de mythe vivant de la métamorphose. Une vivante revenue de l’Enfer, une femme qui a survécu aux forces sauvages et voraces d’un prédateur mortel. Son histoire se révèle bien plus qu’une histoire de perte. Elle replace l’humanité au milieu des vivants et des morts et montre que nous ne dominons pas la nature autant qu’elle nous domine.
Le basculement
Dans Love Me Tender, la vie d’une mère bascule au surgissement d’une simple séparation. La narratrice du récit de Constance Debré raconte sa survie alors qu’elle perd la garde de son fils, et pose la question délicate à savoir si l’amour entre une mère et son fils peut être comme tous les autres : périssable. Sujet tabou s’il en est un, le refus de l’amour maternel est revendiqué ici comme un droit légitime, bien qu’absolument anticonforme à la morale et aux attentes de notre société. Après s’être séparée et avoir annoncé son homosexualité au père de son fils, la narratrice doit affronter l’incapacité de ce dernier à accepter cette nouvelle situation, mais plus encore, son plan pour lui faire perdre la garde du fils sous prétexte que sa vie manifeste son instabilité psychique. Prise au piège d’une justice lui donnant tort, la mère livre un récit de révolte fragile et violent à la fois contre cet ordre social rigide qui lui enlève son enfant. Mais Love Me Tender est surtout le récit d’un renoncement. Renoncement à la maternité traditionnelle, à la carrière (elle plaque tout pour écrire), aux biens matériels. Ne reste plus que la nage, la baise, l’écriture.
Malgré une fâcheuse tendance à utiliser l’anglais à tout vent, une langue fortement marquée par une volonté de provoquer, le roman ose aborder la délicate question de la liberté d’une mère forcée de se détacher de son enfant. Un vrai manifeste à contre-courant des modèles encore prégnants de famille nucléaire et d’amour maternel, qui révèle le chemin à parcourir avant d’atteindre une société tolérante. Un livre coup-de-poing lancé par une guerrière qui livre un combat dans le silence et l’effacement.