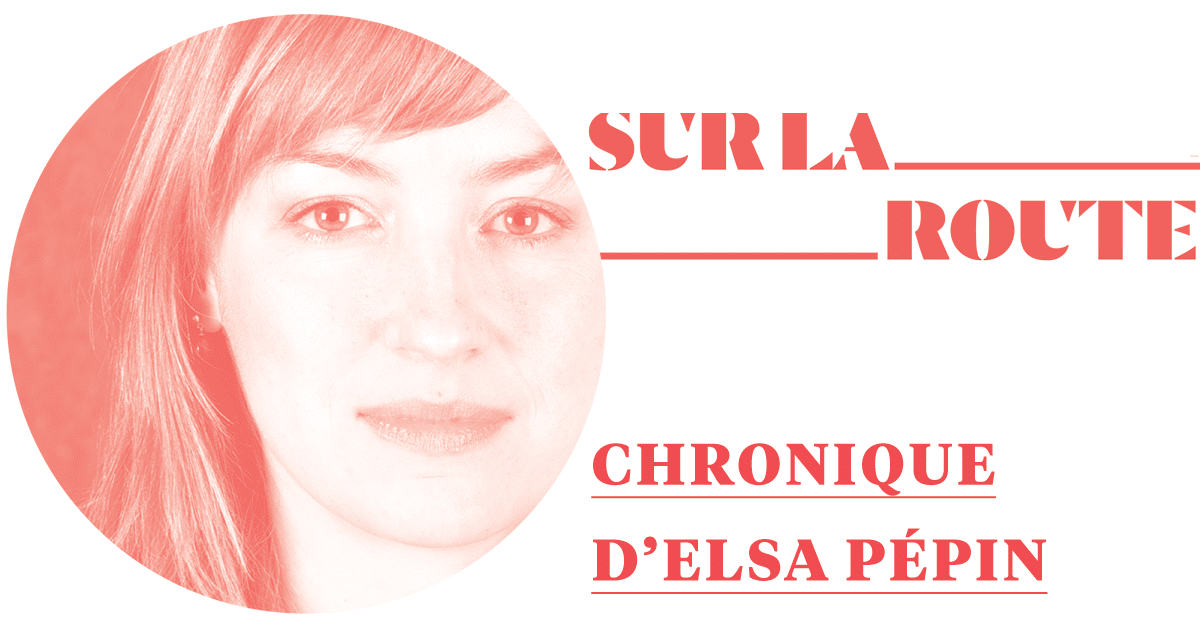Sous la forme d’une lettre adressée à sa mère, un jeune homme essaie de se rapprocher d’elle, de rapatrier des éléments en désordre pour recomposer sa vie conçue à même un des pires bourbiers de l’histoire. Il lui écrit pour la libérer du silence dans lequel l’a plongée son exil en sol américain, cette terre étrangère dont elle ne parlera jamais la langue. Née de l’union d’une Vietnamienne immigrée aux États-Unis et d’un militaire américain blanc en poste sur un destroyer de la marine durant la guerre du Vietnam, la mère élève son fils avec sa mère. Surnommé Little Dog, celui-ci masse le dos endolori de sa mère après ses journées de travail au salon de manucure, écoute les récits répétés en boucle de la grand-mère qui, entre deux raids aériens, a tenu sa fille hurlant dans ses bras face à un soldat pointant sur elle un AK-47. Et quand Little Dog se fait écraser la tête par un garçon de l’école, désemparée, la mère le bat à son tour et l’implore de trouver un moyen de se défendre : « Il le faut parce que je n’ai pas l’anglais pour t’aider […] Trouve un moyen ou bien ne me parle plus jamais de ça, compris? »
Un bref instant de splendeur porte sur la lourde filiation de la guerre. En restituant l’histoire d’amour-haine avec cette mère pour laquelle il jouera le rôle d’interprète officiel, possédant les rudiments d’anglais nécessaires pour communiquer avec l’extérieur, le fils chemine vers cette femme qui a perdu son lien au monde, enfermée dans la schizophrénie. À la fois poème, mémoires et prise de parole depuis sa position de « queer jaune », comme il se décrit, le récit se présente comme une tentative de déchiffrement à partir d’une langue maternelle atrophiée : « Que se passe-t-il quand cette langue est non seulement le symbole d’un vide, mais un vide elle-même? » Le vietnamien du narrateur est celui que sa mère lui a transmis. À l’âge de 5 ans, elle a vu son école s’écrouler après une attaque américaine au napalm. Elle n’a plus jamais remis les pieds dans une salle de classe. « Notre langue maternelle n’a donc rien d’une mère : c’est une orpheline. »
Le récit est aussi l’aveu du fils à sa mère de son homosexualité, découverte à l’adolescence dans une relation torride et tragique avec Trevor, un jeune garçon rencontré sur une plantation de tabac dans le Hartford, au Connecticut. Un garçon qui deviendra toxico à 14 ans, alors qu’on lui prescrit à la suite d’une fracture de l’OxyContin, un opioïde dont il deviendra dépendant et qui l’emportera par surdose à l’âge de 22 ans. À travers la découverte du désir — ce plaisir d’être vu, enfin, lui qui avait rarement été vu par qui que ce soit et à qui on avait appris à se rendre invisible pour être en sécurité —, Little Dog détaille la chute de Trevor, une autre victime de l’impérialisme américain qui se joue cette fois-ci entre les pharmaceutiques et la population intoxiquée malgré elle — 500 000 Américains seraient morts de surdoses d’OxyContin depuis 2000.
Entre la figure de Tiger Woods aux origines métisses, comme lui, modèle de la réussite du rêve américain, celle de ses aïeules et de son jeune amant sacrifié, Vuong brosse un portrait acerbe et critique des États-Unis, révélant ses laideurs cachées comme ce coin pourri où les jeunes tombent comme des mouches sous l’effet d’une drogue meurtrière. C’est une histoire de corps et d’identités disloqués par la guerre, la drogue, la violence. Corps invisibles qui cherchent à exister, corps désirés jusqu’à l’apparition ou l’effacement de soi, intoxiqués, survivants, monstrueux. Le récit cherche à préserver ces corps, à leur rendre hommage : « Parfois, on vous efface avant de vous avoir laissé le choix d’affirmer qui vous êtes. »
Little Dog s’ouvre d’ailleurs comme une « plaie béante », laissant voir ses entrailles, interrogeant avec grâce et horreur la danse mystérieuse entre la destruction et la création qui gouvernent sa vie; il observe à quel point le savoir — il lit Barthes, Weil, Joan Didion — ne réussit pas à panser la blessure, à dire qui il est : « Certains jours je me sens comme un être humain, d’autres davantage comme un son. Je touche le monde mais ce n’est pas moi, c’est un écho de celui que j’étais. »
Le texte d’un érotisme parfois très cru est scandé par une poésie charnelle d’une vibrante efficacité et se laisse décanter lentement. Si le récit est décousu, les images sont d’une clarté inouïe. Des monarques s’envolent vers le Sud, sachant qu’ils ne verront jamais plus le Nord ; seuls leurs enfants, sortis des œufs que ces papillons migrateurs pondent en route, y remonteront : « Seuls leurs enfants reviennent : seul l’avenir revisite le passé », écrit-il, de la même manière qu’il est le seul à remonter le cours de son histoire. « Un survivant, c’est peut-être le dernier qui rentre chez lui, l’ultime monarque qui se pose sur une branche déjà lourde de fantômes. »
Douce revanche
En mettant en scène sa mère et sa grand-mère dans un livre écrit dans la langue qui les a exclues, Vuong prend une douce revanche contre l’invisibilité de leur souffrance. Il y a cet épisode où, faisant une blague à sa mère en se cachant derrière une porte, muni d’un casque de soldat, le fils fait éclater sa mère en sanglots. Il découvre que la guerre est toujours en elle. De là, Little Dog entame une quête généalogique à partir de sa famille venue de l’épicentre de la guerre. C’est au fil des récits de ses aïeules qu’il connaîtra sa délivrance. Sa grand-mère Lan, qui est née sans prénom, désignée par le chiffre « Sept » pour le septième enfant, s’est offert un nouveau prénom signifiant « orchidée », revendiquant sa beauté par ce baptême, faisant de cette beauté une chose qui vaille la peine d’être conservée : « De là, une fille est née, et de cette fille, un fils. Depuis tout ce temps je me disais que nous étions nés de la guerre — mais je me trompais, Maman. Nous sommes nés de la beauté. »
Aussi brutale que douce, cette lettre ponctuée de « Maman » est faite de ponts tendus vers une origine trouée, d’humiliations, de tentatives d’enracinement dans le noir et le vide — de chair brûlée et cajolée, aussi, car Little Dog et sa mère accompagneront la grand-mère dans sa mort en un rituel d’une émouvante tendresse. Vuong se fait le chef d’un orchestre à la fois magistral et intime. D’une matérialité brute (réalisme des scènes de baise et de la violence de la banlieue américaine), le récit touche aussi au sacré dans sa peinture grandiose de ce qui lie l’humain à la vie, à la mort, au désir. Un cri politique en hommage aux vies anonymes brisées et perdues d’une haute intensité.