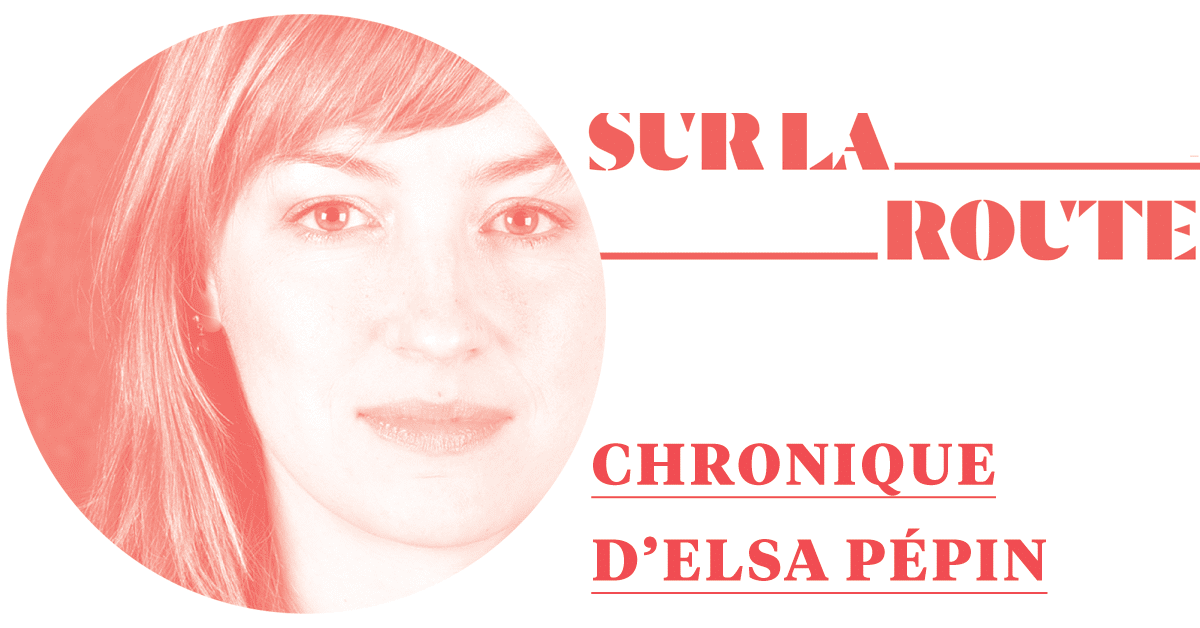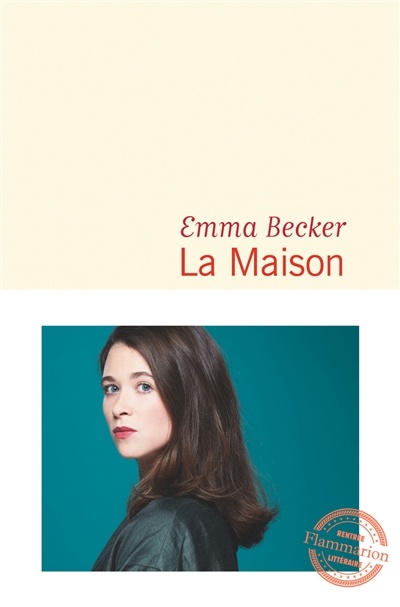Elles ont mauvaise figure. Elles sont la fange ou le visage qu’on ne veut pas voir. Elles sont pourtant réelles, miroir grossissant de notre humanité.
Soufflant. C’est le mot qui reste à la lecture du roman d’Emma Becker, immersion hypnotique et saisissante dans une maison close de Berlin. « Écrire sur les putes, c’est une nécessité », affirme la narratrice de La Maison. « Si je ne parle pas de ces femmes, personne ne le fera. Personne n’ira voir quelles femmes se cachent derrière les putes. Et il faut qu’on les écoute. » Pour avoir un accès privilégié auprès d’elles, l’écrivaine française a travaillé deux ans dans un bordel berlinois, poussant le roman expérimental jusqu’à l’extrême, offrant son corps à ce métier épuisant, certes, et parfois un vrai supplice dégradant, mais qui l’a aussi rendue heureuse.
Le livre ne fait pas l’apologie de la prostitution, mais plutôt celle d’un bordel de Berlin où elle a trouvé qu’on y traitait bien les femmes, même si le lieu est décrit comme un « encéphalogramme plat du désir de bêtes pour d’autres bêtes ». Faisant renaître ce lieu disparu, Becker offre une vibrante méditation sur l’identité féminine, les fantasmes sexuels, l’illégalité, la perversion, étudiant la figure de la pute non pas d’un œil extérieur et savant mais bien de l’intérieur, sans la magnifier ni la dénigrer. Tout y passe : la difficulté qu’ont les prostituées à réapprendre à sentir après le conditionnement à se couper de toute émotion, la situation inconfortable d’un client duquel on tombe amoureux, du client qui tombe amoureux, d’un homme sadique, ou celle gonflante d’un « gros lard relou », Français de surcroît, qui vient pour une leçon de cunnilingus mais s’avère d’une incompétence désespérante. Et de cette rencontre avec l’homme ignorant tout du désir et de la jouissance, l’auteure se questionne : « Est-ce que c’était immoral de regretter ça, que ton expérience sexuelle n’ait pas été dispensée par les putes […]? Qu’est-ce qu’on peut souhaiter aux hommes vilains et désagréables, empotés et résignés au mépris des femmes, si ce n’est l’amabilité et le sourire des résidents de maisons closes? »
Portée par une prose vivante, foisonnante, rythmée et drôle, un esprit lucide et une sensualité contagieuse, Becker étudie ces « caricatures de femmes » réduites à une « nudité schématique », qui sont des « femmes et rien que ça », « payées pour ça ». C’est comme « examiner mon sexe sous un microscope », écrit-elle, posant son regard à la fois critique et respectueux dans l’alcôve secrète sans épargner aucun détail, du plus vil au plus spirituel. En endossant leur fonction, la jeune romancière analyse son propre rapport à l’érotisme et au sexe anonyme, mais aussi notre engourdissement généralisé de consommateurs effrénés. « Dans cette carapace vide que sont les putes, ces quelques carrés de peau loués à merci, auxquels on ne demande pas d’avoir un sens, il y a une vérité hurlant plus fort que chez n’importe quelle femme qu’on n’achète pas […] dans sa tentative vaine de transformer un être humain en commodité. » Selon elle, s’il faut blâmer quelqu’un dans la prostitution, c’est la société entière et notre obsession de la consommation. « Peut-être que le jour où on offrira aux femmes des boulots convenablement payés, elles n’auront plus l’idée de baisser leur culotte pour compléter leurs fins de mois », affirme-t-elle.
Si le livre est féministe et politique, il est avant tout un roman de haut vol, à la fois érudit et lubrique où l’éros n’est pas réduit à des schémas graphiques mais bien à un grand sujet philosophique. Audacieux et forcément dérangeant, La Maison est le miroir grossissant de notre relation trouble, complexe et parfois tordue à la sexualité. Les femmes qu’on y croise sont aussi belles et sulfureuses que fragiles et empêtrées dans des laideurs marchandes. Portée par une envie de les déchiffrer sans le moindre a priori, Becker offre un portrait juste, profond, sensible de ces femmes montrées comme nécessaires à l’humanité, mais jamais idéalisées. Quelques pages donnent lieu à d’hilarantes scènes d’anthologie, d’autres donnent envie de hurler. Plusieurs sont tout simplement des chefs-d’œuvre de composition. Chapeau à l’écrivaine qui a eu le culot d’offrir un chant aussi fort qu’inspiré en l’honneur de ces femmes réprouvées.
Ouvrir le feu
Autre femme marginalisée de la société : la cancéreuse, personnage dont s’est emparé le romancier français Sorj Chalandon dans un étonnant roman sur la solidarité féminine. Avec Une joie féroce, le lauréat du prix Médicis pour Une promesse (2006) emprunte pour la première fois la voix d’une femme : Jeanne, 39 ans, qui apprend qu’elle est atteinte d’un cancer du sein de grade 3 et se trouve fort mal accompagnée par un mari maladroit, dépourvu de mots réconfortants. L’auteur rapporte d’abord les faits autour de l’apparition d’un cancer dans la vie d’une femme : les mots du médecin, la vie qui bascule, la peur qui s’infiltre partout, les cheveux qui tombent et le regard des gens sur soi qui change. « Le cancer ne s’attrape pas, c’est lui qui vous attrape », écrit-il, dans sa prose toujours sobre, cinglante et concise.
La maladie de Jeanne ressemble à une longue plongée en enfer, jusqu’à ce qu’elle croise sur son chemin des femmes qui ont choisi de vivre autrement la maladie et d’y voir l’occasion de bifurquer, de choisir la guerre et la vie plutôt que l’aplatissement devant les épreuves. Jeanne va troquer la peur pour la révolte, décrochant progressivement de son rôle de femme polie et respectable, habitée par une envie d’indécence et de débordement. « J’avais ouvert le feu pour la première fois », affirme-t-elle, après avoir envoyé promener un emmerdeur. Avec Brigitte, Mélody et Assia, elle forme un clan de résistantes, toutes « en mal d’un enfant » chacune à leur manière, qui iront jusqu’à braquer une bijouterie pour aider l’une d’entre elles. Entre-temps, le mari de Jeanne la quitte, terminant l’effritement de ce couple amorcé des années plus tôt, à la mort de leur fils unique.
Chronique sociale (parfois un peu appuyée) sur les destins de femmes malmenées par la vie qui choisissent de déjouer leur sort, Une joie féroce est un appel à l’action et à la résistance contre l’injustice. Le roman a le mérite d’aborder le cancer non pas comme une fatale mise en échec mais comme un moyen de brandir notre humanité. Le clan boit, danse, chante et flirte avec le crime plutôt que de se morfondre sur son sort. Par un parallèle original, Chalandon réhabilite à partir des femmes rasées atteintes du cancer les marginales et les exclues : « Toutes les victimes des hommes. Les réprouvées. Les prostituées d’hier. Les femmes adultères. Les bagnardes. Les sorcières promises au bûcher. »