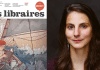La romancière anglaise Rachel Cusk brosse un portrait percutant des rapports de pouvoir et d’autorité dans La dépendance, un huis clos philosophique de haute voltige inspiré des mémoires de Mabel Dodge Luhan, qui avait hébergé l’écrivain D. H. Lawrence, ici changée en peintre. Sous la forme de lettres envoyées à un certain Jeffers, le récit est narré par M, une romancière dans la cinquantaine qui n’a pas publié depuis longtemps. Retirée dans un domaine au bord de la mer avec son mari, Tony, sa fille et son amoureux, elle possède une annexe au fond du jardin qui sert de résidence d’artistes. Un jour, elle écrit à L, un peintre renommé dont la cote a baissé, pour l’inviter à séjourner dans leur dépendance. L débarque accompagné d’une séduisante créature dans la trentaine, Brett. Celle-ci lui fait une remarque sur ses mèches grises qu’elle pourrait l’aider à cacher. M ravale sa rage. Le marais sauvage et la maison rustique apparaissent tout à coup comme un endroit parfaitement insalubre et miteux sous le regard du couple jet-set.
Jeux de perspectives et de pouvoir, les relations entre les trois couples forment un enchevêtrement intrigant de forces en tension. L est d’abord scruté par l’œil admiratif de M, qui voit chez cet artiste séduisant et indéchiffrable l’occasion de se remettre en contact avec l’art, mais très vite, les échanges se font belliqueux. L’impossibilité à saisir cet homme dont la nature même consiste à ne pas être capturé la frustre. S’ensuit une lutte féroce entre le désir de plaire de M et celui de détruire de L, éternelle guerre des sexes, combat entre l’artiste narcissique et son sujet en manque de reconnaissance. Or, au-delà de ces représentations, Cusk scrute les contradictions de deux êtres humains sans ne rien simplifier.
Rien n’est laissé au hasard dans ce roman magistralement construit où chacun est mis en face de ses incohérences et de ses fragilités. La narration suit la pensée de M à la manière du flux de conscience pratiqué par Virginia Woolf. Le cadre océanique fait d’ailleurs souvent écho aux Vagues et les tiraillements de la narratrice parvenue au milieu de sa vie rejoignent à bien des égards Mrs Dalloway. M cherche à combler un vide, « n’a pas le sens des réalités », ni celui de la beauté, croit-elle. Le grand peintre saura-t-il le lui révéler? M est la seule personne du marais que L refuse de peindre, prétextant ne pas arriver à la voir. À moins qu’elle se refuse à lui? Et s’il ne supportait pas d’être contraint par sa volonté? Le maître devient sujet dans un jouissif rééquilibrage des forces.
Cusk interroge avec un délicieux humour caustique nos conceptions de la liberté en lien avec le désir de plaire et de détruire. « Toute ma vie j’ai voulu être libre, or je n’ai pas même réussi à libérer mon petit orteil », déclare M. « Je croyais qu’il s’agissait d’un simple affranchissement, d’une échappée, alors qu’en réalité, c’est le dividende que rapportent l’obéissance tenace aux lois de la création et la domination exercée sur celles-ci. » « Pourquoi est-il si douloureux de vivre à l’intérieur de nos fictions? », scande-t-elle, alors que L, affaibli par une attaque, accomplit sa totale dissolution. Au final de ce périple intérieur, la liberté de l’artiste de vivre « hors du mécanisme du temps » sera donnée à M dans une scène sublime de baignade au clair de lune avec sa fille, scène de réconciliation des corps, des âges ode à notre disposition à l’émerveillement. « Il n’existe rien en dehors de ce qu’on se crée pour soi-même. »
Les histoires ou la vie
L’écrivaine française Pauline Delabroy-Allard revient après son superbe premier roman, Ça raconte Sarah (2018), avec une quête identitaire où la fiction est convoquée comme soupape aux violences du réel. Fort d’une écriture magnétique, Qui sait suit le récit d’une femme enceinte qui découvre en allant faire sa carte d’identité qu’elle porte trois deuxièmes prénoms qu’elle ne connaît pas : Jeanne, Jérôme, Ysé. Surprise, elle décide d’enquêter sur ces noms de baptême, se demande pourquoi on donne plusieurs prénoms aux enfants : « c’est le fantasme cafouilleux de donner plusieurs vies, d’ouvrir un champ des possibles à l’infini. »
Entre-temps, elle accouche d’une fille mort-née, porte ce deuil à travers sa quête sur les absents qui dorment dans ses prénoms et ce petit fantôme qui la hante. Depuis le « jour blanc », jour de son accouchement tragique, elle ne parle plus, ne voit plus personne, s’enferme dans sa recherche des disparus. La narratrice est sauvée de la torpeur du deuil par la fantaisie, l’invention, la fiction qui rendent ce voyage intérieur jubilatoire. « J’écris pour sauver ce qui peut l’être. J’écris pour savoir qui je suis. Si je n’obtiens pas de réponses, alors j’inventerai. » « Est-ce que j’existais avant d’exister? », pose-t-elle dans ce qui devient une quête de savoir inspirée par les trois questions fondamentales de Kant : « Que puis-je savoir? Que dois-je faire? Que m’est-il permis d’espérer? »
Sa quête identitaire menée avec beaucoup d’autodérision la mène d’abord vers deux Jeanne : une arrière-grand-mère aliénée et la seconde femme de son arrière-grand-père. Vient ensuite Jérôme, un ami de la famille mort du sida dans les années 1980. La narratrice décide alors de partir en Tunisie sur les traces de ce fantôme, mais revient avec un chat aveugle (!). Elle suit alors un professeur de danse sosie de Jérôme dans ce qui devient une fiction de plus en plus farfelue créée pour oublier le jour blanc.
La dernière pièce du puzzle identitaire, Ysé, se révèle être l’héroïne de la pièce de théâtre Partage de midi de Paul Claudel, un rôle que devait incarner sa mère. La narratrice s’enferme dans une maison de campagne pour lire la pièce, puis se prend au jeu, entre dans la fiction. Poussée par les appels de l’amoureuse qui lui demande de revenir dans la réalité, un peu comme Tony ramène M dans le roman de Cusk, la narratrice retrouve la parole et le goût de raconter le jour blanc, de révéler aux autres le prénom qu’elle avait choisi pour cette fille disparue. Ses aventures pour retrouver les absents de son identité n’étaient peut-être qu’un moyen pour enfouir le deuil au fond de sa mémoire. Voyage aux résonances psychanalytiques parfois un peu décousu, Qui sait se questionne sur la liberté qu’on doit prendre pour sortir des histoires que nos parents ont inscrites en nous.
Photo : © Justine Latour