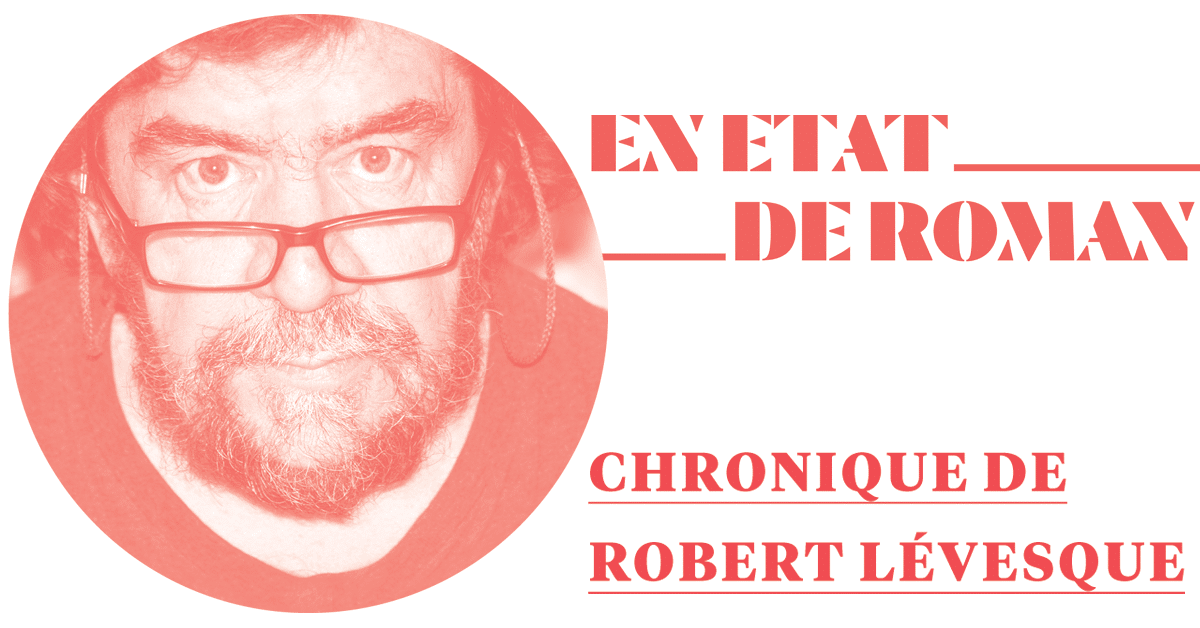Était-ce parce que ladite « Révolution argentine » du bien oublié général Ongaria interdisait aux filles la minijupe et aux garçons le cheveu long que Juan José Saer prit la poudre d’escampette en 1968 pour venir faire sa vie à Paris? M’est avis que ces détails vestimentaires et capillaires ne comptent pas lorsque votre pays tombe entre les mains d’une dictature national-catholique. Saer décida de sa fuite en homme libre qui entend le rester dut-il abandonner les lieux de son enfance et de sa jeunesse, abandon qui alluma chez lui le désir d’écrire, d’entrer en état de roman pour rattraper la perte.
Juan José Saer, dont le père était d’origine syrienne et qu’à l’école on appelait « el Turco », est, parmi les écrivains latino-américains de l’exil, l’un des plus singuliers, l’un dont l’œuvre se distingue des extravagances baroques auxquelles d’un seul tenant on associe, en faisant court, les écrivains des pays d’Amérique du Sud. Dans Le Monde des livres en 1987 (que je lisais alors scrupuleusement), Hector Bianciotti avait attiré mon attention sur Saer : « À la splendeur foisonnante dont font preuve les Mexicains, les Cubains, les Péruviens, les Brésiliens, succède, quelque 6 000 kilomètres plus bas, une écriture laconique, plus apte à exprimer l’intimité et les perplexités de la pensée qu’un monde chargé d’histoire ou richement visuel. »
Saer, en effet, n’a rien d’un Borges, d’un Márquez, il n’a pas leur notoriété et son œuvre (12 romans, 3 recueils d’essais, 7 de nouvelles), à laquelle je suis venu tard et que je considère maintenant comme majeure, universelle, géniale, en est une de grande complexité et d’audacieuse modernité. Ses romans, dont l’envergure semble relever d’un processus balzacien, donnant l’impression de créer une comédie humaine dans un lieu dit « la Zone » (la province de Santa Fe au nord de l’Argentine où il est né mais qu’il ne nomme jamais autrement que « la Zone »), sont, au contraire des sagas classiques, des constructions intellectuelles obsessives, reprises, abandonnées, faites de fragments et de récurrences. Cette menée volontairement incomplète du récit le rapproche plus du Nouveau Roman que du père Balzac (ou Zola) car tout dans ces livres qui inopinément se répondent, se relaient, où l’on rattrape d’un livre à l’autre un certain nombre de personnages aussi familiers que fuyants, des êtres pensants qui passent, réapparaissent, tous écrivains, journalistes ou intellectualistes, on cherche en vain la véritable intrigue, le but de l’opération, ce qui en fait toute la richesse, la grande singularité.
Juan José Saer travaillait à amoindrir l’intrigue, aucune énigme qui surgit sous les yeux du lecteur est résolue, on ne saura jamais ce qui s’est réellement passé comme par exemple dans le roman L’anniversaire où le temps d’une marche de 55 minutes le 23 octobre 1961 dans un quartier de la Zone deux individus qui se connaissent vaguement discutent d’une soirée qui a eu lieu la veille et où ils n’étaient pas invités mais dont ils ont entendu parler, leurs versions se voyant contredites par une connaissance qu’ils croisent et qui, elle, y était. Dans Cicatrices, pourquoi Luis Fiore a-t-il tué sa femme et s’est-il suicidé? Allez savoir… Dans L’ineffaçable, le journaliste Carlos Tomatis (l’une des figures plus récurrentes au point que l’on peut croire à un alter ego) se relève d’une profonde dépression après la mort de sa mère, croyant toujours que le bas de ses pantalons est maculé de boue, et il se rappelle soudain au long de marches sans but ses baises décevantes avec sa première femme et il va se dire : « et parfois même le désir non satisfait incruste des expériences imaginaires dans la mémoire, souhaitées mais non réalisées, plus ineffaçables que les réelles ».
Saer, ce Parisien argentin, mort à 67 ans en 2005, a laissé une œuvre dite « d’écrivain pour écrivains » mais d’autant plus importante et stimulante pour les grands lecteurs. Il s’est approprié la notion d’« œuvre ouverte » dont parlait Eco en demandant à ses lecteurs d’être coopératifs (admiratifs, dans mon cas) pour faire sa route dans une apparente béance de sens, béance qui invite et incite à la multiplicité des interprétations, des lectures.
Dans un essai (Narraciones, en 1983), Saer s’explique sur sa vision du récit romanesque, faisant remonter à Cervantès cette morale qu’il a pratiquée de l’échec en littérature, cette morale-tradition qui s’éloigne de l’épopée et de ses présupposés (moraux, sociaux, métaphysiques) dans laquelle il s’est inscrit en bout de lignée des Sterne, Flaubert, Kafka, Joyce. Comme ceux du Nouveau Roman, là encore, Saer s’opposa à la prétention totalisante du système balzacien. On retrouve souventes fois dans ses romans la répétition d’une même situation, une structure narrative est circulaire (on pourrait dire un cercle vicieux), et l’absence d’un événement déclencheur de la narration, ce qui me fait penser à la réplique de Godard à Truffaut lors de la sortie de La nuit américaine : Truffaut, pour se défendre de l’attaque de son ami qui détestait son « film américain », lui dit : mais voyons Jean-Luc, il faut bien qu’un film ait un début, un milieu et une fin; le cinéaste de La Chinoise lui lance : oui, François, mais pas nécessairement dans cet ordre-là…
Il existe une magistrale étude sur l’œuvre de Saer, un bouquin que je recommande à tout lecteur qui voudra se lancer à l’aventure de découvrir ce plus que remarquable écrivain argentin de Paris, ce sublime romancier, le titre en est L’œuvre de Juan José Saer : Unité, cohérence et fragmentation et il a été publié à L’Harmattan en 2014 par Pénélope Laurent. Celle-ci explique qu’en proposant un univers temporellement cohérent, complexe, lacunaire et hétérogène, Saer écrit « contre un modèle qu’il considère totalitaire, le Temps total linéaire, irréversible, orienté et plein ».
Pour Juan José Saer, le temps est un vaste présent qui dure depuis toujours. De la pointe de sa plume, il a cherché à viser l’acuité du présent. Son écriture s’insère parfaitement, ingénument, dans le mouvement de la seconde moitié du XXe siècle marqué par un fort sentiment d’incertitude, de déconstruction et de discontinu que l’unité globale de ses textes ne chercha pas à masquer. Stendhal disait que le roman était un miroir que l’on promène sur une grande route. Chez Saer, le miroir est brisé, étoilé, le lecteur a à recoller des morceaux en autant que faire se peut…