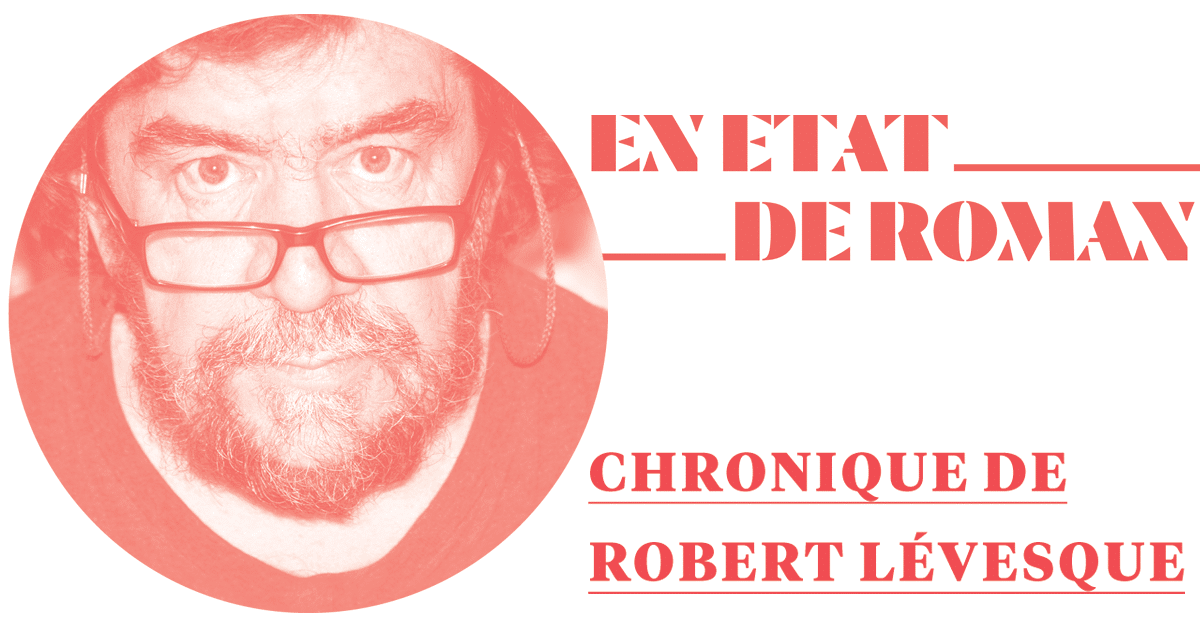Proust aimait les romanciers anglais et en particulier elle, George Eliot, venue tard à la littérature et qui (comme ses contemporaines, les Brontë) s’était donné un prénom masculin afin d’être jugée à ses mérites en échappant à la condescendance avec laquelle on traitait les « ouvrages de dames » au XIXe siècle. Contemporaine de George Sand, qu’elle admirait, voilà, ainsi que nous la présente Mona Ozouf, « l’autre George »…
Avant de se mettre en état de roman à l’approche de la quarantaine, Mary Ann Evans, née en 1819 dans le Warwickshire, la partie agricole des Midlands, se fit à la dure une tête d’intellectuelle, contrairement à la majorité des filles de son époque elle fonça dans les études classiques, soumise avec entrain au grec, au latin, au français, apprenant l’allemand et l’italien, traduisant du latin à l’anglais le Tractatus theologico-politicus de Spinoza, écrivant des critiques littéraires dans la Westminster Review, bref, si elle n’avait pas fait le saut tardif au roman, elle aurait été la parfaite « bas bleu » et serait oubliée depuis belle lurette.
Le roman a donc sauvé cette femme. Et cette femme, qu’Henry James décrivait « paisible, anxieuse, sédentaire, maladive dame anglaise sans aventures, sans extravagance ni air bravache », est devenue avec ses sept titres l’une des plus grandes romancières du XIXe siècle, une des figures de l’opposition aux valeurs victoriennes comme le furent Trollope, Thackeray, Thomas Hardy, les sœurs Brontë. Tolstoï, à qui certains osèrent la comparer, la lisait et l’admirait, les jeunes Gide et Mauriac en étaient marteau, seul l’aérien Oscar Wilde disait de son style qu’il était « lourd ». Le grand Dickens, élogieux, sut tout de suite, fin nez, que seule une femme pouvait écrire ainsi. Lorsque la vérité éclata sur son sexe, elle continua de signer George, qui était le prénom de son amant, un journaliste littéraire et un homme marié dont le divorce était inenvisageable.
Je viens de lire Scènes de la vie du clergé, qui regroupe ses trois premières nouvelles, et de relire Silas Marner, un roman qui marqua mon adolescence. Aucune lourdeur dans cette écriture my dear Oscar, au contraire une profondeur dans l’analyse des caractères masculins et féminins menée sans complaisance, avec une sûreté de regard, une dureté de vue, un doigté critique qui fait que Mary Ann Evans, élevée dans la foi évangéliste mais perdant assez tôt la foi (au coût d’une rupture brutale avec sa famille et plusieurs amis), aura pu devenir cette George Eliot, une romancière qui traite de la religion en la tenant à bonne distance, yeux grands ouverts, décrivant un monde réaliste et sans transcendance.
Je ne m’étais pas étonné lorsque, lisant la biographie que Deirdre Bair a consacré à Simone de Beauvoir (Fayard, 1991), j’ai appris l’importance qu’avait eu chez la compagne de Sartre la lecture du chef-d’œuvre de cet autre George, Le moulin sur la Floss. Ce roman, qu’elle avait lu à 12 ans, marqua toute sa vie. Bair écrit : « L’amour, l’amitié, la vie intérieure, le respect de soi, la perception du devoir envers la société, et finalement l’isolement réel qui précède la fin tragique de Maggie : tous ces éléments émouvaient aux larmes la jeune Simone. Elle était assez grande pour commencer à voir que son propre isolement (au sein de la famille et en classe) et l’impression que personne ne la comprenait n’avaient rien d’imaginaire. »
Dans ce roman, Maggie Tulliver, l’impétueuse sœur de Tom, si admirative de son frangin qui, lui, est tout à fait différent d’elle, tout en solide bon sens quand elle est toute imagination, va se voir rejetée par celui-ci, éloignée, mais un jour le sort les réunira dans la mort (ou l’amour) lorsque la Floss déborde, inonde la campagne et que Maggie volera au secours de Tom, le fera monter dans une barque pour le sauver mais qui, se renversant, les emportera tous deux dans les flots alors qu’ils se tiennent enlacés.
Beauvoir, dans le ressenti d’un sentiment d’exclusion, voyait en cette Maggie une femme transcender sa vie personnelle, surmontant les affronts venus des autres, devenant forte et dramatique. Au surplus, le Castor, qui ne sera pas un parangon de beauté féminine, s’identifiait, explique Deirdre Bair, à cette George Eliot dont le physique était disgracieux, une femme qui avait pu être laide et peu attachante mais devenir une romancière de premier plan, à l’égal des grands. Henry James, à cet égard et avec son tact de plume, écrivit d’Eliot qu’elle était « magnifiquement laide, délicieusement hideuse ».
Mona Ozouf ne signe pas, avec L’autre George, une énième biographie mais elle effectue une plongée dans l’œuvre, analysant trois de ses principaux romans (Le moulin sur la Floss, Middlemarch et Daniel Deronda), puis elle s’attarde à comprendre une moraliste qui s’était affranchie de la religion, une artiste qui s’était formée à la lecture de ses grands prédécesseurs dont Walter Scott, et une femme qui mena, dans un univers de conservatisme aigu, une vie sexuelle illicite qui était plus dure à assumer pour elle que pour son compagnon, vie chèrement payée pour elle dans la réprobation sociale mais qu’elle assuma, nous dit Ozouf, comme une vie de condition siamoise entre un quiétisme amoureux et une inquiète activité intellectuelle.
Cet autre George ne pouvait être plus différent, cependant, que le George de Nohant, la « bonne dame » qui écrivait des romans champêtres. L’Anglaise était beaucoup plus savante et intellectuelle mais cependant moins politique (elle avait horreur des prises de position publiques), elle avait le goût de l’ombre quand la Française n’aimait rien autant que briller, danser, recevoir, provoquer, et elle n’aura eu qu’un seul amant quand l’autre les aura multipliés dans sa maison ouverte mais, étant toutes deux des « voix » insolites, audacieuses, franches, elles se rejoignaient sur la question du féminisme et, telle Colette qui viendra après elles, elles détestaient « les stupides romans de dames stupides » (dixit la George anglaise) et demeuraient réticentes au vote des femmes parce qu’ayant vu le monde tel qu’il était elles considéraient que leurs semblables, leurs sœurs, leurs hypocrites lectrices, étaient des êtres sans autonomie et qu’il aurait fallu selon elles, comme l’explique l’historienne Mona Ozouf, que l’on développe en leur temps étouffant de misogynie une nécessaire et solide éducation des filles, égale à celle des garçons.
L’une chante, l’autre pas, ce titre du film d’Agnès Varda, convient parfaitement aux deux George. Quand la Française écrivait sa Petite Fadette dans le plaisir, l’Anglaise imaginait le destin de Maggie Tulliver dans une certaine souffrance.