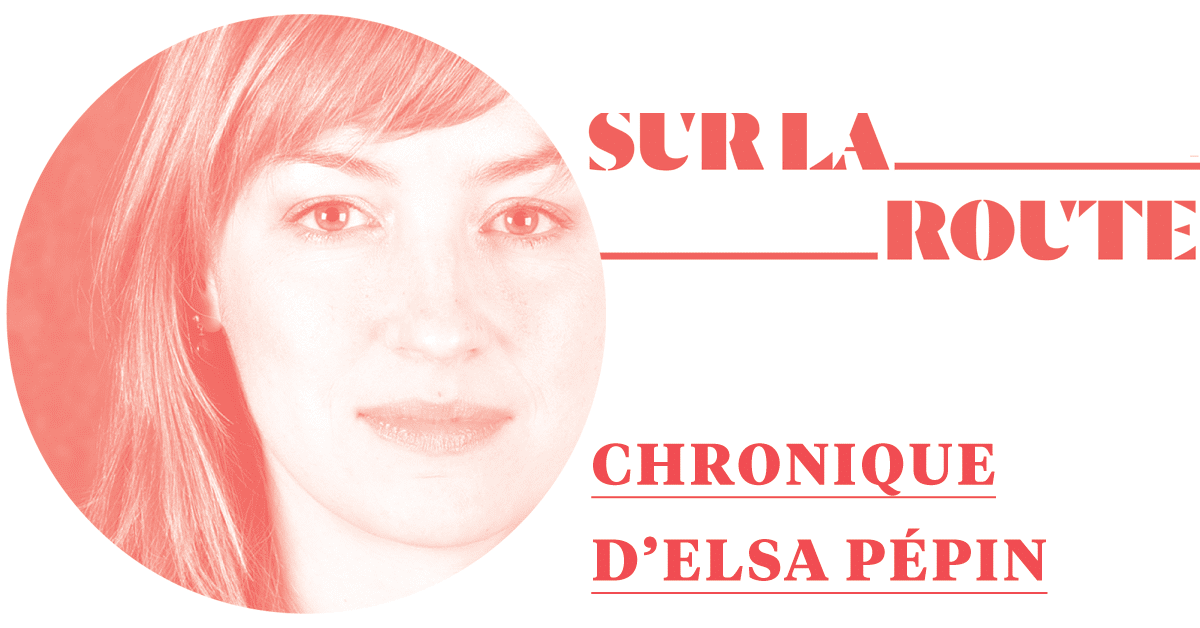Les menaces pèsent sur notre époque au point qu’il n’est plus besoin de se projeter très loin pour imaginer les dérives de notre monde. L’apocalypse semble à nos portes, ce qui explique sans doute l’attrait des romanciers pour la dystopie. Jakuta Alikavazovic et Marie Darrieussecq imaginent toutes deux un futur proche hanté par la peur.
Lente avancée des ténèbres
La fin du monde n’a rien des cataclysmes climatiques ou des attaques nucléaires chez la romancière française Jakuta Alikavazovic, de parents originaires de Bosnie et du Monténégro. Dans L’avancée de la nuit, l’effondrement se passe d’abord dans les cœurs de deux amants foudroyés par la passion, une grande histoire d’amour tragique scellée d’emblée par la catastrophe finale. Paul et Amélia se rencontrent à l’université. Il est gardien de nuit dans un hôtel. Elle est rentière et habite ce même hôtel. Après une valse d’évitement, ils se rejoignent la nuit, consomment cet amour dans une sorte de mécanique inévitable qui annonce sa fin tragique, sur fond de guerre en Bosnie, d’un monde qui flambe et se fragmente.
Amélia Dehr est un « danger vivant », avec « un trait vaguement destructeur », « une passion de la catastrophe », abandonnée par une mère disparue durant la guerre en ex-Yougoslavie après une enfance à ne côtoyer que des adultes. Objet de fascination pour Paul, Amélia incarne l’égarement et la folie des êtres déracinés, d’une solitude fondamentale, qui se drogue par instinct, insecte incandescent courant vers un feu mortel. Elle entraîne Paul dans un demolition party, apogée d’une jeunesse dédiée à l’errance, à l’autodestruction et à l’effacement, jusqu’à quitter réellement son amoureux pour partir à la recherche de sa mère en Bosnie et achever sa longue dislocation.
Paul, curieux, dont le point de vue domine le roman, cherche plutôt à comprendre le monde qui l’entoure, se posant des questions étranges, complexes, croisant la symbolique, la psychologie, l’histoire et la métaphysique. « Existe-t-il des récits qui tuent? Mais qui tuent lentement, à petit feu, comme ces prises curieuses d’arts martiaux qui ne sont en apparence qu’un contact, qu’une pression, et un an plus tard le cœur s’arrête soudain, comme de lui-même. Un crime parfait. »
Crépusculaire, poétique, philosophique, ce roman ne se laisse pas facilement cerner à la manière du monde glissant qu’il décrit, un monde orphelin de modèle, de vérité, d’orientation, grugé par une peur omniprésente qui exige un repli sécuritaire, un repli sur soi à la fois terrible et discret, presque apaisant. Apaisement par l’avancée d’une nuit qui éteint les feux, l’éblouissante lumière de notre monde surveillé, comme par une sorte de recueillement dans les ténèbres. Jouant sur les paradoxes, les jeux de contraires, le brouillage entre l’extérieur et l’intérieur, l’irruption de l’irréel dans le réel, l’œuvre déroutante aborde la mort et la disparition sous des angles inattendus, surprenants, parfois sibyllins. Additionnant les digressions par l’intermédiaire de la professeure Anton Albers, universitaire excentrique dissertant entre autres sur le langage de la lumière ou la peur des villes, l’œuvre met en scène un foisonnement de discours et de visions du monde qui s’entrechoquent, se percutent, choc tectonique de fin du monde.
Non dénué de fantaisie (Paul au départ est sous le coup d’une malédiction ou d’un sortilège, alors qu’il redevient vierge après chaque relation sexuelle…), le roman de celle qui avait remporté le prix Goncourt du premier roman pour Corps volatils (L’Olivier, 2007) se retrouve en lice pour le Médicis. Récit de la lente disparition du sens, l’œuvre décrit la densité de notre époque à laquelle répond une obscurité dangereuse. Sombre, érotique, capiteux, L’avancée de la nuit c’est l’amour qui meurt, le monde sans l’harmonie.
L’envers du monde
Dans un roman plus rigolo malgré son climat post-apocalyptique très noir, Marie Darrieussecq imagine un futur où les robots et les clones sont intégrés à la société, un monde où l’humanité peine à survivre face à l’invasion de ses avatars. Avec Notre vie dans les forêts, la prolifique auteure qui s’est fait connaître en 1996 avec Truismes interroge avec ironie notre relation à la réalité à travers l’histoire d’une ancienne psychologue (Viviane) qui essaie d’entrer en contact avec sa moitié endormie (Marie) et qui se retrouve chargée de soigner l’unique survivante d’un avion abattu par une faction terroriste. Dans cette post-société où sévissent attentats et enlèvements, chacun possède sa moitié, clone parfait de soi-même qui constitue un réservoir d’organes disponibles pour de possibles greffes, un « corps durable », comme « une assurance-vie ».
Dans un style cru, minimaliste, presque chirurgical, la narratrice livre un monologue marqué par l’urgence où elle raconte sa relation avec les robots à qui il faut tout enseigner, depuis la marche jusqu’aux associations mentales, mais surtout, sa relation très particulière à son double comateux qu’elle tente de réanimer, sorte de fantôme évanescent d’un moi dissous ou d’un récit à inventer. Mais les moitiés n’ont « aucun sens politique, aucun désir métaphysique, aucun élan vers l’avenir. Tout au présent ». Rien de ce qui fait l’humain en somme.
Sa fuite dans la forêt, dans cette sorte d’« envers du monde », là où peut-être seront encore accessibles les restes de vie humaine possible sur Terre, procède d’un travail de déconnexion de l’intérieur nécessaire à la survie, « une désintoxication radicale de notre monde », qui « demande une révolution mentale, vraiment, de ne plus se voir au centre. Au centre de sa propre vision du monde. De comprendre qu’on est juste un surgeon périphérique ».
Avec une économie de moyens qui renvoie à l’effacement progressif de ces personnages en fuite, ce roman plein d’autodérision frappe par son réalisme froid, sa portée politique, ses échos à la fois concrets et symboliques. À l’instar des personnages d’un 1984, ces néo-humains font peur, surtout parce qu’ils nous renvoient un miroir effrayant de nos pertes profondes.