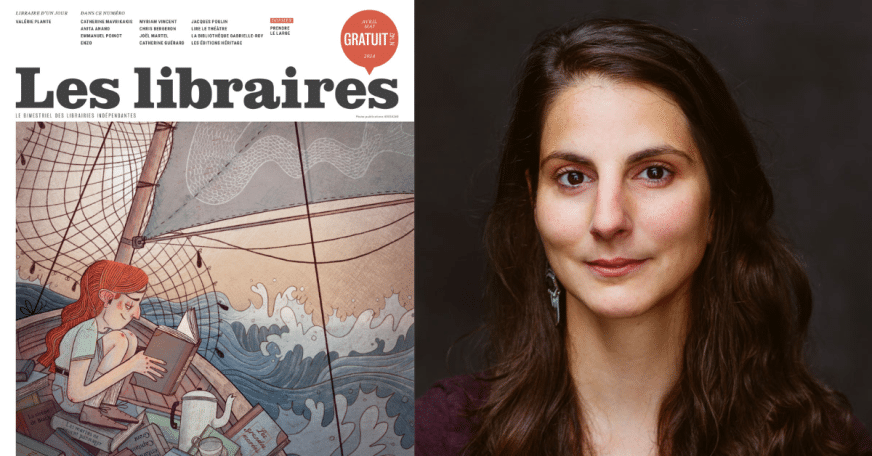C’est dimanche au Salon du livre de Montréal. La foule, nombreuse et de tous âges, se presse aux stands. Le livre papier tient ici la vedette, et son fan club ne semble pas vouloir disparaître. Mais dans un coin de la grande salle, un peu inaperçus dans tout le brouhaha, on a rassemblé des libraires, des éditeurs, des auteurs et des distributeurs à l’occasion d’une table ronde sur une nouvelle forme d’offre au lecteur, en plein essor et qui préoccupe tous ceux qui vivent par et pour l’édition traditionnelle: le livre électronique.
Lentement, notre relation avec le livre change et sa version électronique fait son nid sur le marché international, offrant des possibilités inédites tout en soulevant des interrogations et en provoquant des craintes, au premier chef pour l’avenir de l’industrie. Tous ceux qui composent l’industrie du livre et dont la profession, la raison d’être, même, est touchée par l’arrivée de cette nouvelle forme de consommation du contenu littéraire ―éditeurs, libraires, distributeurs, imprimeurs ―, disent être en processus intense de réflexion. En effet, il leur importe de négocier un passage qui semble obligé vers une technologie qui, pour être encore marginale au Québec, pourrait à terme changer totalement la donne, le rapport au lecteur et la chaîne de production du livre. Mais pour évaluer ces bouleversements et leur impact, encore faut-il d’abord en mesurer la portée réelle et se demander où en est le livre électro nique au Québec.
Un monde d’interrogations, des réponses à trouver
Directrice du marketing pour les Presses de l’Université du Québec, Bianca Drapeau se penche sur cette question, particulièrement en ce qui a trait aux domaines de l’éducation scolaire et de la recherche universitaire. Selon elle, le Québec accuse un retard relatif par rapport à la France, les États-Unis ou l’Angleterre, puisque les modes de production des petites maisons d’édition québécoises font que celles-ci doivent procéder à la numérisation des manuscrits ou à la transformation des fichiers informatiques de manière rétroactive, «ce qui nécessite un peu de temps et d’argent, que n’ont pas toujours les éditeurs». Elle ajoute qu’avant de pouvoir vendre un livre en format numérique, les éditeurs doivent s’assurer que leurs contrats le permettent. Une vérification parfois laborieuse qui en freine certains dans leur démarche. Bianca Drapeau précise également que, pour un petit marché où la vente de livres papier est déjà plus faible que celle d’autres pays francophones, certaines maisons craignent que le livre numérique ne cannibalise leurs ventes de livres conventionnels.
En résumé, une transition en douceur s’opère, et elle prédit que le rythme s’accentuera au cours des prochains mois. Cette vision est partagée par plusieurs dont Antoine Tanguay, fondateur des éditions Alto. Il parle, pour sa maison, d’un objectif en 2010: «Alto sera prêt», affirme-t-il. Il s’insurge d’ailleurs à l’idée de parler d’un retard du Québec sur le reste de la francophonie: «En retard par rapport à quoi? Existe-t-il un délai? Lentement, le livre électronique trouvera ses adeptes et les éditeurs, comme les libraires, suivront, prêts à fournir à la demande.» Il constate de plus que le secteur de la production de livres est face à un embranchement, «un doublement de voie vers un même but: lire et faire lire». Du côté des éditions Alire, spécialisées dans la sciencefiction, le policier et le fantastique, on fait en quelque sorte figure de pionnier. Sa maison, nous apprend le directeur littéraire Jean Pettigrew, était prête depuis sa création, en 1996: «De fait, une clause de notre contrat prévoit depuis nos débuts la publication de versions numériques, peu importe leur format.» Quatorze années plus tard, on s’en félicite.
Pascal Assathiany, directeur des Éditions du Boréal et du distributeur de livres Dimedia, refuse pour sa part de s’affoler face à une éventuelle lenteur du monde de l’édition québécoise à se mettre à l’heure du numérique. Pour lui, cette technologie n’en est encore qu’à ses premiers balbutiements et les acteurs ont tout le temps de s’y conformer. Mieux vaut, pense-t-il, bien attacher toutes les ficelles avant de se lancer à corps perdu dans un mode de production et de partage qu’il faudrait revoir ensuite parce qu’il ne serait pas viable. D’ailleurs, Pascal Assathiany juge que le livre électronique n’a pas encore véritablement percé le marché, non seulement au Québec, mais ailleurs dans le monde. Il évalue à moins de 1% le pourcentage de lecteurs conquis par le livre numérique, et à son avis, il faudra bien des années avant que cette situation change sensiblement pour qu’elle ait un impact réel sur la production du livre.
Gilles Herman, directeur des éditions Septentrion, est également responsable du dossier du livre électronique pour l’Association nationale des éditeurs de livres (ANEL). Il pense que les maisons d’édition, après une vague d’incertitude, ressentent maintenant un vif intérêt pour cette technologie. L’ANEL a d’ailleurs clairement donné un souffle au virage vers le numérique en créant un agrégateur. «Agrégateur», avez-vous dit? Un nom étrange, mais très en vogue dans l’industrie du livre québécois. Conçu pour unir les forces vives du domaine de l’édition face à la concurrence de Google, l’agrégateur a été élaboré par la firme québécoise De Marque inc. Il s’agit d’un entrepôt virtuel dans lequel les éditeurs d’ici sont invités à déposer les fichiers numériques de leurs ouvrages. Cet outil joue le rôle de passerelle entre les éditeurs et les librairies, et ce, afin d’assurer une centralisation, un certain contrôle du produit et de sa distribution, en plus d’offrir une garantie de qualité pour le lecteur. Clément Laberge, vice-président aux services d’édition numérique chez De Marque, est le concepteur de l’agrégateur. Lui qui a participé à des expériences semblables en Europe dit avoir toujours eu la préoccupation de travailler à la survie de la diversité culturelle dans des petits marchés comme le Québec. Il indique que l’ANEL a immédiatement été emballée par ce projet novateur, qui constitue un grand pas pour la préservation de notre patrimoine littéraire.
Du côté des Librairies indépendantes du Québec (LIQ), on aborde l’aventure du numérique avec enthousiasme et précaution. Les LIQ ont créé en 2007 un site de ventes en ligne mettant en valeur nos belles-lettres, Livresquebecois. com, qui offre une interface conviviale et moderne. Ce projet a vu le jour grâce aux efforts conjugués de plusieurs librairies et membres de l’industrie, et il est intimement lié au développement de l’agrégateur. Directeur des LIQ, Denis Le- Brun explique que ce site cherche à offrir toute la richesse de la littérature québécoise, tout en faisant contrepoids à Archambault et à son site Jelis.ca, qui se targue d’offrir des milliers de titres mais fait peu de place aux auteurs d’ici, ainsi qu’aux géants tels qu’Amazon ou la Fnac.
Concrètement, explique-t-il, l’achat est très simple pour le lecteur, car «l’entrepôt [l’agrégateur] est détenteur d’une banque de données, et l’acheteur a droit à un accès permanent, unique et sécurisé à une oeuvre».
De grands défis à relever
Longtemps, l’offre d’ouvrages numériques en langue française, et spécifiquement les oeuvres québécoises, a été anémique. Jusqu’à présent, les lecteurs désireux d’acheter des oeuvres en ligne n’avaient d’autre choix que de se tourner, entre autres, vers Amazon, où ils ne trouvaient du reste que les meilleurs vendeurs internationaux et des ouvrages pratiques tels des guides de voyage.
De leur côté, les LIQ ont pris leur destin en main, concentrant leurs efforts à la création d’une offre très ciblée. Denis LeBrun explique que le catalogue numérique de Livresquebecois.com se chiffre actuellement autour du millier de titres, mais qu’il s’enrichira sans cesse: «On parle d’oeuvres de toutes sortes, des romans contemporains, mais aussi de répertoire», souligne-t-il. Le souci de la promotion de nos auteurs et de notre littérature ainsi que la préservation de notre patrimoine culturel constituent le leitmotiv de Livresquebecois.com.
Dans le domaine universitaire, l’offre est toutefois vaste et variée depuis plusieurs années. «Aux Presses de l’Université du Québec, nous vendons des livres numériques depuis 2005 et avons converti l’ensemble de notre fonds, soit 800 titres, en format PDF, explique Bianca Drapeau. Nos clients sont habitués à consulter des ressources numériques puisque les revues scientifiques ont pris le virage numérique depuis plus de dix ans. Par ailleurs, la vente aux bibliothèques et aux centres de documentation s’effectue par l’entremise des partenaires depuis deux ans et produit de bons résultats.» La situation est, selon elle, différente pour ce qui est du scolaire, notamment aux niveaux collégial et universitaire, car les éditeurs ne vendent pas leurs manuels de cours en format électro nique pour le moment. «Pour l’instant, les habitudes des étudiants ne nous permettent pas d’éviter le piratage et les coûts du développement des manuels scolaires ne peuvent être rentabilisés si l’on n’est pas certains que la très grande majorité des étudiants achèteront leur propre exemplaire», soutient-elle.
Le monde change
Selon Clément Laberge, la part du numérique dans les ventes de livres au Québec est difficile à évaluer vu qu’aucun chiffre n’est compilé et que «c’est par recoupements, de façon un peu subjective, que l’on a une idée». D’après lui, le marché du numérique se situe actuellement en dessous du 1 %, mais il ne s’agit que d’une question de temps avant que le rattrapage ne se fasse.
Auparavant, le marché québécois était en retard par rapport au marché français, qui lui-même traînait par rapport à celui des États-Unis; or, le fossé se comble. Clément Laberge ne voit pas pourquoi, si l’offre est là et la technologie, adaptée, le lecteur québécois serait plus réfractaire qu’un autre, notant au passage que chez nos voisins américains, les ventes d’un livre lancé simultanément en versions papier et électronique se divisent actuellement quasiment dans une proportion moitié-moitié, «ce qui paraissait inimaginable il y a quelques années».
Son de cloche un peu différent chez Pascal Assathiany, qui croit que tout le brouhaha autour du numérique tient plus, pour l’instant, du phénomène médiatique: «Je n’ai aucune demande pour du contenu littéraire numérique. Cette demande viendra, mais tout le monde a le temps de voir venir.» Bianca Drapeau, quant à elle, ne pense pas que les Québécois soient réfractaires au changement: «Évidemment, comme pour n’importe quelle innovation technologique , on trouve des gens plus avant-gardistes.» Elle prétend que les guides de voyage ou les essais ont davantage de chances de migrer plus vite vers le numérique que la fiction ou l’album jeunesse, qui seront plus lents à s’ajuster à ce nouveau mode de présentation.
Antoine Tanguay est quant à lui persuadé qu’il faut de la patience pour mesurer la réponse du public: «Peutêtre d’ici un an aurons-nous une meilleure perspective. Le marché est petit, et les avenues commerciales, plutôt minces. Il faut beaucoup de temps et d’efforts pour rendre son catalogue disponible en format électronique, alors laissons les éditeurs avancer et le public réagir à leurs efforts.» Chez Septentrion, Gilles Herman pense aussi qu’il est difficile d’analyser le degré de réceptivité du lecteur québécois: «Est-il en retard? L’oeuf ou la poule? Il y a peu d’intérêt encore, au Québec, pour le livre numérique, car l’offre est limitée et les éditeurs ne veulent pas investir tant qu’il n’y aura pas un intérêt plus marqué. Le problème, pour les éditeurs, renchérit-il, est l’investissement, tandis que les marges de profit sont déjà minimes pour l’édition papier.» Selon lui, les gouvernements, tant québécois que canadien, doivent comprendre qu’il faut investir massivement dans ce domaine pour ne pas perdre la place de choix creusée au Québec dans un marché du livre conventionnel. Il juge qu’il existe plus de lecteurs de contenu numérique qu’on pourrait le penser, mais que, jusqu’ici, ceuxci étaient forcés de se rabattre sur du contenu en anglais. Une situation qui change avec des services tels que ceux offerts par le biais de Livresquebecois.com.
Gilles Herman prédit qu’à moyen ou à long terme, nos habitudes de consommation vont changer. «On va se découvrir de nouveaux temps de lecture. Chez le gara giste, en attendant la pose de ses pneus d’hiver, chez le médecin (hélas…), dans l’autobus: on pourra lire ce qu’on veut quand on veut. La lecture, en voyage, va énormément y gagner: en route pour Rome, pourquoi ne pas télécharger un roman se passant dans cette ville, tandis que vous consultez un guide de voyage mis à jour avec une carte interactive? Ce qui n’enlèvera rien au plaisir de bouquiner en librairie et de se laisser tenter par un conseil de notre libraire», assure-t-il. Jean Pettigrew, d’Alire, pense aussi que la révolution est bel et bien en marche, même s’il s’agit d’un phénomène récent. Il indique que chez le lecteur, la demande, pour son entreprise, est apparue vers 2004, mais qu’elle était cette à cette époque anecdotique: «Cependant, depuis l’année dernière, il ne se passe guère de journée sans que je reçoive des courriels de gens intéressés par nos nouveautés en format numérique.» L’important, s’accordent nos acteurs, est que l’industrie soit au rendez-vous et dans les meilleures conditions possibles.
Vent de changement
À propos du l’avènement du livre numérique, on aura tout entendu. Que ce sera la fin pour les librairies, pour le monde de l’édition, que la littérature d’expression française sera perdue, noyée dans la masse anarchique des documents disponibles pour le téléchargement, face à un lecteur perdu dans la jungle de l’autoédition et à des auteurs pillés par le piratage. Stanley Péan, écrivain et président de l’Union des écrivaines et des écrivains québécois (UNEQ), comprend que certaines personnes s’inquiètent; si on va au bout de la logique, le livre numérique conduit à la disparition d’au moins deux des acteurs de la production traditionnelle du livre, soit l’imprimeur et le distributeur. Resteront le commerçant et l’éditeur, avec lesquels les auteurs vont devoir renégocier les modèles, le partage des recettes. Car si ces deux acteurs ne deviennent plus nécessaires, si les coûts d’impression en particulier sont éliminés, la donne est changée, et la part traditionnellement attribuée à l’imprimeur devra être équitablement redistribuée. Une question qui n’est actuellement aucunement encadrée par des règles, dénonce-t-il.
Denis LeBrun décrie également l’absence de cadre, mais sait que les partenaires sont en pleine réflexion. Quant à prétendre que les rôles du distributeur et du libraire traditionnel seront bientôt obsolètes, un instant! «Les éditeurs qui pensaient se passer des libraires et des distributeurs se rendent compte qu’ils ne sont pas équipés pour prendre la relève, qu’ils doivent engager des gens pour ce travail. Ils reviennent en arrière, à des modèles plus conventionnels», explique-t-il. Du côté des Éditions du Boréal, Pascal Assathiany croit fermement que l’avenir du numérique, s’il y en a un, passe par la mise en place d’une chaîne de production calquée, avec souplesse, sur celle du livre papier. Un processus qui nécessite du temps, du recul et de la concertation. Et les pouvoirs publics, renchérit Denis LeBrun, ont tardé à agir pour aider à négocier le virage: «Ils se sont réveillés cette année. La SODEC [Société de développement des entreprises culturelles] a reçu des montants pour aider éditeurs et libraires, tout se met en place, mais lentement.» Cette relative apathie des instances gouvernementales est aussi confirmée par Pascal Assathiany, qui examine aussi le livre électronique selon deux pôles bien spécifiques, l’édition et la distribution. Il se montre plutôt critique face à des initiatives comme Jelis.ca: «Archambault s’est lancé sans rien proposer de vraiment intéressant. Ils n’offrent que du contenu américain traduit ou français, ou du contenu scolaire alors que de nombreuses questions ne sont pas réglées avec les auteurs [leurs droits, entre autres].» Fonctionnel depuis août 2009, Jelis.ca se décrit comme le premier détaillant de livres numériques francophones en Amérique du Nord, mais quiconque cherchera à se procurer, par exemple, un roman de Dany Laferrière publié au Québec par les Éditions du Boréal, se heurtera vite aux limites de son offre, n’y trouvant que deux titres parus chez l’éditeur français du lauréat du Médicis 2009, Grasset. Ainsi, Pascal Assathiany juge pertinente l’initiative de Livresquebecois.com et la création de l’entrepôt numérique, mais il se montre critique face à l’approche de l’ANEL: «L’entrepôt discrimine: c’est plus cher d’y avoir accès pour les non-membres que pour les membres. Et tout cela, tout de même, avec de l’argent public » À cet effet, il pense que les pouvoirs publics devraient convoquer une grande table de réflexion, des états généraux du livre numérique, pour que la question soit mise à plat, avec toutes les parties sur un pied d’égalité dans la démarche.
L’éditeur à son mot à dire
Antoine Tanguay pense qu’il est encore trop tôt pour évaluer comment les éditeurs vont vivre ce tournant du point de vue des ventes ainsi que la façon dont l’argent engrangé sera distribué: «Tout est en négociation, mais quelques grandes avenues se précisent. Ce sera à l’éditeur d’établir une bonne gestion de son stock et d’en faire la promotion, comme il le fait avec les livres traditionnels.» Selon lui, le livre électronique n’est ni un substitut ni un danger quelconque. «Je le vois d’un bon oeil, comme une occasion d’offrir plus de portes d’entrée vers les oeuvres des auteurs, soutient-il. Il y aura un impact, mais pas sur la sélection des oeuvres, ni sur le travail à l’intérieur de la maison.» Idem chez Alire, où Jean Pettigrew juge que le livre numérique constitue une offre qui s’ajoute au contenu littéraire traditionnel, dont il n’est pas le concurrent ni le fossoyeur. Ainsi, l’éditeur doit voir le livre numérique comme une façon de plus d’élargir son public: «Par ailleurs, être éditeur, cela veut dire travailler avec un auteur afin que son manuscrit parvienne à maturité, qu’il atteigne le maximum de ses potentialités. Que ce manuscrit soit par la suite publié sur un support papier, disponible sur ordinateur ou sur un SonyReader, un Kindle ou un iPod ne change strictement rien à cette relation.» Par contre, pour lui, les «publieurs», c’est-à-dire ceux qui se contentent de publier ce que les auteurs leur envoient, pourraient développer une certaine crainte devant le livre numérique puisque leur rôle, qui n’est que mercantile, risque de devenir inutile. En fait, ce processus est amorcé depuis la démocratisation de l’ordinateur et le développement des logiciels de mise en page, puisque les auteurs peuvent maintenant faire bien des choses par eux-mêmes. «L’étape du numérique, dit Jean Pettigrew, c’est la dématérialisation de la littérature. Or, cela fait déjà plus d’une décade qu’Internet a permis cette dématérialisation, offrant à tous les auteurs qui le veulent la possibilité de proposer leurs chefs-d’oeuvre au monde; à ma connaissance, les publieurs sont toujours en activité et, Dieu merci, les éditeurs aussi.» Stanley Péan pense, tout comme Jean Pettigrew, que la relation entre l’éditeur et l’auteur est essentielle; le phénomène de l’autoédition, certes intéressant, comprend certains risques. En tant qu’auteur, il dit tenir au lien particulier avec l’éditeur qui, quand il joue bien son rôle, permet de conduire le manuscrit plus loin. «Je ne veux pas perdre ce dialogue», soutient-il.
Gilles Herman pense, lui, que toute forme de diffusion du livre doit être accueillie favorablement. Le livre, considère-t-il, n’est pas un objet physique, mais un outil de transmission du savoir, des idées et de l’imaginaire: «Si le mode de transmission numérique nous permet de rejoindre un plus large public et plus facilement, tant mieux. L’impact actuel sur le monde de l’édition est encore faible du point de vue économique, même chez les Anglo-Saxons. Mais sur le plan idéologique, il oblige tous les intervenants du milieu à se questionner sur leur travail et leur apport au livre, ce qui n’est pas plus mal.» Le directeur des éditions Septentrion explique également que chaque éditeur a la responsabilité de mettre en marché ses livres numériques, selon la formule qui lui convient le mieux. Par exemple, un éditeur peut permettre à un tiers de gérer son fonds: «En ce qui concerne la répartition des ventes, la seule certitude est qu’il n’y a plus d’étape d’impression de livres. Mais il reste un détaillant qui vend et gère le paiement, un distributeur qui transmet le fichier protégé adéquatement et qui facture ensuite les détaillants pour l’éditeur.
Il reste également à réaliser un travail de diffusion auprès des détaillants, des médias et des bibliothèques. De plus, il faut produire le fichier numérique, ce qui peut être moins simple qu’il y paraît. Et bien sûr, il reste les droits d’auteur à acquitter!»
À ceux qui évoquent une menace pour le patrimoine littéraire canadien-français, Gilles Herman répond sans ambages qu’il n’est pas en danger: «Un des grands avantages du papier sur le numérique est d’ailleurs sa pérennité, explique-t-il. Je sais que dans cent ans, si j’en prends soin, mon livre sera encore accessible. Qu’en est-il du format numérique, où les technologies changent aux dix ans? Mais il est vrai que la numérisation et l’indexation des fonds d’édition offrent des outils formidables pour accéder à ce patrimoine. C’est d’ailleurs ce qui est embêtant avec Google: il nous offre des outils très performants, mais, en même temps, il pille sans vergogne nos écrits.» Pour lui, une chose est certaine: le livre québécois a tout à gagner à être présent sous forme numérique afin de faire sa place sur le marché mondial. «Personnellement, conclut-il, je crois que les ventes numériques vont venir s’additionner aux ventes papier, je crois plus en un nouveau marché qu’en un glissement [de ce dernier]. Mais les éditeurs doivent se préoccuper dès aujourd’hui d’être présents avec leurs nouveautés, quitte à offrir leur fonds petit à petit; la reconnaissance d’un livre passera par son existence dans Internet.» Stanley Péan compare enfin l’évolution du livre à celle qu’a connue la musique. «Dans ce domaine, dit-il, le support est en train de disparaître, mais la musique est restée. L’industrie en a plus souffert que la musique elle-même. Je pense que c’est un peu le même phénomène pour le livre. L’industrie va se transformer, mais la littérature va rester.»
Cette page de l’histoire de l’édition est en cours de rédaction, comme l’expliquent les acteurs du domaine du livre rencontrés. Somme toute, le livre numérique fait son petit bonhomme de chemin, plus rapidement dans certains domaines comme celui de l’édition scientifique. Cependant, l’ensemble de l’industrie du livre québécois est à l’affût et met en place des outils tel l’agrégateur pour tenter de trouver un modèle respectueux des attentes de la société québécoise sur les questions d’identité et de sauvegarde du patrimoine. En attendant, libraires, éditeurs et distributeurs surveillent la tendance qui, en bout de ligne, viendra de vous, lecteurs.