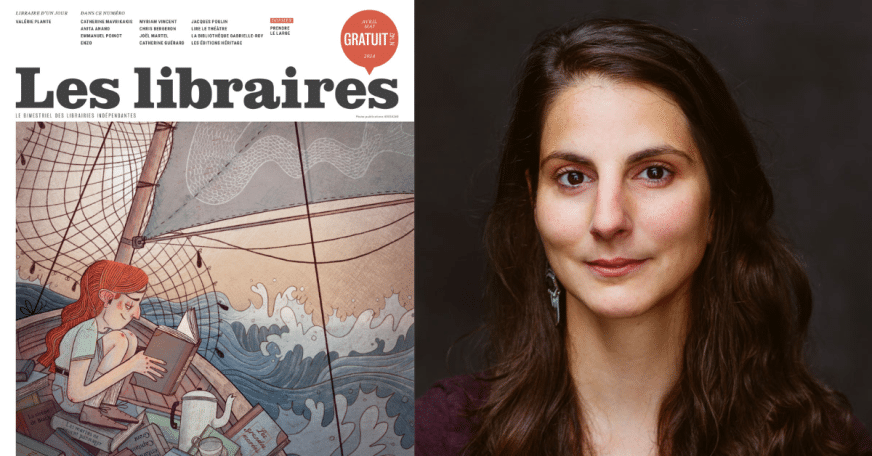Dans un essai sur l’écriture, le nouvelliste américain Raymond Carver écrit qu’un bon écrivain est un écrivain qui a des chances de durer. Il affirme également, citant Ezra Pound, que la seule morale de l’écriture est « l’exactitude foncière de l’expression », que la tâche essentielle de l’écrivain est de proposer une vision du monde et que le principal danger auquel il s’expose est celui de « tomber dans la simple resucée ».
À une époque où la littérature tend à devenir de plus en plus grand public et le grand public, de moins en moins littéraire, ces mots de Carver sonnent comme un rappel à l’ordre. En dehors des phénomènes de mode qui viennent embêter la « Grande Littérature » dans son petit bonhomme de chemin, et en marge de celle-ci, le monde littéraire peine à trouver un juste milieu. L’honnête homme d’aujourd’hui, ni philistin ni spécialiste, est la plupart du temps confronté à la vacuité des best-sellers ou à l’hermétisme des aspirants au prix Goncourt. Devant la quantité phénoménale de livres publiés chaque année, plusieurs approches s’offrent à lui :
1) Ne lire que les classiques déjà consacrés, ce qui a comme principal inconvénient de lui donner l’impression de faire de la lecture de rattrapage, le bon ton imposant de feindre d’avoir déjà lu (et parfois même relu!) tout Dostoïevski, Balzac, Zola, Proust, quelques autrichiens, deux ou trois allemands et Cent ans de solitude;
2) Ne lire que ce qui lui a été recommandé, de préférence chaudement, par un ami, un parent, un collègue, une émission de radio ou une revue, ce qui a pour désagrément fondamental de faire de lui l’équivalent littéraire de ces machos fashion victims en chemises préfripées en 2004 et roses ou bleu popsicle en 2015 que l’on croise l’été dans les mariages de nos cousines;
3) Ne lire que ce qui est auréolé de cette forme particulière de littérarité qui constitue le penchant littéraire de la musique indie : petites maisons d’édition, auteurs confidentiels, écrivains reconnus mais réputés marginaux, tout en cultivant un dédain consommé pour ce qui s’en écarte, ce qui, en tant que manière de devenir blasé et cynique par rapport à l’ensemble de ce qui se publie, constitue un excellent préalable.
Mais la question réside moins dans le choix d’une approche que dans celui d’une attitude à adopter par rapport à la lecture au sens large. Que doit-on lire? Y a-t-il des livres que l’on ne doit pas lire? Faut-il seulement que l’on lise?
La lecture d’un livre, cela semble évident, est une activité demandant un certain minimum d’attention et de concentration. À la différence de la musique ou du cinéma, qui s’écoutent et se regardent bien d’une oreille ou du coin de l’œil, on ne peut pas vraiment lire un livre tout en faisant autre chose. Lire, ce n’est pas comme voir ou entendre, il faut y mettre un peu du sien. Mais l’effort que demande la lecture n’est rien en comparaison des bénéfices que l’on peut en retirer. Lire, c’est mettre son imagination, sa sensibilité et son intelligence entre les mains de quelqu’un d’autre dans l’espoir qu’il ou elle saura quoi faire avec. Mais on lit pour s’éblouir, non pour s’aveugler, et, de ce point de vue, rien n’est plus énervant qu’un livre qui ne remplit pas ses promesses, qui est criard quand on l’attendait tonitruant, mièvre quand on le voulait émouvant, confus quand on l’espérait complexe. Le populisme navrant de certains ouvrages et la propension des éditeurs à décliner sous toutes les formes imaginables une recette qui a bien fonctionné tendent à démontrer que le monde du livre échappe de moins en moins à cette logique commerciale dont il s’était pourtant affranchi vers la fin du XIXe siècle. Il serait heureux que l’on puisse opposer à tout cela autre chose qu’un purisme d’aristocrate compassé, mais toute classification qualitative passe aujourd’hui pour de l’élitisme, quand pourtant il s’agit moins de séparer le bon grain de l’ivraie que de ménager la chèvre et le chou.
Depuis longtemps déjà, la littérature a cessé d’être un cénacle d’initiés avançant tout d’un bloc et passant par différentes phases. Ce que l’on appelait jadis des courants littéraires prend aujourd’hui la forme de phénomènes de modes qui perdurent quelques années puis meurent de leur belle mort, le plus souvent sans laisser de traces. Tout le monde a oublié Buffy, tout le monde oubliera bientôt Bella, et ce n’est pas grave. La figure de l’écrivain suant sang et eau tout en s’échinant sur la condition humaine est peu à peu remplacée par l’image de l’auteur brillant qui a compris les règles du jeu et qui, espiègle et débonnaire, saupoudre sporadiquement son génie chaque automne, pour son propre compte d’abord et, accessoirement, pour l’avancement général de la littérature. Peu importe, au fond, puisqu’au bout du compte, il n’y a pas de grands ou de petits romans. Seulement des bons et des mauvais.