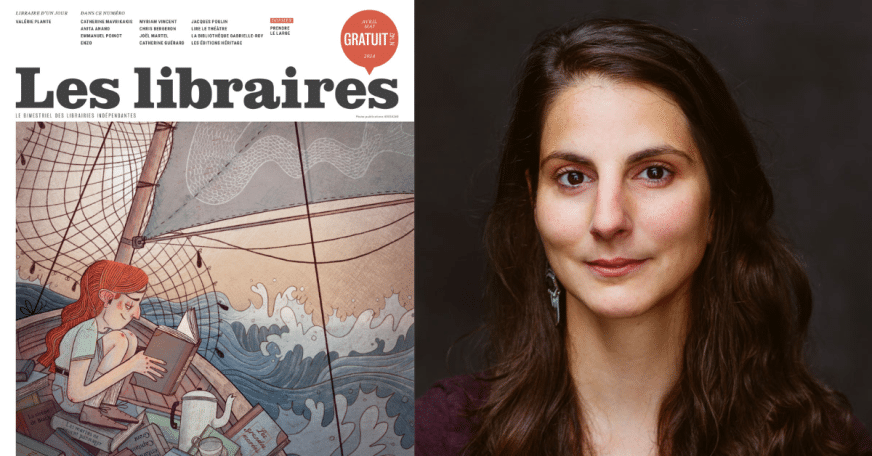Rose est convoquée au Japon pour recevoir un héritage d’Haru Ueno, son père mort récemment et qu’elle n’a pas connu. Peu encline à effectuer ce voyage pour un homme qui ne s’est manifesté qu’au moment de passer l’arme à gauche, elle se rend malgré tout à Kyōto dans la maison de celui-ci et se plie à la cadence des visites qu’il a préparées à son intention. Accompagnée de Paul, l’assistant de son père, elle va ainsi de temple en temple, sans comprendre le dessein nourri par son paternel. Imperceptiblement, au contact de la nature faite d’arbres, de fleurs, de montagnes et de pierres, des changements s’opéreront en elle, la menant vers des chemins plus cléments. L’autrice française Muriel Barbery réussit avec le roman Une rose seule (Actes Sud) à évoquer les renaissances qui surgissent des blessures et l’allègement qui gagne celui ou celle qui accepte ce qui se trouve sur sa route.
Des jardins que Rose traverse, des temples qu’elle foule, des tracés de sable ondulants qu’elle observe émane un dénuement qui exhale pourtant des auras obsédantes : « Nous ne sommes pas seuls ici. Par ces êtres invisibles et muets dont elle ne savait rien, dont la présence drapait le monde d’une brillance nouvelle, elle avait le sentiment de dériver dans l’épaisseur du temps. » Les environs sont hantés de fantômes qui rappellent la multiplicité des existences vécues et ce qu’elles charrient de désirs et de pertes, de souffrances et de lueurs. La présence des esprits ne laisse à Rose la possibilité d’aucune fuite, elle qui depuis l’adolescence est appesantie par une colère sourde engendrée par la tristesse de sa mère et l’ignorance dans laquelle on l’a tenue à propos de son père.
Mais c’est seulement en prenant le risque de toucher le point névralgique de ses fractures qu’elle pourra contourner l’âpreté qu’elle a instaurée comme subterfuge de défense. En se délestant de l’armure qui la protège de l’extérieur, elle se rend vulnérable aux intempéries, mais c’est aussi la seule manière de sentir la douceur de la brise un soir d’été. Cette vibrance qui occupe l’atmosphère est en même temps consolatrice. « Nous ne sommes pas seuls ici » peut évoquer une entité inquiétante qui plombe le fond de l’air, mais également une solidarité qui fait écho au désir de filiation de Rose.
Le trajet que son père a imaginé pour elle la fera déambuler dans des paysages, des sons et des odeurs qui par leurs transformations continuelles la reconnecteront à sa propre force vitale et lui donneront le courage de rompre la digue : « […] quelque part en un lieu ténu et immense, invisible comme le ciel, quelque chose changea de position. Elle perçut la venue de la pluie, une odeur de terre avide, d’herbe dans le vent. Il y eut une nouvelle translation, un parfum de sous-bois et de mousse. Elle se mit à pleurer à gros sanglots qui jaillissaient comme des perles scintillantes. » Tour à tour, le Japon sera pour Rose un endroit de vertiges, un lieu de rencontre avec la signification que recèle toute chose qui vit et se transforme, puis le berceau de sa véritable naissance.
Vouloir le posséder
La narratrice de Souvenir de Night (Boréal), de l’écrivain québécois Mathieu Rolland, est une femme d’affaires habituée à parcourir le monde, et, à l’image de sa vie qui n’est qu’une suite d’atterrissages ponctués de transactions à conclure, les cités se confondent au gré des horaires et des rendez-vous. Un soir qui l’a conduite au Japon, dans le bar de l’hôtel où elle séjourne, son œil est attiré par un homme qu’elle invite spontanément à sa chambre. Lorsque la soirée en est à son terme, il lui demande rétribution. D’abord surprise qu’il soit un prostitué, elle sera encore plus étonnée par son envie les jours suivants de le convier à nouveau, une envie qui se mutera bientôt en besoin impérieux jusqu’à occuper tout son espace intérieur. Elle l’appellera Night pour commémorer ses nuits, peut-être aussi pour la couleur de ses cheveux.
Les parties au présent sont intercalées par des moments de la jeunesse de la narratrice. Sa mère, qu’elle désigne par le pronom « Elle » à la fois pour signifier son égocentrisme et pour marquer l’importance qu’elle représente pour la jeune fille, lui a laissé un vide qu’elle tente de combler par le travail ou des hommes de passage. Mais rien ne se matérialise vraiment sous ses yeux qui voient, mais qui ne se laissent pas toucher : « Cent mille personnes disparaissent chaque année dans cette ville. Incapables de faire face à leur réalité. Évaporées. Une eau trop chaude. Disparues sans explication, aucune trace, effacée, du jour au lendemain, pour une nouvelle vie, ou pour ne plus exister, sans mourir. » À l’instar de ces êtres qui laissent tout derrière eux pour recommencer ailleurs, loin de ce qu’on a connu d’eux et à grande distance de ce qu’ils savent d’eux-mêmes, la femme construit chacune de ses journées comme un pont suspendu. À l’aube, elle repart perpétuellement, sans attaches.
Ce n’est que dans cette ville du Japon qu’elle prendra la mesure du manque qui l’affame, jusqu’à ne plus pouvoir feindre l’impassibilité qu’elle avait coutume d’enfiler en toutes circonstances. Par la fusion du corps de Night avec son propre corps, à travers la nuit frénétique qu’il lui fait vivre dans les rues de la ville où tremblent sons et lumières ainsi que l’intensité ressentie de la langueur concupiscente de l’amant, la réalité soudainement se concrétise et fait voir les plaies ouvertes. Pour les refermer, elle voudra s’ancrer à lui, qu’il s’incarne en amour sans condition. Elle ne l’imagine plus que comme le seul pays où habiter : « J’interrogeais sa peau. Scrutais les grains de beauté sur ses coudes. Éphélides. Sondais ses côtes, des montagnes auxquelles murmurer mes secrets. Examinais les veines de ses cuisses pour me dessiner une carte mentale de ses rivières. Écouter leur courant, connaître le goût de leur eau. » Elle se livre sans compromis à la découverte d’un nouveau monde, là où l’enfance l’avait abandonnée.
Que ce soit à cause des esprits venus des millénaires qui rôdent en plusieurs endroits ou des décors éclectiques qui coexistent — paysages et temples sacrés rivalisent avec les nuits survoltées des centres-villes —, le Japon est un territoire chargé de sens. Il a le pouvoir de sonder les cratères les plus profonds, de nous mettre en face de nos démons et de faire advenir ce que nous ne croyions pas possible.