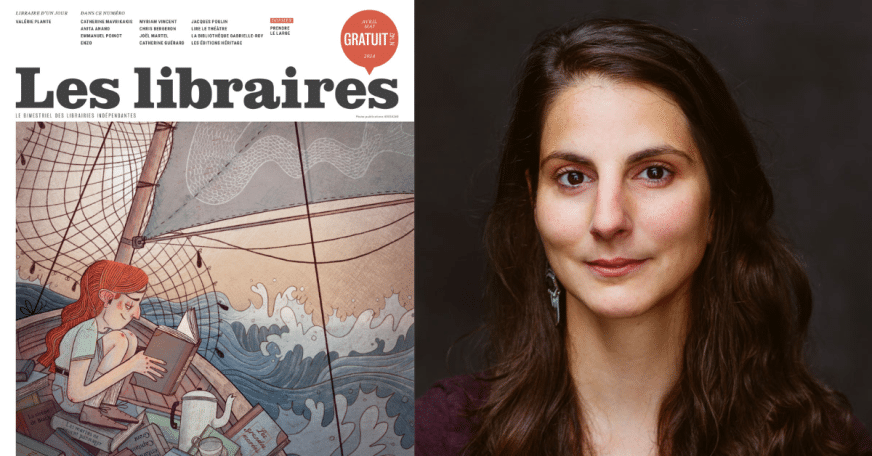Information ou loisir ?
Avec Balzac et Dumas, le roman est entré dans une nouvelle ère. De littérature de salon, art du bien écrire destiné au divertissement ou blague d’initiés consacrée à la peinture des travers d’un groupe restreint, le roman peut désormais chercher à embrasser la totalité de la société. Il suit en cela l’évolution de son nouveau canal : la presse. À la fin du XIXe siècle, acheter un livre est un luxe réservé aux classes les mieux nanties. Les revenus d’une famille ouvrière n’encouragent pas l’achat d’un produit comme le roman, considéré comme étant exclusivement dédié au loisir. Le temps de repos, susceptible d’être consacré à la lecture, était par ailleurs plutôt rare : rappelons que la semaine de travail, au début du XXe siècle, s’étirait du lundi au samedi, à raison de 10 heures à 12 heures par jour. Compromis économique et idéologique : le feuilleton, que l’on retrouve bientôt dans la plupart des journaux et des revues. Roman coupé en épisodes, il entraîne une rapide pénétration de la fiction dans les milieux populaires. Le périodique ne coûte pas cher ; il a, de plus, une valeur d’information qui vient à bout des réticences des hommes, moins portés à lire : ils s’y tiennent au courant des affaires publiques… et du prix des objets de consommation. À cette époque, en France, le roman-feuilleton intéresse d’abord les femmes, et sa présentation en un chapitre à la fois encourage sa lecture : « une livraison peut être rapidement lue, entre deux tâches ménagères, et le suspense narratif par lequel elle se termine brise quelque peu la monotonie de l’existence » (Anne-Marie Thiesse, Le Roman du quotidien). Les épisodes, découpés, sont cousus à la main et les romans ainsi recomposés sont prêtés à l’entourage.
Au pays de l’Oncle Sam
Aux États-Unis, un plus grand bassin de population, doublé de stratégies publicitaires persuasives, permettent déjà aux ouvrages reliés d’atteindre des ventes impressionnantes. En 1895, le magazine The Bookman publie la première liste des « meilleurs vendeurs ». Le premier best-seller consacré, cette année-là, est Beside the Bonnie Brier Bush, de l’Écossais Ian MacLaren. L’effet des listes sur les ventes est immédiat : le livre est déjà conçu et perçu comme un produit de consommation dont l’offre passe par le même canal que les autres… Ainsi, en 1897, The Honorable Peter Stirling de Paul Leceister Ford connaît des ventes décevantes… jusqu’à ce que son éditeur laisse entendre que le récit est inspiré de la vie du président Cleveland. Résultat : 228 000 copies vendues dans l’année. Souhaitant répéter les succès des éditeurs américains, l’industrie française appliquera rapidement les mêmes recettes. L’une de ces premières réussites orchestrées est la réédition, en 1921, de Maria Chapdelaine, premier titre de la collection « Les cahiers verts » de Grasset. Le tirage atteindra près de 170 000 exemplaires en deux ans.
De la définition d’un best-seller
Mais que désigne-t-on, aujourd’hui, par « best-seller » ? Parle-t-on d’un ouvrage produit selon des stratégies de mise en marché éprouvées, orienté vers un public-cible ? Ou ne s’agit-il pas plutôt d’un livre qui tombe à point, satisfaisant les exigences de la critique et comblant les attentes d’un large lectorat ? D’un côté il y aurait l’ « art » ; de l’autre, le « produit ». Le malaise provient d’une confusion dans la définition de l’objet. Exemple de cette ambivalence, une citation de La Force de l’âge de Simone de Beauvoir (1960), tirée de l’article « Best-seller » de Pierre Nora (Encyclopedia Universalis) : « Le dernier best-seller américain, Babbit, nous parut laborieusement plat ». Or Babbit, de Sinclair Lewis, prix Nobel de littérature, est considéré comme un classique.
En ce qui concerne exclusivement la fiction, le statut de « best-seller » demeure ambigu. Mais cette confusion est d’abord affaire de regard. Parler de best-seller, c’est, dans une certaine mesure, faire de l’histoire ou de la sociologie, quand ce n’est pas tout simplement en rester au niveau de la mise en marché : les maisons de distribution, parmi leurs listes de livres à paraître, présentent une colonne « best-sellers ». Il n’est pas question de « littérature », au sens où l’on ne juge pas d’une qualité, pas plus qu’on n’interprète une œuvre selon sa forme par rapport à d’autres œuvres.
La lecture « littéraire » implique de s’intéresser d’abord à la façon dont c’est fait. La réussite littéraire évoquée par la critique est comme un tour de magie dont on prend plaisir à piger le truc. Cette visée de décodage n’exclut pas la foi en cette magie, qui repose d’abord sur l’identification à un personnage, souvent une héroïne (Les Filles de Caleb, La Cordonnière, Madame Bovary, Anna Karénine), puis sur l’adhésion à un contexte qui évoque des traits sensibles de notre passé ou de notre présent : rapports entre les hommes et les femmes, difficulté à concilier les rôles sociaux, affrontement avec le clergé, certains milieux économiques ou politiques, etc.
« Les best-sellers, écrivait Denis Saint-Jacques dans Ces livres que vous avez aimés : Les best-sellers au Québec de 1970 à aujourd’hui (Nota bene, 15 $), participent à la constitution de la culture commune ; ils offrent une scène où l’on peut jouer ou être joué ». Mais, en dehors du marché français, qui demeure difficile d’accès, on voit mal les possibilités pour un best-seller québécois d’atteindre les chiffres de vente des plus grosses pointures. L’Histoire de Pi, de Yann Martel, est une exception notable, mais il fut d’abord publié en anglais, et par un éditeur étranger. L’Italien Umberto Eco, quant à lui, reste l’un des rares noms extérieurs au monde anglo-saxon à jouer sur la scène de ce qu’on appelle désormais la World Fiction. Lueur d’espoir pour la littérature québécoise, l’existence d’un roman populaire national, avec les Beauchemin, Tremblay, Cousture, Brouillet, et, plus récemment, les Lacombe et Gill. À l’exemple de l’intérêt notable des Québécois pour leur propre contenu télévisuel, notre production de best-sellers trouve son public. Et les listes des meilleurs vendeurs nous offrent parfois quelques surprises, comme Gaétan Soucy et Guillaume Vigneault.