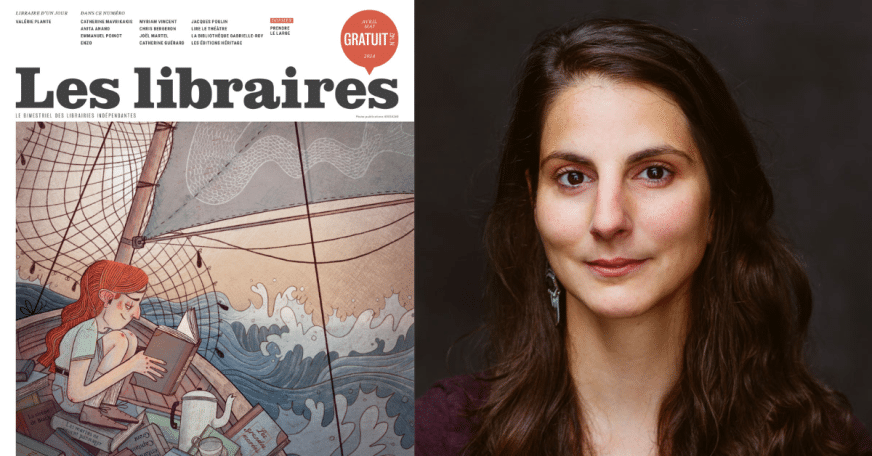Le sort de la production culturelle américaine n’a pas varié aux États-Unis en fonction de la présence de démocrates ou de républicains au pouvoir. De même, en France, c’est à Malraux et donc à de Gaulle qu’on doit les maisons de la culture et à François Mitterrand, l’orgie de la Grande Bibliothèque. Prenons d’autres exemples. La Finlande, la Norvège, l’Islande font partie des pays où on recense le plus grand nombre de lecteurs de livres per capita. Ce phénomène, cette constante, ce trait culturel sont invariables. Ils ne réagissent pas aux changements politiques. Ils font partie du paysage, du patrimoine. Pour faire simple, et on me le reprochera, disons que les sociétés qui veulent de la culture en reçoivent et que celles qui n’en souhaitent pas en ont peu.
Quelle politique ?
Si la culture avait à choisir entre libéraux ou péquistes, elle serait bien perplexe et elle aurait entièrement raison. Historiquement, les deux partis furent tout simplement et identiquement québécois. La culture au Québec est un luxe nécessaire, un privilège qu’on accorde à ceux qui la construisent et à ceux qui peuvent la fréquenter. Les débuts de la présence de l’État dans la culture ne furent pas brillants. Lesage accepta de créer un ministère des Affaires culturelles pour calmer un vieux bougon qui s’appelait Paul-Émile Lapalme et qui s’était battu contre Duplessis pendant que Lesage était « gras dur » à Ottawa. Luxe nécessaire, sourire aux intellos qui avaient appuyé les libéraux en 1960. Cela nous reposait de Duplessis, qui traitait de joueur de piano André Laurendeau, formule qui dans la bouche du chef signifiait que Laurendeau était probablement un « fif » parce qu’il parlait si bien tout comme Malraux, à qui une femme de ministre conseilla d’écrire des livres, puisqu’il parlait si bien. Ce que je tente de dire, c’est que paradoxalement, les politiques de la culture au Québec sont assez démocratiques et qu’elles ne varient pas en fonction des idéologies des partis. Pourquoi ? Parce que la culture n’est pas un enjeu politique dans le sens partisan et rentable du terme, mais un enjeu de société.
Dans les années 60, les chansonniers avaient autant fait pour populariser et légitimer les revendications nationalistes québécoises que les hommes politiques. Durant une vingtaine d’années, la chanson, la littérature, le théâtre furent nationalistes puis souverainistes. Ils le sont encore quoique plus timidement, pris au piège de leur complaisance à l’égard du PQ. Pendant ce temps, les industriels de la culture ne fréquentaient pas les partis en fonction de leurs principes mais en fonction de leurs résultats. On croyait — et j’en étais — que la prise du pouvoir par le PQ en 1976 constituerait le grand soir de la culture québécoise. Comédiens, écrivains, chanteurs se pressaient tous au Centre Paul-Sauvé le 15 novembre 1976. La ferveur se maintint jusqu’au référendum de 1980. Nous faisions partie — et j’en étais — d’une mission plus glorieuse et plus durable que nos intérêts bassement corporatistes. Nous aidions à sauver le Québec et sa culture. Nous étions bons péquistes, mais mauvais politiciens. La culture se nourrit de symboles et de signes, d’évidences naturelles, dirait Éluard, et les poètes ont cru que sous un gouvernement qui justifiait son existence par la menace qui s’exerçait sur la culture québécoise, la culture atteindrait l’Âge d’or. Nous avions oublié que la politique est affaire de votes et la culture, affaire de société. Nous eûmes donc des gouvernements péquistes et libéraux qui, à propos de la société, préconisaient des chemins différents, mais qui, en matière de culture, faisaient du pareil au même. Bien sûr, les péquistes possédaient plus de copains artistes et les libéraux, plus de copains propriétaires de journaux et de chaînes de télé. Cela fit illusion. Du moins pour les artistes très heureux d’être oints régulièrement par des ministres péquistes.
Quelle culture ?
Quels sont aujourd’hui et depuis longtemps les principaux acteurs culturels, qui façonnent l’inconscient populaire ou le cerveau des enfants et qui feront en sorte que dans dix ans ils liront Allô Police ou Marie Laberge, qu’ils écouteront Mix Mania ou Daniel Bélanger, qu’ils seront peut-être attirés par un Grec inconnu nommé Aristophane ou par un Libanais nommé Mouawad ? L’école et la télé. Avec une constance quasi religieuse et dogmatique, tous nos gouvernants ont empêché que les Québécois accèdent à la culture en leur interdisant la pleine connaissance de leur langue qui, faut-il le rappeler, est le français, mais aussi de ce qui fait le riche terrain fertile dans lequel la graine de la curiosité germe, toutes ces choses inutiles comme l’histoire et la géographie, l’apprentissage des civilisations. Les deux partis, depuis le rapport Parent, ont mis l’école à l’heure du marché de l’emploi, de l’immédiatement utile, de l’apparent succès. L’école veut créer des emplois, pas des gens éduqués.
Et puis, il y a la télé contre qui la culture ne gueule jamais parce qu’elle y gagne sa vie, quand elle y parvient. Mais la télé pense faire exactement comme les gouvernements : répondre à la demande de culture. Et comme la demande est petite ! Elle s’en fout d’autant plus que le gouvernement garant de la défense de la culture, peu importe le gouvernement, accorde aux producteurs de télé des subventions et des crédits d’impôt pour Star Académie, Un gars une fille, Rumeurs, Virginie… Pour le pire et le meilleur.
Et c’est ainsi que la culture se bat contre une ministre impuissante et souriante, pendant que Radio-Canada confine sa culture dans le petit créneau secret de ARTV, que TVA nous envoie promener, que TQS ignore même le sens du mot, que Télé-Québec fait du Diabolo Menthe et que l’école dit : « Si vous voulez une job, pas besoin de savoir écrire le français, pas besoin de connaître Olivier Guimond et encore moins Molière, pas besoin de savoir que René Lévesque était libéral, pas besoin de savoir que Mozart a existé et que c’est le musicien préféré de Sting, pour avoir un job, il faut passer maths 001 002 003 004 005 ».
À court terme, il faut défendre le peu d’acquis, car la culture languit depuis toujours dans le minimum vital. Refuser que, sous prétexte de béton, on charcute dans la création ou la diffusion. Nous gagnerons peut-être un million ou deux. Nous oublierons cependant toujours que notre plus grand ennemi fut toujours le ministre de l’Éducation et que son meilleur allié dans l’acculturation du Québec est la télévision que l’État, péquiste ou libéral, subventionne avec le même enthousiasme. Péquistes ou libéraux ? Progressistes ou conservateurs ? Pour la culture, bonnet blanc, blanc bonnet. L’ennemi est ailleurs.