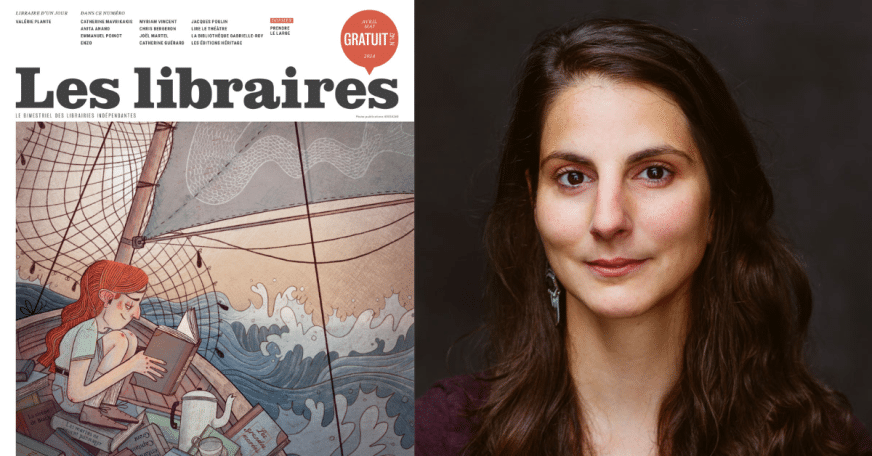On les compte à la dizaine ces écrivains qui, harassés par le poids des jours, ont jeté l’éponge et ont volontairement mis un terme à leur vie. Que peut-on prendre de ce qu’ils nous ont laissé, quel héritage conserver de leurs désespoirs mêlés? En s’approchant un peu plus, peut-être pourra-t-on voir apparaître une figure dominante, un rapport inhérent entre leur écriture et un ultime besoin de liberté.
L’écriture est une expérience extrême en ceci qu’elle exige de celui ou de celle qui la pratique une longue introspection afin d’excaver en profondeur son sujet, d’approcher au plus près les émotions qui le gouvernent, de tourner et retourner son objet maintes fois et sur tous ses côtés. L’écrivain se remet en question, emprunte les routes secondaires, met en lumière les multiples couches qui composent un même thème. C’est pour ça qu’il est si essentiel; il nous fait voir ce que bien souvent nous n’avions pas même aperçu.
Un trop-plein de lucidité
Il se pose ainsi en observateur du monde en aiguisant sa lucidité, parfois à un point tel qu’il ne remarque plus la poésie qui se dégage de l’ensemble; il n’a soudainement plus de perspectives. Les arêtes tranchantes de la réalité confrontent sans pitié ses idéaux et il se sent de plus en plus en décalage avec ce qui l’entoure. Il a perdu sa présence au monde. Alors il regrette de ne pouvoir être cet imbécile heureux qui contemple le déroulement des heures avec béatitude.
L’écrivain suicidé se frotte perpétuellement au grand mystère. Il écrit parce qu’il cherche des réponses, il veut combler ce vide vertigineux qu’est celui de se voir naître et mourir sans trouver de sens à ses souffrances et à ses joies. Il arrive qu’il écrive pour exorciser son angoisse devant sa finalité, d’autres fois son vertige aspire toute la substance de vitalité qui lui restait. Il ne supporte plus d’être un condamné en sursis. « Un homme qui risque de craindre que sa vie soit une errance absurde vers une mort certaine ne peut être heureux », exprime l’écrivain suédois Stig Dagerman dans son pamphlet Notre besoin de consolation est impossible à rassasier. Il conçoit la vie comme « un voyage imprévisible entre des lieux qui n’existent pas ». Le 4 novembre 1954, il s’enferme dans son garage et meurt au volant de sa voiture, asphyxié par les gaz d’échappement. Il a 31 ans.
L’esprit déformé par la dépression, l’écrivain qui intente à sa vie en est venu à croire qu’il n’est pas en cohérence avec la vie. Son intérieur se dissocie de l’extérieur que représentent les autres, les règles et les conventions. Toute sa vie, Virginia Woolf tentera de réconcilier les deux. « La mort était une tentative de communiquer, quand les gens sentaient qu’il leur était impossible d’atteindre ce centre qui, mystique, leur échappait; la proximité devenait séparation; l’extase s’estompait; on était seul. Il y avait un enlacement dans la mort », peut-on lire dans Mrs Dalloway. La nuit du 28 mars 1941, alors qu’à l’âge de 59 ans elle remplit ses poches de pierres et avance, résolue, dans les eaux de la rivière, elle est effrayée par l’idée de la folie. La mort devient son plus sûr rempart contre la déraison.
Pour l’écrivain qui se donne la mort, c’est parfois l’épuisement de la quête qui provoque sa défaite. Romain Gary a joué tout au long de sa vie avec les codes et a voulu tromper les apparences. Il s’est constitué un double, Émile Ajar, et a réussi l’exploit de remporter le prix Goncourt deux fois plutôt qu’une, et ainsi berner ses détracteurs. Mais son regard sur les choses n’en restait pas moins cynique et désabusé. Romain Gary, celui qui a franchi les limites de l’identité, ne voyait plus d’intérêt à continuer. Dans sa courte lettre de suicide, il dit : « Peut-être faut-il chercher la réponse dans le titre de mon ouvrage autobiographique La nuit sera calme et dans les derniers mots de mon dernier roman : “car on ne saurait mieux dire”. Je me suis enfin exprimé entièrement. » Le 2 décembre 1980, à l’âge de 66 ans, il s’étend sur son lit et se tire une balle dans la bouche avec un revolver Smith & Wesson de calibre 38. Son suicide constitue pour lui l’achèvement d’une œuvre.
L’écrivain cherche à plaire à son lecteur, même quand il s’en défend. C’est-à-dire que s’il écrit, c’est qu’il souhaite aller à la rencontre de quelqu’un, parler avec lui, créer des liens. Son œuvre est la mise à nu de ses territoires les plus secrets. En étant publié, il se rend au regard du critique et du lecteur. Et quand la perception de l’autre sur lui heurte sa sensibilité, celle-là même qui lui permet de montrer ses plus grandes vulnérabilités, il perd ses forces. Nelly Arcan tentera de casser l’image de la fille parfaite, puis celle de la femme fatale, et de toutes celles qu’on voulait lui faire porter. En même temps qu’elle veut casser le miroir, elle a un immense besoin du regard d’autrui. La dichotomie entre ses convictions et la nécessité de plaire aura raison de son désir d’exister. « On finit tous par mourir de la discordance de nos amours », écrit Nelly Arcan dans Putain. De toute évidence, elle n’a pas su assez incarner l’amour qu’elle se devait à elle-même. Le 24 septembre 2009, à l’âge de 36 ans, elle se pend dans son appartement du Plateau-Mont-Royal. Elle se supprime définitivement au regard de l’autre.
Avant la fin
Celui qui écrivait comme un forcené pour comprendre à tout prix a fini par voir le ciel non pas comme un espace de liberté mais comme une chape de plomb qui lui tombait sur la tête. Il a oublié que l’immensité avalante recèle aussi des trouées qui, pour peu qu’on s’y abandonne, rendent possibles nos aspirations. Que peuvent nous apporter les œuvres de ces fissurés de l’âme à part un pessimisme noir et abscons? Certainement une intensité fabuleuse qui est apte à nous donner l’élan d’entrer avec entièreté dans l’existence; l’occasion d’exorciser nos propres démons pour se défaire de notre pesanteur; la bravoure de regarder le grand mystère dans les yeux en constatant que l’aventure n’est que plus merveilleuse justement, parce que nous ne faisons que passer.