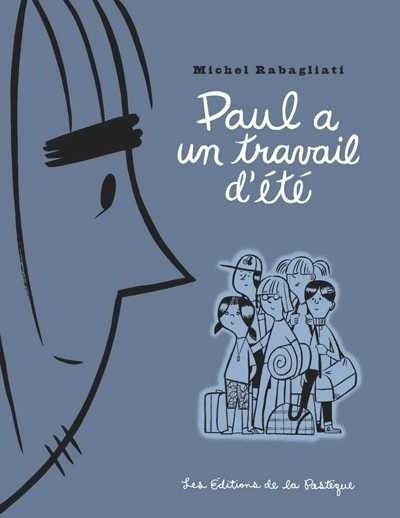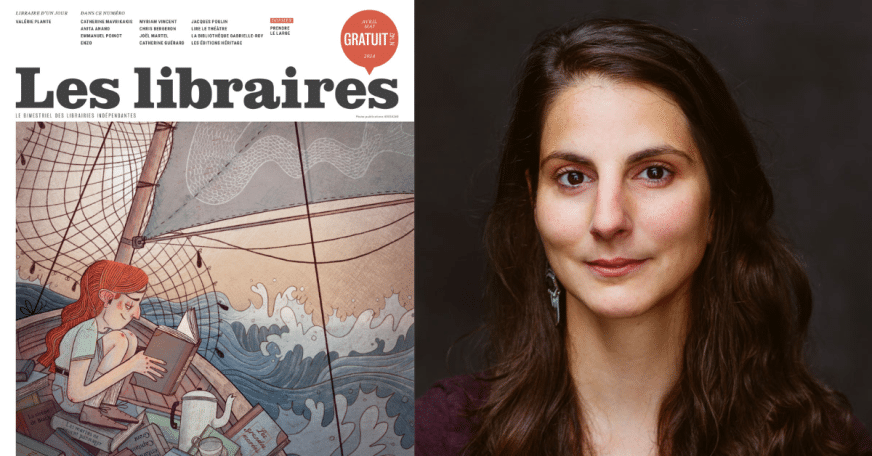Voici quelques faits inusités sur la traduction.
Une corde supplémentaire à l’arc de Michel Tremblay
Le fait est méconnu : Michel Tremblayest également traducteur. Effectivement, le dramaturge a notamment traduit et adapté pour le Québec Lysistrata d’Aristophane, L’effet des rayons gamma sur les vieux garçons et Et mademoiselle Roberge boit un peu de Paul Zindel, Le gars de Québec (d’après la pièce Le Révizor) de Nicolas Gogol et Oncle Vania d’Anton Tchekhov. D’autres pièces de Dario Fo, Tennessee Williams et Edward Albee ont également pris vie sous sa plume.
L’autotraduction : des grands l’ont fait (et l’un en a bien ri)
Ils ne sont pas nombreux à avoir osé, mais ce sont tous des auteurs d’exception : Nancy Huston, Samuel Beckett, Romain Gary, Boris Vian, Lori Saint-Martin, Vladimir Nabokov et Julien Green. De quelle audace est-il question? D’avoir traduit eux-mêmes leurs livres! « Le problème, voyez-vous, c’est que les langues ne sont pas seulement des langues; ce sont aussi des world views, c’est-à-dire des façons de voir et de comprendre le monde. Il y a de l’intraduisible là-dedans… », a dit à ce sujet Nancy Huston. On pourrait donc parler de « double écriture », puisque la traduction de leurs œuvres devient pour certains une façon d’en améliorer la version originale (Huston), d’adapter le texte au contexte (Gary) ou de conserver le rythme du premier jet (Beckett). Pour la Québécoise Lori Saint-Martin, c’est une question de liberté : « J’ai aussi fait un peu d’autotraduction, avec presque autant de liberté que lors de l’écriture de l’original : je me permets des écarts qu’aucun autre traducteur ne pourrait s’autoriser. »Et, il y a cette histoire cocasse à ne pas passer sous silence : Boris Vian qui, après avoir écrit un polar sous le pseudonyme de Vernon Sullivan (un supposé mulâtre américain de 26 ans), en a signé de son propre patronyme la traduction, J’irai cracher sur vos tombes, glissant ici et là calques et américanismes pour rendre le tout crédible. Le livre fut un best-seller en 1947, avant d’être interdit de vente en France et en Angleterre. Avec l’autotraduction, la création ne saurait être plus au centre de la traduction.
Subventionner la traduction
Au Québec, les éditeurs peuvent percevoir une subvention de la part du Conseil des arts du Canada pour la traduction d’une œuvre canadienne anglophone par un Canadien francophone (et vice-versa). Cette subvention, qui rémunère au mot fait en sorte que tout traducteur est payé pour son labeur, peu importe le succès que le livre traduit remportera. Ce qui n’est pas le cas de leurs homologues de France qui, eux, sont payés soit avec des à-valoir, soit selon une rétribution de droits d’auteurs. Ainsi, le traducteur d’un best-seller sera mieux payé que celui d’un roman qui n’a pas su se faufiler dans les palmarès de ventes. La SODEC offre également de l’aide pour la traduction, notamment grâce à son Programme d’aide à l’exportation et au rayonnement culturel. Fait intéressant, au Conseil des arts, les tarifs au mot ne sont pas les mêmes selon le genre traduit : 0,18$ pour les traductions de fictions ou d’essais, mais 0,20$ pour la poésie.
Quant à nos Québécois anglophones…
Bien que leurs livres aient beaucoup été traduits, les écrivains Yann Martel et Louise Pennyne se retrouvent pas dans notre top 5 puisqu’ils écrivent d’abord en anglais. À titre d’exemple, Still Life de Louise Penny a été traduit en vingt-cinq langues, dont le français chez Flammarion, tandis que le roman L’histoire de Pi (XYZ) de Yann Martel a été traduit en près de cinquante langues. Notons que l’adaptation cinématographique par le réalisateur Ang Lee y est sûrement pour quelque chose! Autre fait particulier en ce qui concerne Yann Martel : ce sont ses parents, Émile Martel et Nicole Perron-Martel, qui traduisent ses livres de l’anglais vers sa langue maternelle, le français. L’anglais a été la langue des études de l’auteur. Le couple, apprenait-on dans une entrevue accordée à la revue Les libraires, à l’automne 2010, travaille ainsi : chacun de son côté traduit le manuscrit en entier. Ensuite, les deux partenaires refont l’exercice, mais ensemble, cette fois. Finalement, les traducteurs relisent le résultat avec l’auteur pour peaufiner le tout.
Traduire entre lacs et montages : le Centre international de traduction littéraire de Banff
Il existe un lieu qui permet de s’adonner à la pratique professionnelle de la traduction littéraire dans une ambiance agréable et sans interruption. Au cœur des montagnes, dans un centre de villégiature à couper le souffle, le Centre international de traduction littéraire de Banff (CITLB) propose annuellement à quinze traducteurs de venir passer trois semaines dans ses décors somptueux. Il est également possible, pour les traducteurs en résidence, de bénéficier d’une résidence conjointe, avec l’auteur qu’ils traduisent. En guise d’exemple, notons qu’en 2012, les auteurs Margaret Atwood, Hélène Rioux et Jeffrey Yang y étaient. Cette résidence assure des rencontres de qualité entre les traducteurs, qui en sont à des stades différents de leur carrière, leur permet de nouer des liens étroits avec les auteurs publiés et rend possible l’échange de judicieux conseils entre professionnels de la traduction.
Un prix pour la traduction en l’honneur de John Glassco
Écrivain et traducteur réputé, John Glassco (1909-1981) est celui à qui l’on doit la traduction en anglais du journal et de toute la poésie de Saint-Denys Garneau. En son honneur, un prix (1 000$ en bourse et une adhésion à l’Association des traducteurs et traductrices littéraires du Canada) est décerné tous les ans depuis 1982, pour souligner à la fois l’excellence en traduction littéraire, mais aussi le dynamisme de la relève, que ce soit dans le genre du roman adulte ou jeunesse, de la poésie, de l’essai ou du théâtre. En 2013, c’est Madeleine Stratford qui a reçu les lauriers pour sa version en français du recueil de poésie Ce qu’il faut dire à des fissures (L’Oreille du loup), de l’auteure uruguayenne Tatiana Oroño.
9e art et traduction : des phylactères étroits au vocabulaire sonore
Selon Frédéric Gauthier, éditeur de La Pastèque, la typographie est un élément important à considérer lorsqu’on traduit de la BD : « En effet, beaucoup de nos livres ont des typos à la main et ça pose un défi chaque fois. Certains éditeurs étrangers vont engager un relettreur pour les traductions. » De plus, il arrive fréquemment que les phylactères soient trop petits, puisque les traductions en français nécessitent plus de mots que la version originale. Mais ce n’est pas tout. Lorsque l’image et le texte ne font qu’un, les éditeurs ont de quoi se creuser la tête. Selon une étude intitulée La traduction des onomatopées dans la bande dessinée, de Selja Seppälä, de l’Université de Genève, la traduction des onomatopées devient parfois un problème complexe pour les traducteurs. Contrairement à ce qu’on pourrait croire, les onomatopées ne sont pas universelles (un chat fait « meow » en anglais, mais « miaou » en français; l’horloge fait « tick » pour Shakespeare et plutôt « tic tac » pour Molière). De plus, il faut parfois considérer l’onomatopée non seulement comme un mot à traduire, mais également comme une entité graphique qu’on ne peut soustraire au texte lorsque le mot est inscrit directement dans l’image. Profitons-en pour noter au passage que la BD québécoise s’exporte bien, surtout du côté de La Pastèque, puisque Paul a un travail d’été de Michel Rabagliati a été traduit en six langues; Jane, le renard et moi de Fanny Britt et Isabelle Arsenault, en sept langues; Le lion et l’oiseau de Marianne Dubuc, en neuf langues.