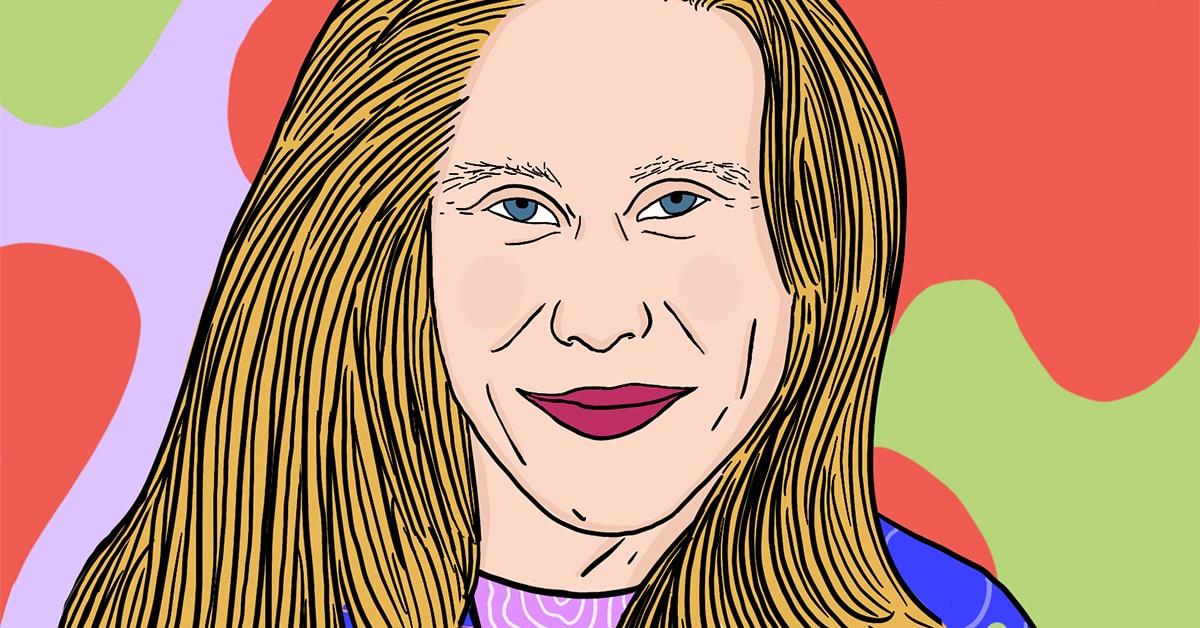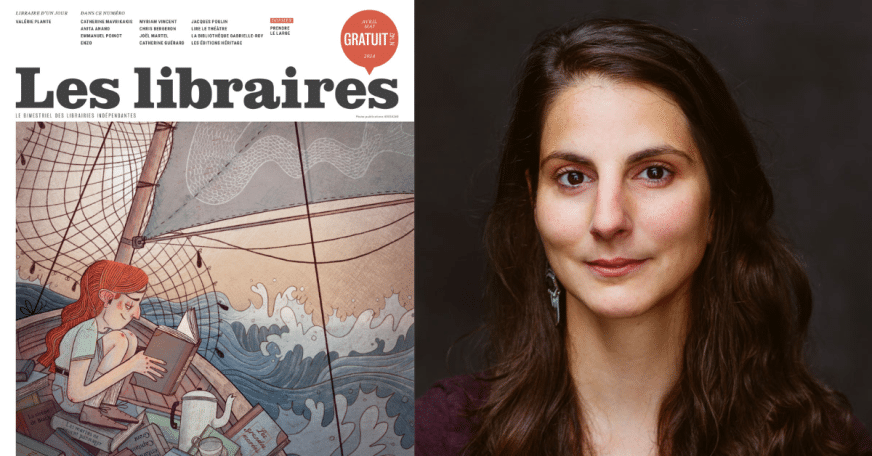À l’adolescence, les groupes parascolaires au sein desquels je militais pour des causes écologistes utilisaient des outils artistiques, visuels ou théâtraux qui m’intéressaient sans me convaincre. M’informant de mieux en mieux sur le monde, j’aurais aimé le voir changer radicalement. Pourtant, les lectures qui me plaisaient n’allaient pas dans le sens d’une incarnation romancée des valeurs que je faisais miennes. J’exigeais de la littérature qu’elle me déroute ou m’élève. Avec beaucoup de maladresse, j’informais fréquemment les gens « engagés » autour de moi que l’art qui leur plaisait m’ennuyait.
Le clivage entre ces deux piliers de mon existence m’occupait beaucoup. Je me sentais coupable… De cette incongruité peut-être ; mais aussi, coupable en général, comme un artiste, dira-t-on. Je retiens d’une conversation importante avec mon amie l’autrice Chloé Savoie-Bernard, datant du début de nos études universitaires, que c’est un sentiment fort du parcours vers l’écriture. Elle et moi en étions transis. Nous comprenions déjà que la lecture ouvre les yeux, développe l’empathie, permet de se projeter dans d’autres vies que la sienne. Tout cela est vrai, mais les études littéraires affinent notre sensibilité à la forme, et nous poussent à voir le rapport entre lecture et valeurs d’une toute autre façon. On se rend progressivement compte qu’il est possible de discourir de la haute moralité… avec la plus grande perversion. Ou de sauver la veuve et l’orphelin… pour les mettre aux fers. D’étouffer ses proches sous le poids d’une rationalité scientifique pourtant irréprochable. Question de forme. En contrepartie, le chemin pour contourner les occasions de se soupçonner du pire devient périlleux! Quant à l’art qui a le malheur de se dire effrontément politique, eh bien, nous haussions les épaules…
J’ai expérimenté, comme Chloé dans les nouvelles qui allaient devenir Des femmes savantes, la création de personnages détachés des différentes facettes de ma vie. Ils exposaient des failles, sans être clairement situés sur la ligne qui va de l’innocence à la culpabilité. Le mélange de dérision, de tendresse et de cruauté que Chloé savait doser me ravissait. Ces personnages de papier nous permettaient de changer de point de vue, de soulager un peu de pression, de reporter le moment de nous juger définitivement. En même temps, s’il m’avait fallu faire un travail similaire avec un personnage tiré de la scène sociale et politique (nous avancions vers le printemps érable), impossible. J’aurais été trop méchant.
C’est à la même époque que j’ai vu la version française d’une pièce d’Annabel Soutar, une dramaturge anglophone de Montréal. Sexy béton portait sur l’effondrement du viaduc de la Concorde, en septembre 2006. J’ai été soufflé, comme on dirait : le vent a soufflé la flamme. Que dire? Je m’étais tellement habitué à me méfier de l’art dit politique que j’avais des phrases toutes faites en banque (voir l’ouverture de ce texte). Or Sexy béton ne me laissait pas de prise.
Plus tard, j’ai vu Fredy autour de l’affaire Villanueva, J’aime Hydro porté par Christine Beaulieu et qui a conquis le cœur de la province, présentant plus largement Porte Parole (la compagnie de Soutar) chez les francophones, puis L’assemblée. Toutes pièces qui m’ont beaucoup impressionné, et dont j’ai lu avec intérêt les échos critiques dans les médias. Ça donne souvent quelque chose comme : « il y a tant d’informations, tant de personnages tous complexes, tant d’enjeux accumulés qu’on ne sait plus très bien, au final, quelle leçon politique tirer de ce théâtre supposément politique. »
Voilà. Ne nous empêchons-nous pas d’apprécier l’art politique précisément en décidant un peu vite qu’il faudrait que cet art-là soit une machine à trancher sur des sujets délicats? D’un côté, lui en vouloir de ne pas nous fournir des métaphores du réel, pour nous en sauver. De l’autre, lui en vouloir de nous emmener sur le terrain du réel sans nous dire pour qui voter. Et le savant mélange de dérision, de tendresse et de cruauté qu’on aimait tant chez Chloé, on ne le goûte plus?
Je le dis maintenant avec assurance : l’ambivalence critique devant ce théâtre me réjouit. Soutar travaille avec des citations, des extraits d’entrevue. Du discours au fond, qu’elle cherche à organiser, à mettre en forme. Pour vous initier à sa démarche, je vous conseille la lecture de The Watershed (Talonbooks), de 2012, où la dramaturge se met en scène, ainsi que ses enfants qu’elle tente d’initier à la vie citoyenne et au travail d’enquête. (La pièce a aussi été jouée en français, dans une traduction de Fanny Britt qui n’a pas été publiée à ce jour.) Tout est déclenché par une loi omnibus du règne Harper, coupant discrètement sur les aires jusqu’alors protégées pour fin d’étude sur les effets des changements climatiques. La dramaturge décide d’en faire le sujet de la pièce qui lui a été commandée… par le gouvernement, pour les Jeux panaméricains.
Soutar enseigne sans donner de leçon, montre les impasses. Elle donne la parole aux travailleurs et aux travailleuses des sables bitumineux comme aux militants et aux militantes écologistes, aux membres plus à droite de sa propre famille, aux scientifiques… L’oreille est un organe délicat. L’exposer aux paroles du monde sans se protéger le tympan en emballant les divergences dans la ouate du mépris, c’est une aventure qui aurait secoué l’adolescent que j’étais. Soutar et Porte Parole pratiquent l’art du découpage et du collage, à des milles des surréalistes. Ils exposent.
Difficile de décrire la fin d’une telle pièce sans que ça ressemble à : elle trouve un moyen terme. Un juste milieu? On voit les pour et les contre? Non. Loin de cette mollesse-là. C’est plutôt dur en fait, plutôt exigeant, plutôt courageux, de faire saillir les aspérités du monde. Ça coupe. Ça ne tranchera pas votre sentiment de culpabilité, je vous le garantis. Mais ça rend plus fort. Essayez.
Jeannot Clair
Jeannot Clair a été directeur littéraire chez Triptyque de 2015 à 2018 et est présentement le rédacteur en chef de la revue Mœbius — il avait d’ailleurs participé à sa refonte en 2017. Aussi traducteur, il a signé la traduction du livre Les argonautes de Maggie Nelson sous le nom de Jean-Michel Théroux. Récemment, il a traduit For Today I Am a Boy de Kim Fu, paru chez Héliotrope. Il s’intéresse notamment aux univers queer et anime des balados sur la littérature et le cinéma.
Illustration : © Emilie Morneau