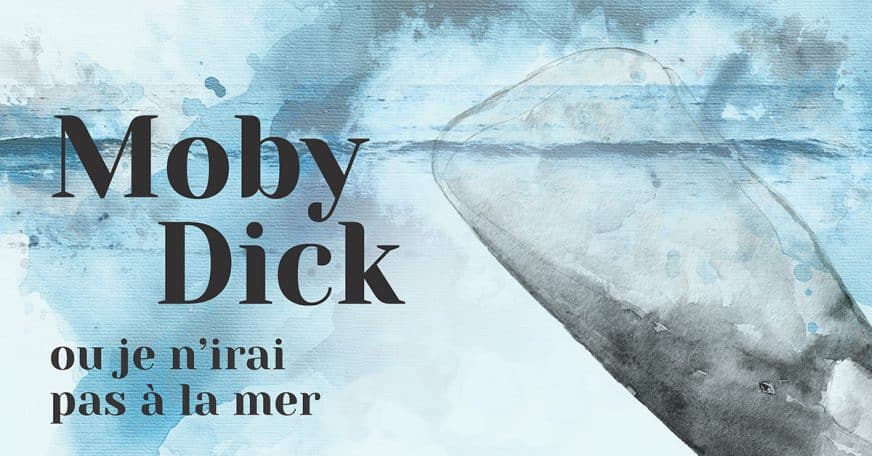Si le très célébré septuagénaire new-yorkais a récemment publié un roman mettant en scène quatre vies potentielles pour une seule et même personne (4321, Actes Sud/Leméac), cela n’est certes pas le fruit du hasard, un mot que par ailleurs il abhorre, mais bien plutôt la démonstration romanesque de ce qu’il conviendrait peut-être d’appeler une philosophie, à savoir la mise en évidence de l’infini des possibilités offertes par la vie elle-même au premier venu, lequel par contre se doit toujours de composer avec un ensemble de données primordiales qui n’ont quant à elles rien d’évident.
De son propre aveu, la plupart des romans de Paul Auster adoptent la forme de la biographie de quelqu’un fournissant des réponses qui n’en sont pas à des questions que personne n’a posées. Cette passion pour les déterminismes, doublée d’un sens inné de la conjoncture et de l’anecdote, lui aura bien sûr valu nombre de bons coups littéraires, à commencer par cette fameuse Trilogie new-yorkaise (Babel), dont l’amplitude relève sinon de l’exploit, assurément du tour de force. C’est pourtant ailleurs que prend sa source la matière première de l’écriture, non dans cette virtuosité narrative que l’on sait, ni dans cette constante recherche de révélation, ni dans ces somptueux déploiements de synchronicité.
Dans une série d’entretiens réalisés avec Gérard de Cortanze, Auster nous dit, en réponse à la question « Tous les livres ne viennent-ils pas du passé? » :
« Oui. Certainement. On garde quantité de souvenirs qui sont parfois profondément enterrés. C’est le processus de l’écriture qui fait remonter à la surface ces petits morceaux de souvenirs. Mais on n’en est pas conscient. On ne sait pas d’où ils viennent. On ne peut les focaliser. De temps en temps, on peut en retracer le parcours, remonter jusqu’à l’origine. Il faut beaucoup de chance et suffisamment de matériaux surgis de ces ténèbres. L’écrivain naît de ces sources enfouies1. »
La mort du père d’Auster, événement traumatique s’il en est, lui aura au moins fourni l’élan nécessaire pour s’atteler sérieusement à la tâche. Avec L’invention de la solitude (Babel), le livre qui en résulta, Auster posait véritablement les jalons d’une œuvre à venir qui serait irrémédiablement placée sous le signe de la mémoire. Le caractère particulièrement touchant de ce premier livre affirmait d’ores et déjà la puissance allusive de celui-ci : ni hommage ni commémoration, mais plutôt mosaïque de souvenirs entrecoupés de réflexions sur le sens ou même la possibilité d’un sens à donner à ces bribes, il s’agit moins d’un mausolée que du socle d’un art littéraire en train de s’ériger. Les passages faisant état de la futilité d’une vie humaine, thème pour le moins convenu, on en conviendra aisément, y sont d’une lucidité confondante. De la même façon, l’énoncé de concepts forts tels que la nostalgie du présent, sentiment de décalage temporel préfigurant tout en accentuant la distanciation et la mise en perspective des événements de l’actualité la plus immédiate renforce cette impression d’un petit quelque chose de plus, d’une profondeur qui dépasse la fiction.
Que l’on songe à Seul dans le noir, à Dans le scriptorium, à La musique du hasard, à Invisible ou même à Mr. Vertigo (Babel), pour ne nommer que ceux-là, les romans de Paul Auster jonglent habilement avec des leitmotivs liés à la mémoire. Personnages amnésiques ou au contraire enlisés dans un passé trouble, héros en quête de la rémission de leurs fautes, uchronies fantasmées dans l’oisiveté d’une immobilité confinant au délire mnémonique, et toujours cette nostalgie ontologique des êtres, des lieux ou des époques.
Nostalgie, donc, mais pas forcément mélancolique ni même alanguie. « Il est pourtant des choses du temps jadis qui te manquent, même si tu n’as aucun désir de voir revenir ces jours anciens », écrit-il dans Chronique d’hiver (Babel). Telle est bien cette ambivalence de la nostalgie, cette impalpable nuance entre remords et regret, les reflets dorés du passé n’étant le plus souvent que décalques plaqués or.
Écrivain de la mémoire, théoricien de la nostalgie, analyste des contingences, Paul Auster, peut-être l’un des derniers grands romanciers américains du XXe siècle, poursuit une œuvre portant les stigmates de l’implacabilité du Temps.
1. Gérard de Cortanze et Paul Auster, La solitude du labyrinthe, Actes Sud, 1997, p. 95.