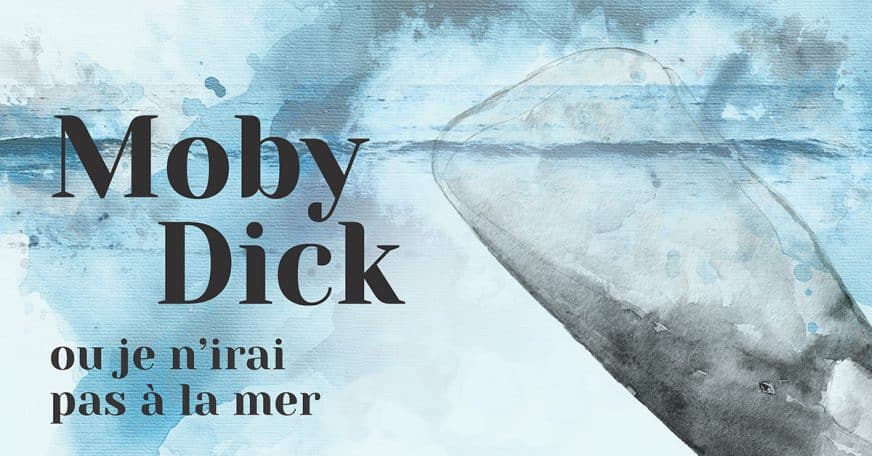Ils sont là, parmi nous, les pieds bien dans la marge et la tête on ne sait où. Tous autant qu’ils sont, les fêlés, les tordus, les indomptables – qu’ils le soient de leur plein gré ou bien malgré eux – se retrouvent le plus souvent regroupés dans ce qui ressemble à une faune bigarrée d’électrons libres dont le seul point commun serait d’être à l’extérieur du troupeau, d’agir et d’exister autrement que les gens normaux.
Cette multitude, si fourmillante de diversités, est en effet difficile à présenter en un seul bloc, en un monolithe sans aspérités. Mais les quelques titres dont il sera question dans le présent article sauront, à eux quatre, et sans nul doute, illustrer cette marginalité commune autantque son essentiel éclectisme. Rassemblés ici sous le titre « Originaux et détraqués » (que nous empruntons au merveilleux ouvrage de Louis Fréchette, malheureusement épuisé, dans lequel le poète brossait les portraits d’une douzaine de singuliers zigotos qui habitaient la grande région de Québec en son temps), les olibrius et les zinzins qui nous intéressent expriment, à leur manière, différentes facettes de la condition humaine que trop souvent la soi-disant normalité refoule et étouffe à grand renfort d’inhibitions. Bref, ils nous renvoient un reflet radical, souvent caricatural, de nos obsessions, de notre absurdité et des moyens que nous déployons sans cesse afin de contenir tant bien que mal cette difficulté d’être qui constitue le lot d’à peu près tout le monde.
Le contre-courant positif
Docteur en littérature et civilisation françaises, Michel Dansel est aussi un fin amateur de bizarreries et d’insolite. Son champ d’intérêt : l’excentricité. Et dans ce pavé, justement intitulé Les excentriques (Robert Laffont), Dansel donne à voir les spécimens qui composent sa collection. Conscient de la vastitude du sujet et de l’impossibilité d’être tout à fait exhaustif, l’auteur a toutefois accouché d’un ouvrage largement documenté, avec érudition, et dans lequel se déploie un panorama de « cas », anonymes ou célèbres, qui sauront satisfaire les curieux et les amateurs de singularités. Son répertoire se concentre plus particulièrement sur le monde des arts et des lettres, l’auteur cherchant à démontrer ce que l’excentricité de certains comportements injecte d’énergie positive et de nouveaux horizons à une société qui, autrement, marinerait de façon durable dans une trop insipide banalité. Se côtoient, entre autres, dans les pages de ce touffu inventaire, les figures d’Érostrate et de Michael Jackson, celles de Cadet Roussel et d’Alfred Jarry et tant d’autres.
Les malades imaginés
Il y a quelques années, paraissait en librairie un génial recueil de portraits intitulé Les idiots (petites vies), création décalée d’un nommé Ermanno Cavazzoni. Cet homme de lettres italien, dont le premier roman, Le poème des lunatiques, fut adapté au cinéma par nul autre que Federico Fellini, qui signait alors son dernier film, récidive avec une nouvelle brochette de stupéfiants ostrogots mis en page sous le titre Les écrivains inutiles. Cavazzoni révèle avec ce nouveau livre des existences insoupçonnées, des caractères burlesques et entêtés, un authentique chapelet de « perles » comportementales, portraits d’écrivains insolites et, comme disait Brassens, rivalisant de tares, pris à partie, tous autant qu’ils sont, par les affres de la création et de la vie. Cette audacieuse plume à l’humour singulier est accessible au public francophone grâce à la tout aussi audacieuse maison d’édition Attila, qui n’en est pas à une éblouissante loufoquerie près!
Le fou loquace
En effet, Attila publiait, le printemps dernier, la réédition d’un livre étonnant, au titre long, Ma mère, musicienne, est morte de maladie maligne à minuit, mardi à mercredi, au milieu du mois de mai mille977 au mouroir Memorial à Manhattan, œuvre signée de la main d’un certain Louis Wolfson. Ce dernier avait fait paraître chez Gallimard, en 1970, un ouvrage intitulé Le schizo et les langues et qu’avaient encensé à l’époque les Deleuze, Foucault, Auster et autres Queneau de ce monde. Il faut savoir, bien entendu, que le Wolfson en question a été diagnostiqué schizophrène et qu’il abhorre avec une rare véhémence la langue anglaise. Natif de New York, il s’est mis à l’étude de l’hébreu, du russe, de l’allemand, du français, etc., pimentant de façon plutôt excessive son rapport au monde passablement déroutant, qu’il avait d’ailleurs déjà démontré dans l’essai cité plus haut.
Les pages de Ma mère, musicienne,… nous convient, quant à elles, à suivre le quotidien de Wolfson pendant les deux années qu’aura duré le cancer irrémédiable de sa mère. Véritable patate chaude littéraire, ce « journal » écrit dans un français aussi déconcertant que génialement bancal laisse son lecteur ébaubi. L’état dans lequel se trouve la langue écrite de Louis Wolfson permet au lecteur de prendre la pleine mesure de l’expérience vécue par ce dernier, de littéralement regarder le monde par sa lorgnette. Entre son obsession pour les paris et les courses de chevaux et l’expression de sa bouillante et quasi célinienne détestation de l’humanité (découlant d’une conscience aiguë de notre insignifiance cosmique), l’auteur relate son quotidien et celui de sa mère avec force détails rapportés tantôt de manière froide et clinique, tantôt avec les accents pathétiques d’une vibrante indignation. Bref, que nous aimions ou pas, Ma mère, musicienne,… demeure une lecture qui n’a pas son pareil. Quant à Louis Wolfson, il vit toujours, à Porto Rico, où il retravaille le texte et a abandonné les champs de courses au profit de la loterie électronique (il y a même remporté un gros lot!). Son éditeur résume ainsi l’essentiel de ses activités « Désormais, relativement riche, attendant la fin du monde, il écrit toujours ».
Voir la vie d’un peu plus haut
Quelque deux ans après L’humoriste, Georges Picard publiait un nouveau livre cet automne, aux éditions José Corti. Celui qui nous avait habitués à une écriture somptueuse suivant le fil d’une certaine errance dans le temps et dans l’espace continue son avancée dans la même veine avec ce nouveau roman. Une manière de philosophie en dehors de la philosophie. Le narrateur de L’hurluberlu, le titre en question, assume la condition qui est la sienne, celle justement d’hurluberlu, en nous servant d’emblée la définition de ce mot. Sans vouloir quitter tout à fait le monde, il le garde à une certaine distance en s’installant sur un toit parisien. Au fil de ses pérégrinations, de ses rencontres, de ses amitiés et de ses souvenirs, il définit sa position face à la débilité du monde, toute pétrie de sensibilité et de lucidité, sans hargne. Un parti pris qu’il résume ainsi : « Comme le monde serait ennuyeux si on se contentait de le prendre au pied de la lettre! J’ai toujours pensé qu’il fallait dépayser les choses pour se dépayser soi-même. » L’hurluberlu, un ajout de qualité à l’œuvre d’exception de Georges Picard.