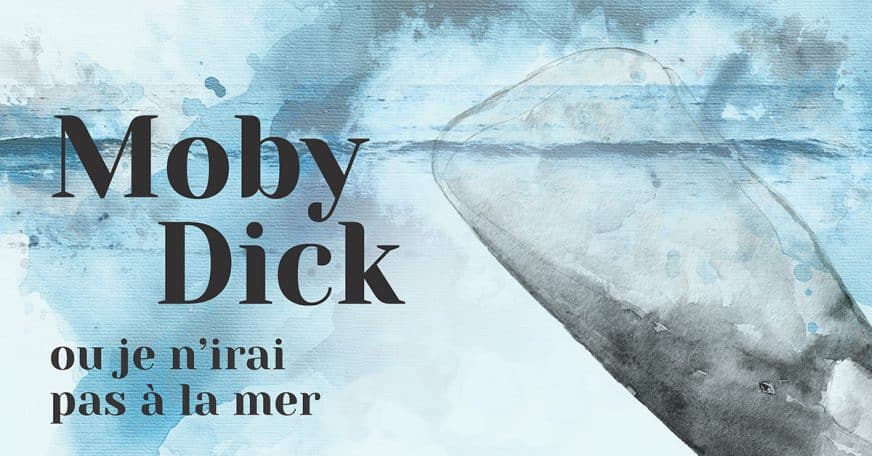Certains écrivains ont réussi, à travers leurs œuvres, à magnifier la nature et à nous faire la preuve de sa splendeur. Si bien qu’en parcourant leurs écrits, on ne doute plus de l’importance du paysage, qui n’est pas que simple apparence bucolique, mais porteur d’un sens beaucoup plus profond. Éminemment vivante, cette nature devient le lieu d’où tout part, y compris nous, qui sommes intimement reliés à sa force vive.
Depuis Henry David Thoreau, la littérature américaine s’est pourvue d’un nouveau genre appelé le nature writing, qui met le paysage au premier plan soit par l’intermédiaire du récit, soit par celui du roman et qui place d’emblée la nature au rang de personnage. Walden ou La vie dans les bois (1854) de Thoreau est reconnu comme l’œuvre fondatrice de ce courant qui, au-delà de l’écologie, crée des ramifications vers l’éthique et la philosophie et prône la simplicité volontaire avant la lettre tout en critiquant le système social et économique. Ni roman ni autobiographie à proprement parler, ce livre raconte les observations de Thoreau pendant son retrait dans la forêt du Massachusetts où il vécut seul dans une cabane pendant un peu plus de deux ans. Émane de cette solitude un besoin de vérité que le compagnonnage de la nature vient amplifier en même temps qu’elle sait y répondre. « Une fois que l’homme s’est procuré l’indispensable, il existe une autre alternative que celle de se procurer les superfluités ; et c’est de s’aventurer dans la vie présente. » Pour cela, il faut marcher dans la boue, sentir la terre, écouter l’oiseau, suivre le rythme du ruisseau, s’enfoncer dans le bois pour y suivre la trace des animaux non domestiqués, y voir le déploiement des arbres, il faut traverser de l’intérieur le passage des saisons, s’imprégner de ses mouvements, être attentifs à ses prodigalités. C’est surtout sans a priori qu’il faut entrer en contact avec la nature, car « c’est seulement quand nous oublions toutes nos connaissances que nous commençons à savoir », écrira Thoreau dans son Journal (1906) où il consigne ses réflexions.
Les enseignements
Sue Hubbell fera les mêmes constats quand elle décidera de quitter la ville et son poste de bibliothécaire pour s’installer sur une ferme dans les monts Ozark au Missouri où elle entreprendra l’élevage d’abeilles à miel. Elle qui fit ses études en biologie et qui est fille de biologiste se rendra vite compte que ses apprentissages théoriques sont bien éloignés de l’existence réelle et matérielle qui occupe la vie sauvage. Dans Une année à la campagne (1983), elle fait état des tâches quotidiennes qui sont assujetties au cycle de la nature, à l’imprévisibilité de la température, aux lois tacites qui gouvernent le règne animal. Rapidement en découle une prise de conscience qui s’étend bien au-delà de sa situation et de son champ. « Mais étant un être humain, je suis nantie d’un cerveau qui me permet de m’apercevoir que lorsque je manipule et modifie n’importe quelle partie du cercle, il y a des répercussions sur tout l’ensemble. » La leçon qu’engendre ce bilan transformera jusqu’à sa façon de percevoir sa place dans le monde et d’en appréhender les contours et le centre.
Une autre émule de Thoreau est Annie Dillard, qui a d’ailleurs consacré une thèse à son Walden. Dans Pèlerinage à Tinker Creek (1974), l’auteure contemple le paysage de la Virginie et en exhume ses secrets et ses beautés. Encore une fois, le récit s’ancre entièrement dans une nature à la fois simple et complexe, capable de faire advenir une signification, un sens qui englobe tant la matérialité que la spiritualité de l’être, tout en prenant plaisir à se dérober quand on tente de débusquer tous ses mystères. « La seule réponse, probablement, c’est que la beauté et la grâce se manifestent, que l’on soit là ou non pour les vouloir ou en sentir instinctivement la présence. Le moins que l’on puisse faire, c’est essayer de se trouver là. » Dillard se nourrit des enseignements du paysage qui a pour seul souci d’exécuter ses mouvements et d’obéir à ses lois, sans vanité. Tout ce qui échappe à cette immuabilité n’a pas sa raison d’être. La nature ne se pense pas, elle se vit, avec la puissance des torrents, la stabilité des montagnes, la tranquillité de l’aube, la fureur des vents et le goût de la pluie. La terre n’a d’égale qu’elle-même et ne se mesure à rien d’autre. Dillard sait en saisir toute la portée et transcrire poétiquement tout le possible et l’impossible, du trivial au miraculeux, que la nature endosse.
Mise à l’épreuve
C’est quelque part dans une zone éloignée du Montana, dans la vallée du Yaak qui se trouve à quelques kilomètres du Canada, que Rick Bass, géologue de profession, et sa femme vivent un premier hiver sans téléphone ni électricité, avec pour seul repère un temps allongé où prédominent le froid, le silence et l’isolement. À l’issue des conditions parfois extrêmes qui jalonnent le cours des jours, il y a un calme impérieux et une vie de contemplation. Dans une narration qui ne force pas l’exaltation, Rick Bass, dans Winter (1998), décrit le bois à couper, le pari de la première neige, la corde que les habitants installent autour de leur maison pour pouvoir la situer dans les cas de tempête. D’ailleurs, le nom même de la vallée semble ironiser sur son propre sort : Yaak signifie « flèche » en langue kootenai, là où pourtant e balise ne permet de différencier le paysage. Cet hiver prend également une autre dimension pour ceux qui le vivent au jour le jour. Son inactivité apparente est le temps du repos, du ressourcement nécessaire à ce qui suivra. L’hiver est vécu comme une expérience intime qui remplit autant qu’elle délivre. « Tout ce dont je suis coupable est pardonné quand tombe la neige. Je me sens puissant. Dans les villes, je me sens faible et étiolé, mais ici dans les champs, dans la neige, je suis comme un animal — incapable de contrôler mes émotions, mes bonheurs et mes fureurs, mais libre d’aimer la neige […], la regardant tout effacer jusqu’à ce qu’il ne fasse plus ni jour ni nuit. » Ce manque de repères, s’il peut apparaître effrayant, à celui qui habite le territoire. Car si aucune indication ne montre le chemin, c’est que vous êtes totalement libre d’inventer le vôtre.
C’est probablement parce que la nature offre, pour peu qu’on veuille les voir, plusieurs leçons serties d’art, en même temps qu’elle n’exige rien de vous sinon que d’en prendre soin, que les écrivains aiment la côtoyer, l’habiter. Quand ils la transposent sur le papier, ils se savent perdus d’avance, ils savent que son éclat et sa magnificence vont au-delà des mots. Mais leurs efforts pour dire le sublime sont parfois, et malgré tout, parmi les plus belles pages de la littérature.
Gallmeister, éditeur de nature writing
Les éditions françaises Gallmeister, créées en 2005, consacrent une collection complète au nature writing. Elle donne ainsi accès en français à plusieurs titres américains appartenant au genre, car c’est une littérature que les États-Unis produisent beaucoup et affectionnent particulièrement. Edward Abbey, Jamey Bradbury, Kathleen Dean Moore, Thomas McGuane, John Gierach, Roderick Haig-Brown, David Vann, John D. Voelker, Pete Fromm sont quelques écrivains qui figurent à leur catalogue et qui mettent le paysage au coeur de leurs récits.