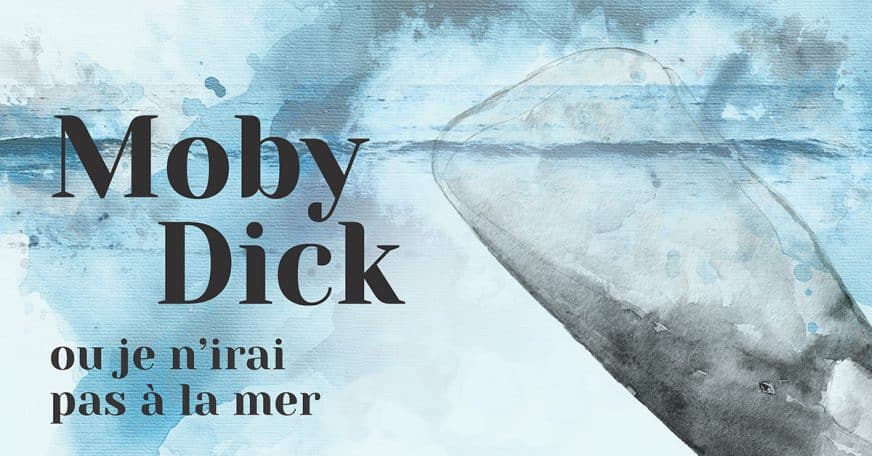«Je cessai bientôt de me promettre de ne plus embrasser Sarah. Je cessai d’annoncer dès le début d’une soirée comme celle-là que je ne pourrais pas rester longtemps pour finalement rester quand même», lit-on, page 65, lorsque le narrateur décrit la fin de sa relation avec le «parfait».
Ratée comment? Par l’effleurement d’un doute, dans une conversation qui n’ira pas bien loin. Une simple question: pourquoi on ne se téléphone pas? Sarah répond à «Je» qu’il n’a qu’à le faire. Ça vous paraît simple? «Lorsqu’on ne fait que presque dire une chose, on se persuade vite qu’en fait on l’a vraiment dite, qu’on l’a juste dite à mots couverts, à un autre niveau […] L’important était que Sarah avait dit que je pouvais appeler, et l’important était que cela précisément, je ne le pouvais pas.»
Pris au premier degré, ça me rappelle une fille que… Enfin, ce premier livre de Tilman Rammstedt est une mise en syntaxe du ressassement et de la procrastination. Si j’écris pour être compris, je veux dire que l’art de ce jeune allemand consiste à tourner autour du pot. Le jeu lasse, parfois; la plupart du temps, on s’étonne à laisser bouillir sa propre marmite intérieure. Quelque part entre Woody Allen et Thomas Bernhard, sa phrase en vagues successives parvient à nous rappeler ce que nous nous empressons d’oublier, à chaque instant: ce flot de non-dit, cet inconscient volontaire dont les manifestations maladroites n’échappent à personne. Sinon à nous-mêmes.
Bibliographie :
Zones taboues, Tilman Rammstedt, 110p., 16,95$