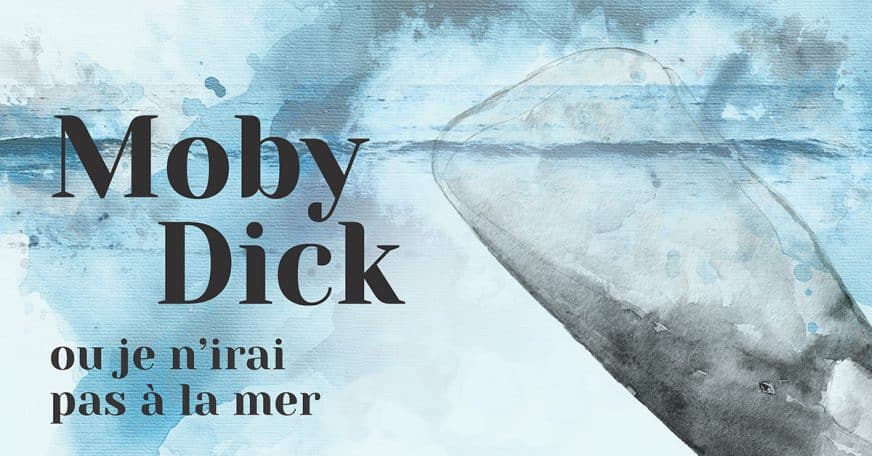Mise en fiction du génocide le plus meurtrier de notre histoire récente, Murambi, le livre des ossements est né grâce au projet « Rwanda, écrire par devoir de mémoire ». L’atelier d’écriture réunissait en 1998 une dizaine d’écrivains africains invités au « pays des mille collines » afin de recueillir les témoignages des victimes et des bourreaux. Dans son roman, l’écrivain originaire du Sénégal Boubacar Boris Diop a choisi de donner la parole aux deux groupes, qui cohabitent toujours sur ce territoire taché de sang.
Plus de 800 000 Rwandais, en majorité tutsis, ont trouvé la mort durant ce qu’on appelle aujourd’hui «les cent jours du Rwanda», la guerre civile qui opposa l’Hutu Power et le Front patriotique rwandais (FPR). Alimentés par la folie meurtrière du Hutu Power, des milliers de simples citoyens prirent les armes afin de mettre en œuvre la «solution finale», le massacre systématique de toute une ethnie.
La peur et la colère
Les personnages de Jessica, une agente secrète du FPR impuissante à sauver les passants pris au piège des barrages routiers, de Cornélius, le fils innocent du «boucher de Murambi» de retour d’exil, ou de cette mère qui rend visite en silence à ce qui reste du squelette de ses enfants dans l’école ravagée, sont autant de voix qui s’élèvent pour rappeler l’horreur de la tragédie.
«Je tenais absolument à me faire l’écho de tous les témoignages, aussi poignants les uns que les autres, recueillis au Rwanda en juillet et août 1998, raconte l’auteur. Restituer ainsi des vécus individuels, c’était donner un visage aux victimes du génocide, les ramener à la vie. On oublie souvent que le projet génocidaire, c’est autant un déni de la vie qu’un déni de la mort dans la mesure où les tueurs veillent par leur cruauté à rendre impossible tout rituel funéraire, et donc le travail du deuil. Pour eux, il est crucial que la victime reste, après sa disparition, aussi anonyme qu’un bœuf abattu à la boucherie. Donner la parole aux morts est donc essentiel.»
La proximité entre les tueurs et leurs victimes, dès les premières pages de Murambi, déconcerte. À travers les yeux et la colère du Docteur Karekezi, l’époux d’une femme et père d’enfants tutsis qui coordonna le massacre de l’école de Murambi dans laquelle sa famille se trouvait, Diop montre l’inconcevable complexité de ce conflit: «Il est vrai que les bourreaux aussi s’expriment dans mon roman, mais ce n’est évidemment pas pour les mêmes raisons. Je n’ai pas fait ce choix artistique par souci de neutralité – ce mot n’a aucun sens dans un tel contexte – mais pour que le récit reste crédible. J’ai donc laissé les tueurs raconter eux-mêmes leurs sinistres exploits. En outre, si un génocide est une tragédie collective, elle est vécue par chacun dans une solitude totale. Il fallait aussi faire entendre ces intolérables souffrances individuelles.»
La mémoire en partage
À propos du projet «Rwanda, écrire par devoir de mémoire», Boubacar Boris Diop écrit dans Murambi: «Nous somme venus, en « frères africains », écouter les victimes des massacres de 1994 et essayer, grâce à nos livres, de faire connaître leurs souffrances au monde entier», une initiative louable qui fut d’abord reçue avec méfiance par les autorités rwandaises, en raison de l’indifférence dont le monde a tristement fait preuve lors des événements de 1994.
Ainsi, ce n’est que grâce à l’insistance du regretté journaliste rwandais Théogène Karabayinga que la rencontre a pu avoir lieu après deux ans de négociations, avec des répercussions manifestes: «Une fois que nous avons été sur place, l’accueil a été impeccable de la part de tous nos interlocuteurs, et en particulier des simples citoyens. Quant au projet lui-même, il apparaît de plus en plus comme un tournant majeur de la littérature africaine, les textes qui en sont issus figurant parmi les plus étudiés aujourd’hui dans toutes les universités d’Afrique et d’ailleurs. Notre groupe a été un pionnier, car quand nous allions au Rwanda en 1998, le sujet n’intéressait pas du tout le grand public. On continuait à voir dans le génocide des Tutsis de simples massacres interethniques. Mais après la publication des romans de » Rwanda: écrire par devoir de mémoire « , les films sont arrivés, puis les pièces de théâtre et d’autres œuvres de fiction, sans parler des témoignages des Rwandais eux-mêmes. Cela a radicalement changé la perception de cette tragédie.»
Murambi, le livre des ossements jouit d’un statut à part dans la production littéraire de Boris Diop, qui a eu l’occasion de discuter du génocide de 1994 avec des milliers de personnes sur tous les continents. À eux seuls, les échanges provoqués par son roman sont une réponse claire à ceux qui douteraient de l’importance de mettre en fiction un génocide.
L’auteur vient d’ailleurs de terminer l’introduction d’un ouvrage regroupant des écrivains de la République démocratique du Congo, du Burundi et du Rwanda: «Je suis persuadé que les grandes œuvres sur le génocide des Tutsis seront écrites par les auteurs rwandais. Jusqu’ici, ils ont surtout expliqué et témoigné à travers les textes de Josias Semujanga, Benjamin Sehene, Jean-Marie Rurangwa, Vénuste Kayimahe, Esther Mujawayo et Yolande Mukagasana. On sait qu’il faut plus de temps et de recul pour la fiction, mais les romans commencent à paraître, le processus est en marche.»