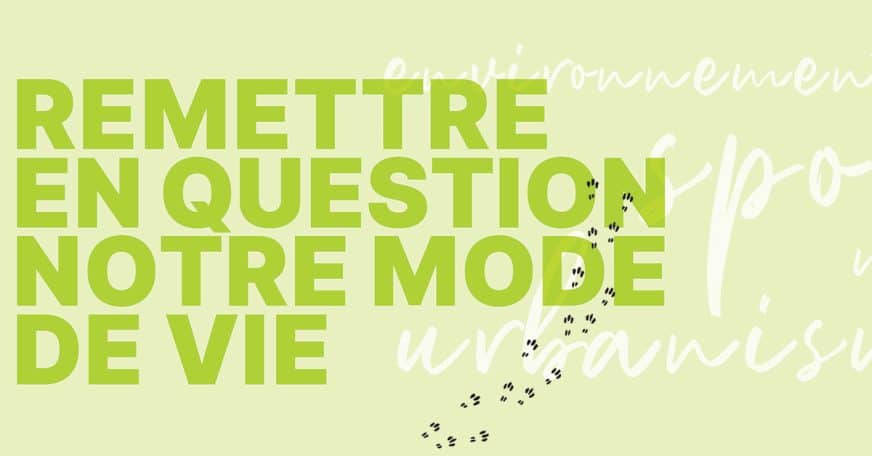Ministre délégué aux Affaires autochtones du Québec à cette époque, John Ciaccia nous livre dans La crise d’Oka, miroir de notre âme, un témoignage poignant, d’une étonnante sincérité sur les acteurs et le jeu des négociations lors de la crise d’Oka. Déçu, abandonné, blessé puis trompé par son entourage, le portrait de cet ancien ministre libéral surprend et apparaît difficilement compatible par l’idéalisme, mais aussi le bon sens, qu’il dut afficher contre vents et marées dans un milieu forgé au réalisme et à l’opportunisme politiques. Ainsi, dans la mesure où Ciaccia tente de définir une nouvelle approche constructive pour le règlement des problèmes de fond des peuples autochtones, sa vision humaniste se heurtera à l’ignorance et à l’incompréhension de plusieurs de ses collègues : « ils étaient prêts à risquer le désastre ». Pour John Ciaccia, la crise marqua profondément l’ensemble de la société québécoise. Elle interpellait nos conceptions sur l’exercice du pouvoir et de la justice en regard de l’autre, l’Amérindien. Elle devenait aussi un miroir de nos propres aspirations : comment refuser aux autres ce que nous revendiquions pour nous-mêmes ?
Mais comment toute cette crise, sa signification et le rôle des protagonistes ont-ils été perçus par les médias ? Dans Oka par la caricature, Réal Brisson s’attarde à ce questionnement en s’appuyant sur une démarche rigoureuse de l’analyse des médias imprimés canadien et québécois. Il nous soumet une lecture convaincante de « deux visions distinctes d’une même crise », représentées par les perspectives anglophone et francophone. Il est remarquable de constater jusqu’à quel point les deux presses pouvaient clairement s’opposer dans la perception de l’Amérindien, la compréhension des enjeux du combat autochtone et finalement la nature du rôle des différents acteurs au sein de la crise. Selon qu’il s’agit : 1) de la victime, de l’opprimé historique ou du militant résistant d’un côté; du rebelle et provocateur intransigeant de l’autre; 2) de droits à protéger ou même à conquérir d’un côté; de privilèges à abolir et de droits à circonscrire de l’autre; 3) de l’assiégé trompé d’un côté; de l’insurgé et manipulateur de l’autre, les presses anglophone puis francophone chacune construisait « les définitions arrangeantes de son Indien » selon l’auteur.
Plus émotive et spectaculaire, la presse graphique anglophone se nourrissait beaucoup de l’image du Warrior mohawk, armé et déterminé. Probablement plus politique aussi, elle a mené une critique appuyée de la politique du gouvernement fédéral pour verser ensuite dans un véritable procès de l’intransigeance du Québec dans cette crise, et par ricochet, de son nationalisme. Quant à la vision francophone, cette-ci joue plus sur le registre de l’humour. Ménageant les susceptibilités tout en essayant de partager les blâmes, elle a cherché à temporiser. Deux solitudes donc, jusque dans l’approche de la résolution de la crise. Là où l’armée canadienne apparaît d’un côté comme un assaillant doté d’une force de riposte démesurée consacrant l’échec de toute négociation, son intervention est au contraire perçue, du côté francophone, comme un soulagement qui se changera rapidement en impatience devant la circonspection de l’opération militaire.
L’ouvrage de Robin Philpot, Oka : dernier alibi du Canada anglais, constitue une tentative inégale et parfois franchement maladroite pour répondre à une sorte de « sentiment anti-québec » lors des événements d’Oka. À la lumière des déboires de la gestion de la crise par le gouvernement Bourassa, le dernier alibi, c’est en fait le dernier argument que pourrait opposer le reste du Canada aux prétentions affirmatives de la société distincte à la souveraineté affichées par le Québec. Pour l’auteur, il n’y a là qu’hypocrisie ou au mieux totale incompréhension. Il a donc cherché à démontrer, chiffres à l’appui, que la condition sociale des autochtones était à plusieurs égards (revenu, éducation, langue, etc.), moins déplorable au Québec qu’ailleurs au Canada.
Dénoncer les dérives haineuses du discours politique, ses procédés d’amalgame et ses analogies abusives, donnant le mauvais rôle au Québec, identifier racisme et nationalisme ou société distincte, ou encore dénaturer les réalités du problème autochtone est une chose. Mais blanchir la gestion gouvernementale de la crise, prendre prétexte du rôle politique dominant des Warriors pour contourner les fondements et la légitimité du combat autochtone et enfin, attiser le sentiment « anti-anglophone » des enjeux de cette lutte ; cela est une toute autre affaire. Ainsi, l’approche de Robin Philpot manque de nuance en restant attachée à une lecture nationale-québécoise des réactions suscitées par le déroulement de la crise d’Oka. À trop vouloir dédouaner le « Québec », il occulte une question importante : comment jeter les ponts entre la réalisation du projet souverainiste qu’il défend et la disposition équitable des revendications politiques avancées par le nationalisme mohawk ?
***
La crise d’Oka, miroir de notre âme, John Ciaccia, Leméac
Oka : dernier alibi du Canada anglais, Robin Philpot, VLB éditeur
Oka par la caricature, Réal Brisson, Éditions du Septentrion