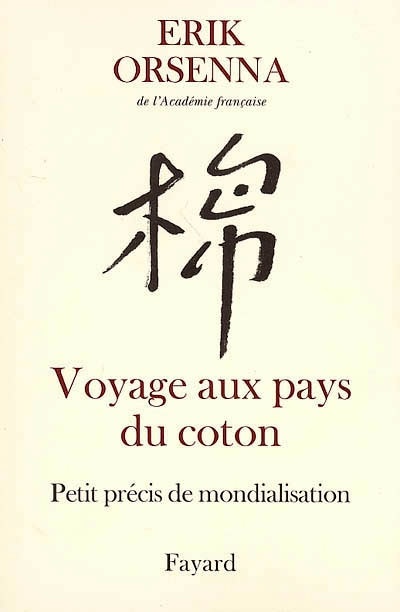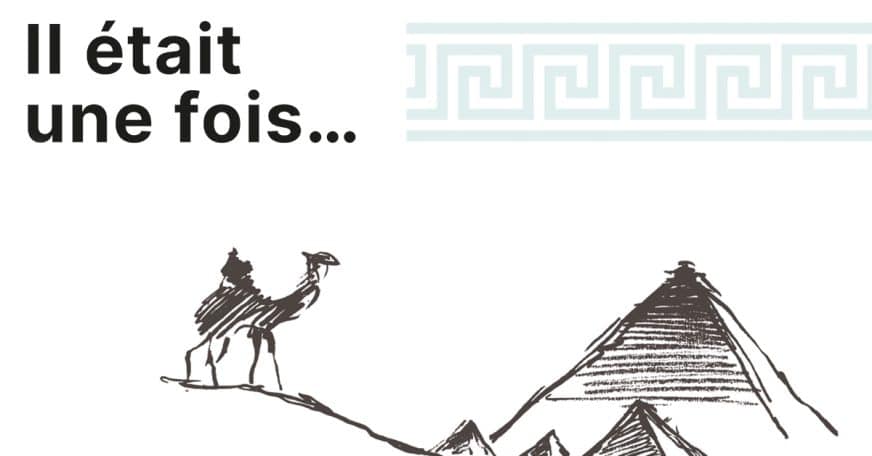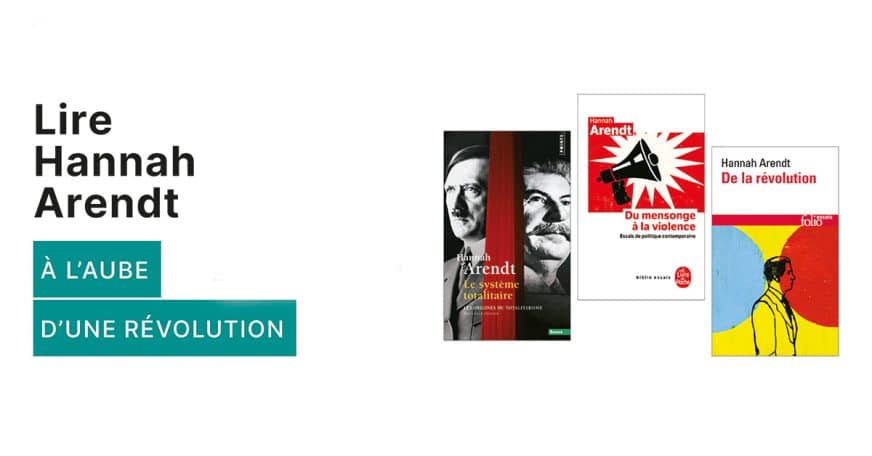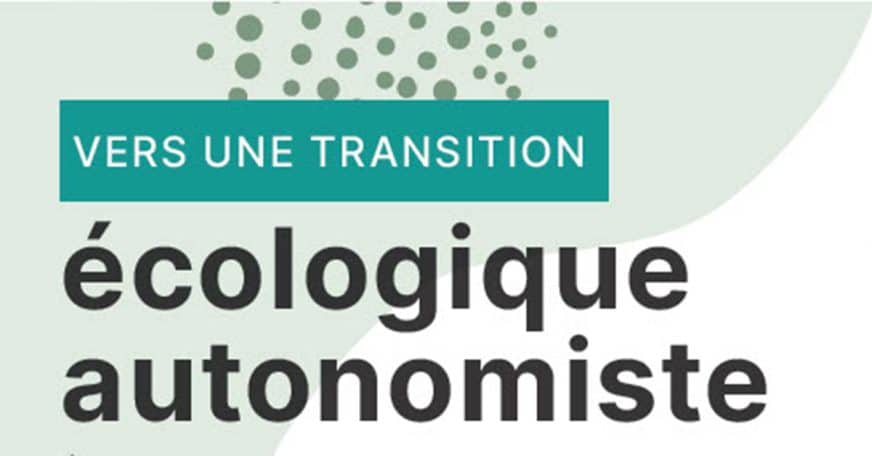«Le porc de la botanique»
Au tout début du 17e siècle, à Mexico, les tailleurs gueulent. Installés depuis peu, des chinois, déjà, vendent des vêtements à meilleur prix qu’eux. Vers la fin de son Voyage, l’homme de lettres, qui acheta sa liberté en embrassant la carrière des chiffres, résume ainsi l’insoutenable concurrence de la Chine, inventeur de «l’ouvrier idéal, qui coûte encore moins cher que l’absence d’ouvrier».
C’est ce genre d’anecdote qui fait entrer dans la complexité. Ce genre d’image aussi: «Le coton est le porc de la botanique: chez lui, tout est bon à prendre. Donc tout est pris.» Portée par des musulmans enviés par les croisés, la fibre de l’«arbre-mouton» gagne du terrain dans les pays de laine et de fourrure. Plus tard, même les fibres synthétiques ne parviennent pas à lui couper l’herbe sous le pied. Billets de banque, cosmétiques, huile destinée à l’alimentation, savon, plastique: on fait de tout avec du coton.
On le cultive partout. D’abord au Mali, où la Compagnie malienne pour le développement du textile (CMDT) agit comme un véritable État dans l’État, assurant le développement de régions entières, finançant l’ensemble des services publics. Mais le temps de la tutelle achève. Pour préserver la paix sociale, la compagnie maintient plus élevés qu’il ne faudrait les sommes versées aux producteurs pour obtenir leurs nuages de ouate. Avant d’apporter son soutien, la Banque Mondiale du Commerce, qui ne répond qu’un mot «à toutes les questions du monde», appelle à la privatisation.
Pas plus rose pour notre cochon, pardon, notre coton aux États-Unis, où on croule, paraît-il sous les subventions. En bon Tintin sans houpette, Orsenna le reporter s’y rend caresser le chien d’un producteur. On fait un tour de tracteur, croise une Ford Cobra usée, tourne le coin d’une maison plus qu’ordinaire, et on apprend que soixante-quinze pour cent des subventions vont aux dix pour cent des plus gros fermiers.
Fibre Frankenstein
Du coton, il en y a pour tous les goûts. C’est à Brasilia, ville chimère s’il en est, qu’on s’en apercevra le mieux. Là, dans un laboratoire, on programme génétiquement de nouvelles variantes de cotons, certains plus résistants aux insectes, d’autres aux herbicides. Bientôt, des gènes d’araignées participeront au génome d’une nouvelle variété dotée d’une fibre plus résistante. Sans perdre le fil de cette science-fiction, Orsenna évoque aussitôt le mythe d’Arachné, cette jeune fille changée en bestiole à huit pattes d’avoir voulu mieux tisser qu’une déesse. Mais ce pessimisme fait sourire les nouveaux alchimistes.
Après un détour en Égypte, et une joyeuse escale à Alexandrie, arrivée en Asie. L’Ouzbékistan mise gros sur son or blanc. L’ «exceptionnelle ductilité» de son coton coûte cher en eau: jusqu’à douze mille mètres cubes par hectare cultivé. On songe alors au sort de la mer d’Aral. En 1960, elle était d’une superficie de près de 70 000 km2. Quarante ans plus tard, elle en faisait à peine la moitié. Pour Orsenna le Breton, la marée basse, ce n’est rien. Ça fait partie du paysage. Mais que dire d’une mer qui ne remonte plus? «Quand avais-je ainsi appelé, protesté, refusé d’y croire? J’ai fini par comprendre: de nouveau je me trouvais face à la mort. Face à une femme que j’aimais et qui venait de mourir.»
**********