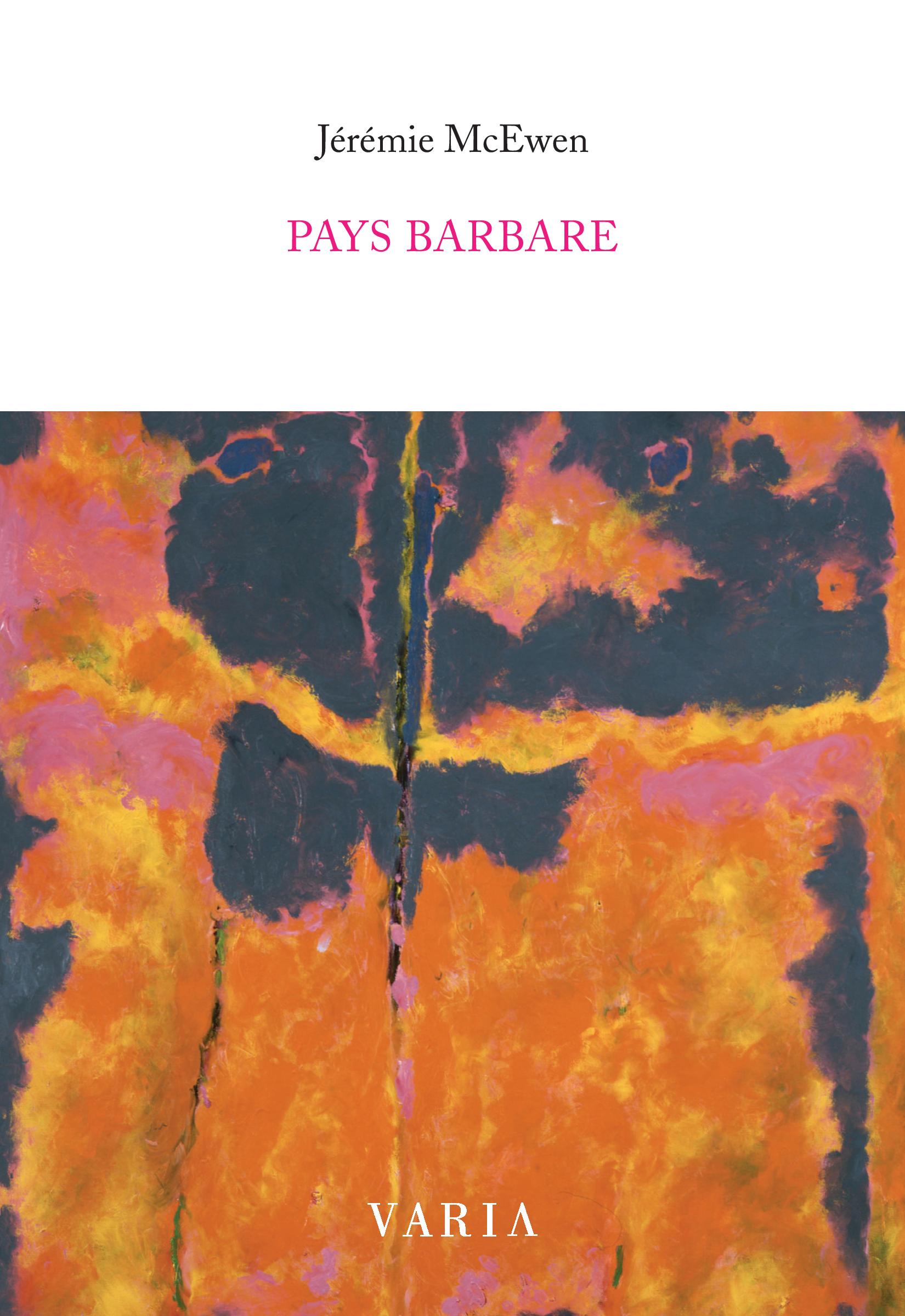Le lendemain, c’était la table ronde avec Fahmi au Centre des congrès. Je me suis levé le matin de notre rencontre en écoutant une de ses entrevues à Radio-Canada Saguenay — décidément, la radio me servait ce week-end-là — et j’ai rapidement compris que chez Fahmi, la façon était au moins aussi importante que le propos. J’ai entendu ce sourire dans sa voix, un sourire posé, réservé, presque aristocratique, fier mais modeste. Chic. J’ai entendu un communicateur, comme on dit, qui sait comment traduire les couleurs de sa pensée en ondes dans la pertinence et l’originalité, pas dans le simple relais d’information. L’entrevue que j’entendais possédait ce ton de familiarité qui nous donne l’impression d’être la mouche au mur qui écoute secrètement une conversation privée, et j’ai compris que l’homme était en ses terres là-bas, lui qui enseigne à l’Université du Québec à Chicoutimi, et que c’était davantage moi l’étranger. « Le Saguenay a été bon pour moi », me dira-t-il au téléphone, comme en écho à cela, quatre ans plus tard.
En le voyant arriver sur la petite scène en contre-plaqué peint noir pour notre discussion du dimanche, j’ai compris que son corps, son aura, rimaient avec sa voix : le veston ajusté, les cheveux lissés, le foulard placé, c’est à peine s’il n’avait pas une fleur de lys à la boutonnière. Tout est élégant chez cet homme, alors que je portais plutôt une chemise pas même rentrée dans mes culottes.
Je me rends compte, aujourd’hui, que lorsque je me plais à critiquer les épinglettes insignifiantes que portent robotiquement les politiciens nord-américains, à l’effigie du pays qu’ils dirigent (comme si on pouvait oublier que le président américain était américain, comme si une nationalité était une simple marque de commerce équivalente à une autre), je pense inconsciemment à la dégaine de Mustapha. Je pense à son style débordant, à sa célébration de la beauté ostentatoire, à sa joie de vivre, vraiment, pas dans un style formaté par un focus group, reproductible et usinable à l’infini, non, dans un style vrai. J’aime me poser la question : si les politiciens et politiciennes qui dirigent ce pays avaient sa prestance, les traiterait-on de bourgeois hautains comme on l’a fait pour Pauline Marois? Sûrement, et c’est une des raisons qui font en sorte que la pensée de Mustapha Fahmi est si pertinente : oui, il faut vivre sur le mode des arts, des lettres, des couleurs et des belles formes; cela peut être une vision d’avenir qui dépasse l’horizon à court terme d’une petite épinglette à la boutonnière qui troque le beau pour le marketing.
L’animateur de la causerie m’a glissé à l’oreille juste avant de commencer un avertissement un peu étonnant : « Je débute avec vous, et ma question est cruelle. » Tiens donc… Enchanté, monsieur. J’étais nouveau dans le jeu des tables rondes, j’ai appris par la suite qu’il y avait toujours une question comme ça dans ces trucs, une seule la plupart du temps, ça fait bouger les choses sur scène, ça réveille tout le monde. Avec le temps, je me rends compte que ce genre de question m’électrifie, chaque fois c’est pareil. Quand ça se produit, j’ai l’impression que Pedro Martinez lance une balle rapide en plein cœur du marbre, et j’aime m’élancer, au risque de fendre l’air. Les entrevues complaisantes qui invitent à la cassette de vente n’intéressent personne de toute manière, et ne font acheter un livre à personne en vérité, soyons honnêtes. Chaque fois que j’entends Marie-Louise Arsenault jouer à ce jeu, en mettant son invité sur un hot seat, je jouis un peu, la vérité est là : dans les idées qui rebondissent, qui déstabilisent, s’étonnent et se revirent de bord, pas dans la livraison docile d’un communiqué de presse qui finira au bac à recyclage bien avant la prochaine saison littéraire.
La question du journaliste saguenéen tournait autour d’une phrase que j’avais écrite, quelque part sur un blogue, et qui s’était retrouvée dans mon livre, à savoir que j’aimais la philosophie, mais que je fuyais les philosophes. Je ne me suis pas fait d’amis au département avec celle-là, mettons, et l’animateur me la remettait en pleine face. J’ai gigoté un peu sur mon petit fauteuil, j’ai pris mon élan, puis j’ai expliqué que le milieu hermétique qu’est la philosophie universitaire m’intéresse de moins en moins, alors que le milieu de l’essai québécois s’en éloignant foisonne d’idées neuves et ouvertes sur l’avenir. Je glane les nommés récents aux Prix du Gouverneur général dans la catégorie essai, et je trouve un paquet d’essayistes profs de cégep, ou pire profs de rien, et je m’en réjouis. Tout se passe comme si la liberté de penser ne passait pas par les départements de philosophie universitaires, alors que j’entends Nietzsche et Derrida me souffler à l’oreille que ça n’a jamais été le cas.
À un moment de la conversation, j’ai pris le rôle d’animateur un peu — désolé, monsieur, ça m’arrive; je travaille là-dessus — et j’ai posé une question un peu chienne à Mustapha, qui gigotait aussi, mais moins, parce qu’il était avec un ami journaliste sur cette scène : « Pourquoi cherchons-nous tout le temps à nous vendre, dans la compétition, Mustapha? » Et lui de me répondre, avec ce sourire que j’avais entendu à la radio le matin même : « Je pense que c’est en lien avec la démocratie, cher Jérémie. » Voilà, nous jouions ensemble, nous faisions les gentlemans tous les deux, et c’était des rôles que nous aimions jouer, comme chaque fois que je l’ai croisé par la suite.
Oui, nous sommes en démocratie, et les livres, comme les autres produits culturels, sont en compétition les uns contre les autres, quoi qu’on en dise. Seulement, je me rends compte, dans ce petit milieu de l’essai au Québec, que tout le monde finit par trouver sa place, son rôle, qui n’est pas le même que tient la personne d’à côté, qui s’évertue elle aussi à écrire quelque chose de pertinent et d’original. Les rôles, comme l’écrit Fahmi, sont multiples et variés, et tout le monde peut inventer le sien, en accord avec sa perception du bien; Aristote n’est jamais loin, Shakespeare non plus bien sûr. Philosophie et littérature se fondent, se confrontent, se côtoient.
Ce genre d’idées désamorce les choses, disons; ça met à l’aise, tout ira bien, il suffit d’y aller. Et en lisant les livres de Fahmi, c’est ce qui nous arrive : on se sent désamorcé, démonté, ramené à la base de ce pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Qui plus est, ses livres nous donnent envie de faire tout ce que nous aimons faire, mais dans un souci constant de bien le faire. C’est ce qui fait de cet homme l’élégance incarnée : une visée permanente du bien, jusque dans sa façon de croiser les jambes.
Mustapha Fahmi est un penseur essentiel du Québec moderne. Il me disait écrire pour une raison fort simple : appartenir. Il a longtemps écrit en anglais pour appartenir à la communauté internationale des spécialistes de Shakespeare, aujourd’hui il écrit pour appartenir au Québec et à la francophonie. J’ai l’impression que nous gagnerions tant si davantage d’universitaires faisaient ce saut; seulement, j’ai l’impression que bien de ces penseurs et penseuses ont oublié comment écrire sans se parer de mille armures d’intertextualité et de jargon impénétrable. Fahmi a fait le saut, et il ne regarde pas derrière lui. Quand je l’ai croisé au Salon du livre de Montréal à l’automne 2019, et qu’il y était encore pour promouvoir son premier livre, je lui ai lancé en souriant que « ça en prend un autre, une suite, Mustapha! » Ce à quoi il m’a répondu : « Il ne faut jamais forcer un livre, Jérémie. » Oui, il aime la philosophie qui se permet de temps à autre de prescrire.
Sa pensée est volontariste : comprenons Hamlet en nous demandant que voulait-il être, plutôt que pourquoi il n’a pas fait ceci ou cela (il voulait être philosophe, si vous vous posez la question). Sa pensée est positive : voyons la beauté du monde, et laissons à d’autres plumes le souci de la tristesse, écrit-il en citant Jane Austen. Sa pensée est humaniste : à plusieurs reprises il évoque la distinction entre l’être humain et les autres espèces animales. Soit, ce ne sont pas tous des courants de pensée particulièrement à la mode, mais j’ai l’impression qu’il se fout un peu des modes, et c’est parce qu’il a compris que la notion de style mate aisément les modes et leurs conformismes saisonniers.
Il a évoqué Nietzsche à plusieurs reprises lorsque je l’ai joint pour cet article, alors qu’il se trouvait à Casablanca pour une tournée de promotion de son livre; la pensée de Fahmi traverse l’océan, il n’y a pas que la pensée québécoise réactionnaire qui réussisse à le faire, disons-le. Les aphorismes qui sont placés au cœur de ses deux livres bellement publiés par La Peuplade en sont plus que certainement la clé de voûte. C’est en les lisant qu’à plusieurs reprises j’ai fait ce geste presque caricatural : déposer le livre, regarder par la fenêtre et penser, puisque, comme il le dit, une bonne pensée mène le lecteur loin de son auteur.
« La pluie appartient à tout le monde, mais une pluie douce n’appartient qu’à ceux qui peuvent entendre sa musique sur l’herbe. »
Sa pensée fait du bien, mais elle ne flatte pas non plus dans le sens du poil, se permettant parfois de surplomber les choses, et de porter une critique acerbe sur ses contemporains qui comprennent mal comment nourrir durablement leur ambition : « Il existe une stratégie pour monter et une autre pour demeurer en haut. Celui qui choisit de sauter pour atteindre le sommet ferait mieux d’essayer autre chose pour y rester. » Tout est question d’équilibre. J’ai pensé à Kanye West quand j’ai lu cet aphorisme, lui qui certainement continue de sauter sans arrêt, et qui à un moment donné, dans ces sauts compulsifs et répétés, a fini par me désintéresser complètement.
Ce que défend Fahmi, au fond, c’est ce vieil idéal de sagesse, cette idée du sage-guide dont j’essaie de me défaire parce qu’elle est trop facile à déconstruire, parce que ce rôle est toujours trop feint par quelque côté. Mais c’est une idée qui colle à la peau de tout essayiste, quoi qu’il ou elle fasse. C’est tout un nœud, puisque même quand on critique l’idéal de sagesse, on fait comme s’il était plus sage de tourner le dos à cet idéal : c’est tout le paradoxe, un paradoxe beau, nietzschéen, noble et nécessaire à penser.
Il écrit quelque part que vieillir en devenant plus compliqué est une erreur : j’aime ça, je me retrouve là-dedans. Je me le rappellerai souvent, toute ma vie, parce que c’est vrai, tout simplement. La subtilité intellectuelle qui s’éloigne des lecteurs peut faire chic un moment, mais en vieillissant, tout l’intérêt est d’être entouré d’une communauté de penseurs et de penseuses, de lecteurs et de lectrices.
Il écrit aussi brillamment à propos de la solitude du vieillissant roi Lear; j’ai pensé à ma mère et à ce que je lui dois, et j’ai pensé à Mustapha et ses enfants. Entre les lignes, on voit bien qu’il nous écrit la philosophie de sa propre vie, une philosophie qui s’est imposée à lui davantage qu’elle n’a été inventée. N’est-ce pas la marque d’une pensée profonde au sens propre de la chose? Ces passages sur Lear, me confiait-il, qui ouvrent La promesse de Juliette (qui aurait pu s’intituler La solitude de Lear), ont été écrits alors qu’il était hospitalisé dans la première vague de COVID-19. Huit mois de convalescence plus tard, il peut affirmer en connaissance de cause qu’il y a pire que la mort. Mourir seul est l’enfer des enfers, il le sait, puisque ses proches ne pouvaient lui rendre visite et qu’il lisait la peur sur le visage des médecins et des infirmières.
Je lui ai posé la question à savoir s’il écrivait au fond sur ses enfants, à ses enfants, et il a semblé surpris. Pourtant, Lear lègue : c’est le cœur de l’affaire, non? Comment bien léguer, comment s’assurer de ne pas s’aliéner ses proches, tout en demeurant soi-même? Alors que la nation est acquise, comment bien appartenir à une famille? Désolé, cher Mustapha, pour la question chienne.

Professeur de philosophie au Collège Montmorency, chroniqueur, rappeur et auteur, Jérémie McEwen a publié les essais Avant je criais fort (XYZ) et Philosophie du hip-hop (XYZ), en usant toujours de sa verve déliée. Il a aussi collaboré à l’ouvrage collectif J’enseigne depuis toujours (Nota bene) et écrit un recueil de poésie, La panse (XYZ). Son dernier titre, Pays barbare (Varia), critique le conservatisme québécois. Dans cet essai, l’écrivain aborde aussi sa relation avec son père, décédé lorsqu’il avait 18 ans. La société québécoise, la filiation, la nation et la famille se retrouvent au cœur de la réflexion de cet ouvrage. Jérémie McEwen nous raconte ici sa rencontre avec l’auteur et professeur Mustapha Fahmi. [AM]
Photo de Mustapha Fahmi : © Sophie Gagnon-Bergeron
Toutes les autres photos : © Mustapha Fahmi
Photo de Jérémie McEwen : © Julie Artacho