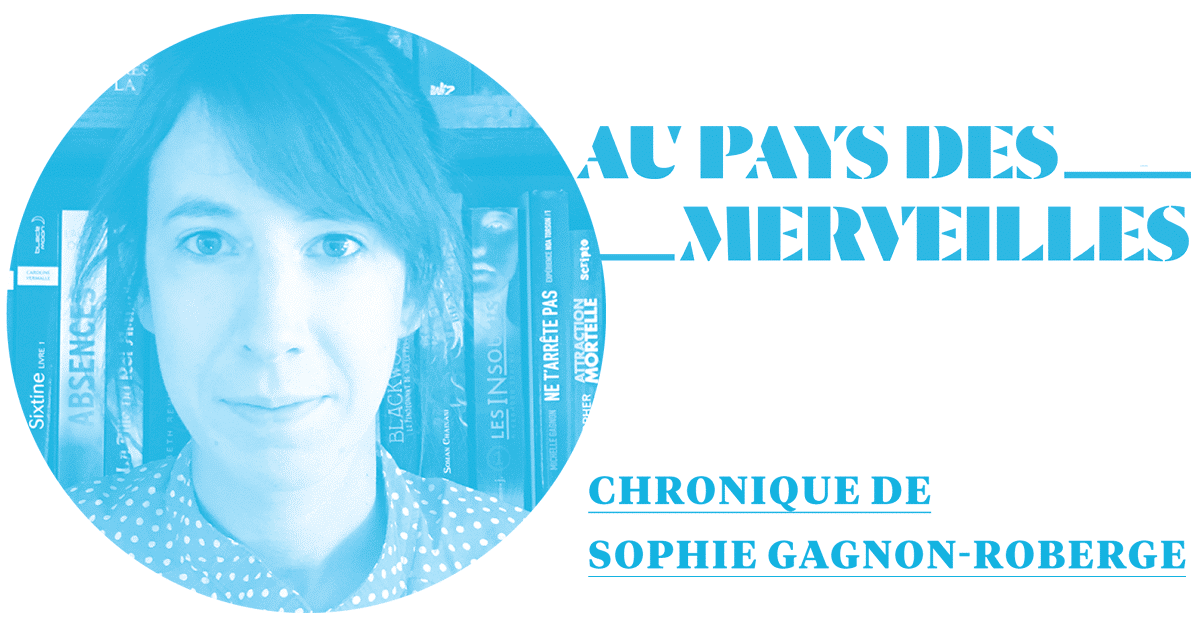Aux éditions Les Malins, Isabelle Picard propose Nish, un récit réaliste qui raconte le quotidien d’Héloïse et de Léon, jumeaux de 14 ans qui vivent dans la communauté innue de Matimekush. Cette histoire est très accessible, puisque sa façon de s’appuyer sur des thèmes tels que la famille, l’amitié, les premières amours et la maladie, s’apparente à celle d’autres collections populaires auprès des ados. La différence, c’est qu’ici c’est le Nord, et non le Sud, qui est montré.
Ainsi, le quotidien des héros, composé d’école, de chasse, de balades en motoneige ou en quatre roues et de hockey, est bouleversé par deux événements qui s’ancrent dans la distance. Il y a d’abord l’oncle du meilleur ami de Léon qui disparaît dans la forêt alors qu’un carcajou rôde. Puis, le père des jumeaux reçoit un diagnostic de cancer qui l’oblige à aller se faire soigner à Wendake, 924 kilomètres au sud. Héloïse et Léon doivent donc vivre à distance cette maladie, le transport étant dispendieux.
Bien qu’Isabelle Picard mette en lumière plus directement les différences entre le Sud et le Nord à travers un travail scolaire réalisé par Héloïse et ses amies, c’est tout au long du livre que le lecteur peut découvrir ce qui distingue la vie au nord du 55e parallèle. Qu’il soit question de la température, des moyens de transport, de l’autonomie des adolescents, de la rareté des fruits et légumes (et de leur coût), du style des maisons ou du rapport à l’école, chaque page est l’occasion de découvrir de nouveaux détails, d’apprendre. Par ailleurs, si la question des pensionnats est mentionnée sans être fouillée, l’autrice utilise de nouveau le biais du travail d’Héloïse pour apprendre à ses personnages, tout comme au lecteur, l’historique des mines dans cette région et le rôle et les impacts du gouvernement à ce propos. Une conscientisation qui se fait à travers la fiction, mais qui reste en tête…
Question conscientisation, Si je disparais (Isatis), dernier album de la collection « Griff » prenant la forme d’une lettre écrite par une adolescente autochtone à un chef de police, est aussi particulièrement efficace. Excellente élève, bénévole, amie, Brianna est la fille d’une mère célibataire qui l’aime plus que tout, une adolescente qui n’a pas d’instinct de fugue, qui ne prend pas de drogue. Et, pourtant, elle a plus de chance de disparaître, de se faire agresser, violer parce qu’elle est autochtone. Et comme il y a aussi moins de chance qu’on parle d’elle rapidement, de ce qu’elle est vraiment, pour que tous soient attentifs et puissent la rechercher si elle disparaît, ça donne l’impression à ses agresseurs potentiels qu’ils peuvent agir en toute impunité, « que la vie des jeunes filles autochtones ne compte pas ».
Écrit au « tu », le texte de Brianna Jonnie et Nahanni Shingoose impressionne par sa sobriété, très bien rendue par la traduction de Nicholas Aumais. Il n’y a pas de superflu, seulement la réalité : cette différence. Son impact est par ailleurs amplifié par les illustrations de Neal Shannacappo, qui utilise la force de frappe du rouge, venant mettre juste certains éléments en relief dans ses différentes compositions.
Le rouge, couleur qui représente la protection, la guérison pour les Innus, est aussi présent, dans une teinte plus claire, plus douce, dans le recueil de poèmes Nin Auass — Moi l’enfant, paru aux éditions Mémoire d’encrier en collaboration avec Institut Tshakapesh. Ainsi, Lydia Mestokosho-Paradis a mis son talent au service de textes écrits par des élèves du primaire et du secondaire, dans la langue de leur choix, « semés et recueillis » par les poétesses Joséphine Bacon et Laure Morali.
Chacun est ainsi proposé deux fois, en français, en innu-aimun ou en nutshimiu-aimun, langue parlée à l’intérieur des terres, cette disposition formant au final un kaléidoscope de regards personnels.
Au fil des pages, le lecteur voit apparaître les outardes, la taïga, les aurores boréales, les rivières, mais aussi les mocassins, la raquette, la chasse, les familles ou encore des drames intimes puissants, des pertes, des deuils, parfois dans des poèmes très courts, à la manière des haïkus, juste le temps d’une image fugace, parfois sur plusieurs pages, alors que les langues se mélangent et que des histoires peuvent se raconter autour des ancêtres, de l’importance de sauvegarder l’innu, de la première chasse et du souffle coupé à la vue du premier caribou. Certains poèmes encore sont inspirés de légendes et d’autres forment des devinettes, invitant le lecteur à découvrir au fil des mots la signification d’un mot en innu.
« Ce livre représente une remontée à la source », indique Laure Morali dans un de ces intermèdes où les trois artistes, poétesses et illustratrice, expliquent le processus de création.
« Je suis le vent silencieux et froid, une pensée infinie. »
C’est le genre de livre qu’on lit lentement, par morceaux, pour laisser vivre les mots et leur signification en nous. Une œuvre formant un collier de poèmes qui rassemblent les différents villages au gré des images, des références, et qui, tout comme Nish et Si je disparais, nous permet d’appréhender une autre réalité et de questionner nos préjugés et, surtout, nous donne envie de traverser la fenêtre pour tendre la main.