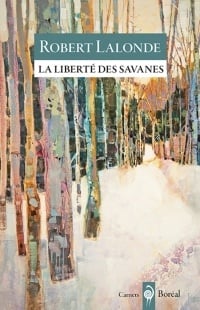C’est en 1997 qu’a été publié son premier carnet, Le monde sur le flanc de la truite. Vingt ans ont passé alors qu’est sorti cet hiver La liberté des savanes, son cinquième recueil de notes sur l’art de voir, de lire et d’écrire. Ces verbes d’action s’élèvent bel et bien au rang d’art lorsque l’œil est assez avisé pour renouveler l’émerveillement chaque fois qu’il regarde. Une expertise dont Robert Lalonde est passé maître.
Venu nous rendre visite dans nos bureaux, Robert Lalonde tient à deux mains le café qu’on lui a offert et converse de la même manière qu’il écrit; ses réflexions pulsent en accord avec la vie qui l’entoure. Appareillé d’un feu intérieur qui n’a l’air de ne jamais vouloir s’éteindre, l’écrivain semble être à la fois l’étincelle qui enflamme que la matière qui se consume.
En considérant l’écart entre le premier et le plus récent carnet, Robert Lalonde constate évidemment qu’il a vieilli. L’écriture des carnets lui permet cependant de rester au plus près de l’enfance. « Ils m’ont toujours un petit peu, je l’espère d’ailleurs chaque fois que j’en fais un, ramené à ce regard d’enfance que j’ai déjà eu sur l’univers. » Lalonde semble se faire un point d’honneur à désapprendre les stances du discours ambiant et à refuser tout ce qui pourrait entraver le regard direct, et non virtuel ou édulcoré, sur ce qui existe. « Ce rapport direct avec les choses donne un petit peu le vertige aux gens en général parce qu’il y a une sorte d’inconfort à traverser; on ne sait pas trop ce qu’on va voir, l’idée de rester disponible à quelque chose qui n’est pas apparent tout de suite, etc. » Pour comprendre le monde, il faut l’approcher.
Lorsque Robert Lalonde se met « en état de carnet » comme il l’appelle, c’est donc qu’il se rend disponible mais également vulnérable et en perpétuel déséquilibre. C’est d’ailleurs l’ébranlement qu’a suscité en lui le suicide du fils de son voisin qui l’amène à s’adresser dans La liberté des savanes à ce jeune homme « qui ne s’est pas donné la patience de passer au travers les conflits qu’il avait ». À la manière d’un Rilke qui guide le jeune poète, Lalonde parcourt avec ce fils du chasseur les chemins d’apprentissage. Il consent avec lui que la vie est chargée d’épreuves, mais tente de lui inoculer l’idée qu’au bout des difficultés, arrivent, on ne sait trop comment, des issues qu’on n’espérait pourtant plus.
La loyauté des livres
Encore une fois, Lalonde cite dans ce nouveau carnet plusieurs écrivains, qu’il appelle avec affection ses amis. « J’en suis quitte pour l’amitié consolatrice des livres. Je ne les aurais pas eus à mes côtés que ma vie aurait été un interminable chagrin, tant le court horizon du jour le jour m’a toujours rétréci l’appétit d’aventure », écrit-il. Ainsi, Lopez, Miron, Woolf, Kerouac, Proust, Bouvier, Eco, Whitman nous convient à travers les multiples âges que nous portons en nous à voir plutôt qu’à savoir, à risquer sa propre loi au lieu d’obéir aveuglément. « Moi j’ai toujours préféré, par ma délinquance, les chemins de traverse aux chemins tracés. » Cette excursion des sentiers non balisés, tant dans la littérature que dans la vie, lui permet de découvrir ce qu’il n’aurait pu apercevoir autrement. Il évoque aussi l’importance des détours; nous ne traversons pas la vie en ligne droite, elle est plutôt une suite d’accidents qui nous amène quelque part. Les dogmes de notre ère tentent de balayer toute saillie qui dépasserait de la surface lisse des choses. « C’est probablement parce qu’on vit dans une société où la douleur est un écart de comportement. » Retournant à ses livres, Lalonde trouve là les sources de consolation, d’épanchement, de compassion et de déraison dont il a besoin.
Puis l’écrivain raconte qu’un même chauffeur de taxi lui demande de l’appeler quand il a besoin d’être conduit dans Montréal, simplement parce qu’il veut converser avec lui de ce qu’il vit. Il arrête même le compteur. « Si ça devient rare à ce point de pouvoir converser vraiment avec les gens alors qu’on est dans un monde de communication absolue, c’est que la littérature a toute la place. » Celle-ci peut établir le dialogue manquant, un échange qui a davantage rapport avec la profondeur qu’avec la prodigalité des instantanés.
Le chef-d’œuvre impérissable
La façon dont les professeurs au collège définissaient le jeune Lalonde marquera longtemps son esprit. « Tu as un peu de talent en tout mais pas vraiment de talent en rien. » Depuis, il rêve régulièrement qu’il écrit le chef-d’œuvre incontournable. « Je continue, malgré l’âge que j’ai, absurdement, à rêver que je fasse un chef-d’œuvre impérissable que tout le monde finira par reconnaître et qui légitimera le fait que j’ai travaillé si fort dans ma vie pour écrire comme il faut. Pourquoi? Pour une certaine pérennité, qui par ailleurs m’indiffère. » Lalonde n’est pas à une contradiction près, il aurait même tendance à louer ce qui s’oppose en nous. « C’est Freud qui disait que la névrose, c’est l’incapacité à supporter l’ambiguïté; c’est blanc ou c’est noir, c’est bien ou ce n’est pas bien, il faut faire ça ou il ne faut pas le faire. Or nos vies se situent toujours entre tout ça. » C’est dans l’interstice, dans l’entre-deux que l’inattendu risque de nous surprendre. À la page 67 du carnet, il ouvre la porte et voit tout à coup devant et dedans lui une lumière extraordinairement limpide qui le ramène à l’essentiel de lui-même. Il écrit alors, comme un immense soupir de soulagement qu’on croirait presque entendre : « L’importance tombe de moi comme tombe le vent à six heures du soir en été. » Cela résume avec exception la futilité et la constante déception qu’entraîne la complaisance de nos ego démesurés. Débarrassés du poids de la vanité, nous pouvons enfin nous incarner tels que nous sommes, un tout petit élément faisant partie du grand mystère, ni plus, ni moins. « Le plus difficile quand on pratique un art, c’est d’admettre ce qu’on peut faire. » En cela, c’est aussi accepter ce qu’on ne peut pas faire. Appliquée à plus grande échelle, cette phrase a un pouvoir extrêmement libérateur.
Il relate le moment où il a été invité dans une classe et où l’enseignante était décontenancée par le fait qu’il pointait comme étant la meilleure du groupe la composition de son plus mauvais élève. « Oui, il est nul en orthographe, mais dans votre classe, c’est le seul qui écrit », réplique Lalonde. L’histoire sur deux pages d’un petit garçon dont le père est boucher et qui rêve qu’il prend la nuit le corps de son père et va l’accrocher avec les carcasses d’animaux. Le trouble provoqué à la lecture de ce texte remplit sa fonction de littérature : il bouleverse, questionne, chavire. « Et bien sûr, après la classe, le petit garçon vient me voir, il ouvre son sac et il y avait 300 pages de ça. Il écrit. Il n’a jamais parlé dans la classe, il a toujours zéro sur ses copies, mais c’est le seul qui écrit. » On ne peut s’empêcher de penser que ce jour-là, Robert Lalonde a probablement transformé la vie d’un petit bonhomme. « J’ai été obligé de lutter, comme les étudiants à qui j’enseignais doivent lutter, contre la formation scolaire qui nous amène à valoriser un résultat », discute l’écrivain. Le travail de l’écrivain est long et laborieux, rien à voir avec la précipitation qui caractérise l’époque.
Le vieux sage
À suivre les vagabondages dont sont peuplés les carnets de Lalonde, on retient qu’il n’y a pas de modèle, pas de mode d’emploi. C’est à travers les errances qu’une vie finit par se vivre, aussi imparfaite soit-elle. « Arriver à valoriser le chemin de l’auberge plutôt que l’auberge elle-même, si je peux arriver à donner le soupçon de ça quand j’écris, ça me fait toujours très plaisir. » En côtoyant l’écrivain, on se sent un peu plus respirer et on s’accorde davantage le droit de se tromper, et même d’aimer ses erreurs.
La liberté des savanes
Robert Lalonde (Boréal)
Photo : © Martine Doyon