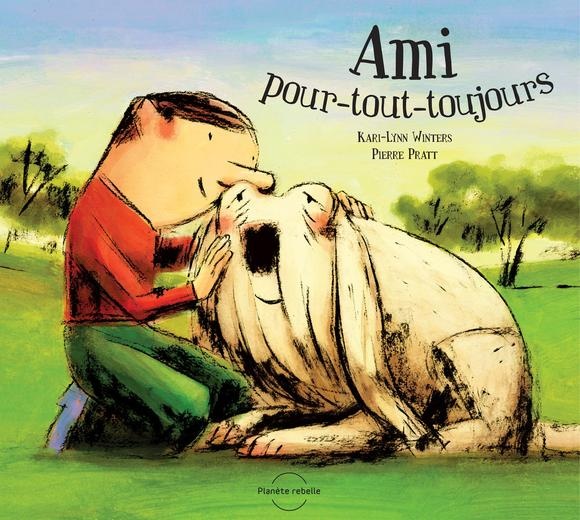Elle a vu un oiseau poilu perché sur un fil électrique, puis s’est mise à écrire un roman entier avec, en filigrane, cet oiseau dont elle est certaine d’avoir aperçu le pelage… Elle est comme ça Elise Lagacé. Elle aime les personnages étranges auxquels on s’attache, avec leurs failles, et leur donne la parole dans son premier roman qui se déroule à Rivière-Longue, un village situé à des années-lumière de la normalité.
À Rivière-Longue, l’oiseau poilu est le fidèle compagnon d’un architecte en burnout qui s’acharne à bâtir une maison pour une femme qu’il ne connaît pas. Il y a notamment une boulangère qui fait des biscuits, un maire entêté, le Père Bourassa qui tient son épicerie, Agnan du bureau de poste qui ne reçoit que cinq à dix lettres par jour et qui parfois même les réécrit, un pêcheur qu’on appelle Le Grand Martin, deux Germaine qui tricotent en commérant depuis quarante-six ans, les gars de chars Jalbert et Rôti, Mario qu’on pense caduque, Gitane l’avocate, Verlaine le chat unique et Marcelle dont la mère, Aline, a quitté le village sans laisser d’adresse. Cette disparition obsède Rivière-Longue. Ne sort pas qui veut de ce bled perdu… Pas même les lectrices et lecteurs qui s’y aventurent, incertains de ce qu’ils trouveront au sortir des 200 pages de La courte année de Rivière-Longue.
« Personne n’a besoin de sortir, personne n’a besoin d’entrer. Ce serait mal vu d’aller encourager l’économie étrangère, tout comme ce serait mal vu d’avoir un étranger qui vienne salir l’économie locale. Imaginez, un client qui vient de la ville… De toute façon, on a besoin de bien peu de chose à Rivière-Longue. Bien peu. On peut carburer longtemps avec un soupçon d’amertume. » À Rivière-Longue, on n’aime pas ceux qui ne font pas comme tout le monde, ceux qui osent, qui risquent, qui aiment ou qui se réjouissent. Pas de place pour l’originalité ou l’exubérance. Inutile d’aller très loin pour trouver des endroits similaires, où il vaut mieux marcher droit et ne pas sortir du rang.
Sourire au combat
La pétillante rouquine aux yeux bleus sait de quoi elle parle en matière de non-conformisme. Elle-même avoue ne pas savoir très bien suivre les traces déjà existantes, préférant de loin emprunter les chemins de travers. Mais surtout, malgré tout, ne pas s’en faire et se faire doux avec soi-même. « Vient un moment dans ta vie où t’as mangé assez de m… que tu apprends à vivre avec ta nature et même à voir les choses tristes avec un sourire. Tu n’as pas le choix, sinon, tu ne t’en sors pas. Même dans le tragique il faut savoir y déceler de l’humour. Ça se peut! », assure Elise Lagacé.
Au-delà de la mélancolie ambiante qui semble assombrir leur existence, ses personnages, tous très imparfaits à leur façon, révèlent des comportements inusités ou affichent des traits de personnalité qui font sourire invariablement, teintant d’une légèreté le malheur de la mystérieuse disparition d’Aline et celui de sa petite Michelle, laissée derrière au village. En marge, certains d’entre eux se regroupent, se construisent et espèrent le retour de la disparue. Les animaux, aussi importants que les humains, les accompagnent dans cette quête de chaleur, dans la précieuse conservation de l’espoir cultivé au fil des jours qui passent. « Une maison, ce n’est pas où on habite, c’est ceux qui nous habitent… », confie l’auteure qui a un jour été de ceux et celles qui n’ont pas de maison ou qui en ont plusieurs, de ceux et celles qui, sans être la copie conforme d’Aline, ont tout quitté pour mieux revenir.
Partir pour revenir le cœur plus léger
« La plupart d’entre nous devons un jour s’exiler, se détacher de la famille et de ce lieu qui nous a vu naître. Souvent, on reste dans des situations nocives parce qu’on ne décide pas de prendre notre parti, alors qu’il faudrait juste être dans notre propre équipe, apprivoiser plus tard le courage de revenir changé, et, des fois, encore blessé », ajoute-t-elle pour expliquer la fuite de son héroïne.
De ce qu’elle a vécu, de l’endroit d’où elle revient, de ses remords et regrets, on ne sait presque rien. Comme on en sait très peu sur la plupart de ces êtres qui peuplent Rivière-Longue. Disciple de la culture du mystère, dans son premier opus, celle qui travaille depuis un bon moment dans le milieu de l’édition effleure ces êtres fictifs plus qu’elle ne les décrypte dans les moindres détails. « Ça donne la liberté au lecteur de comprendre, d’imaginer et de se faire ses propres scénarios. Je trouve qu’on dit déjà pas mal trop d’affaires dans la vie en général. On dit tout sur tout, tout le temps. »
Voilà donc pourquoi l’art d’écrire d’Elise Lagacé repose sur des phrases courtes à travers lesquelles on arrive néanmoins à tout saisir, sans flafla, sans lourdeur. Sa signature franche et poétique est d’une redoutable efficacité : « La pluie a claqué sur la coque de leur abri de fortune. Ils n’ont fait que respirer et se tenir au chaud. Pour se rappeler qu’ils existaient. En ces temps-là, à Rivière-Longue, c’est ainsi que l’on faisait les enfants. Avec la mémoire nomade de ceux qui ne parlent pas. »
Sous le sable, l’écriture
En cours de création, « ses petits » à elle, l’auteure les enterre à la manière de la tortue de mer qui cache ses œufs dans le sable avant de revenir les déterrer lorsqu’ils sont prêts à éclore. « J’ai de longues périodes de gestation. Tout ce que je fais, je vis ou tous ceux que je rencontre dans mon quotidien vont venir se coller à mon idée de départ. Quand j’ai ce qu’il me faut, que tout semble sur le point d’émerger, j’y reviens en écrivant en un jet. »
La courte année de Rivière-Longue s’est écrit à travers des courriels qu’elle s’envoyait à elle-même sur son téléphone intelligent lorsqu’elle prenait le métro pour se rendre à son travail. Cette relation épistolaire entretenue avec elle-même lui a permis de se « faire de la compagnie », comme elle se plaît à dire avec son sens de l’autodérision, à répondre à ses propres questions et en s’y trouvant bien sûr au bout du chemin pour se rassurer sur le temps qui fait bien les choses au final : « Car la vie, ce n’est que ça, vivre une heure à la fois, une journée à la fois, une année à la fois, écrit-elle. Et c’est ainsi que le pire devient supportable. »