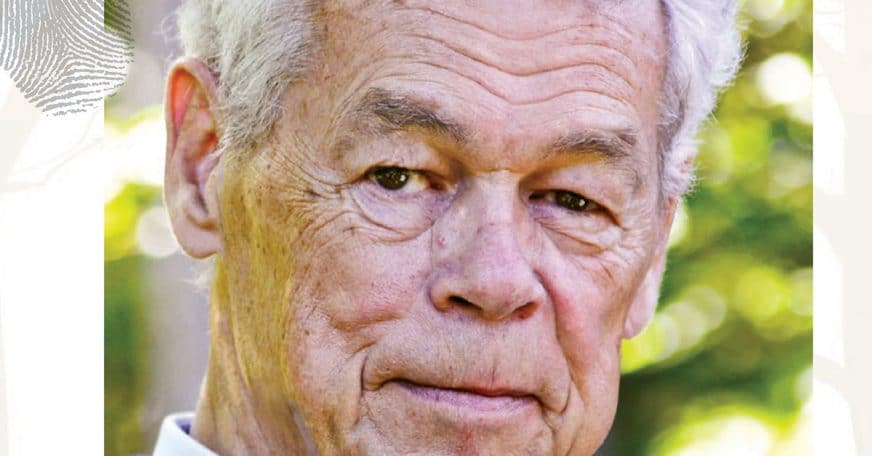Depuis vos débuts, parallèlement à votre œuvre « officielle », vous avez publié sous le pseudonyme de Richard Stark. Selon vous, qu’est-ce qui distingue les romans de Westlake de ceux de Stark ?
En littérature, plus encore en littérature de fiction, le nerf de la guerre c’est le langage, le choix des mots, le rythme des phrases. La prose de Westlake est plus baroque, elle est pleine de surprises amusantes, comme ces cartes de Noël avec des petites fenêtres. Quand j’ai adopté le pseudonyme, je désirais que les livres de Stark soient à l’image de son nom. [NDLR : en anglais, l’adjectif « stark » signifie « cru »]. L’humour s’y manifeste en dépit de la volonté des personnages. J’y présente un portrait sans fard et dénudé du monde interlope, comme si le criminel n’était qu’un travailleur comme n’importe quel autre.
Plusieurs critiques s’intéressent à l’aspect dénonciateur du roman noir, à la dimension d’analyse et de critique sociale qu’on retrouve dans bon nombre d’œuvres, dont votre propre roman Le Couperet. Quel est votre point de vue là-dessus ?
Je ne crois pas que la fonction première de la fiction ait à voir avec quoi que ce soit de social, qu’il s’agisse de critique sociale, de satire sociale, d’analyse sociale ou même de thé en société ! L’écrivain de fiction, d’abord et avant tout, devrait se soucier de l’intrigue, de soulever la question « Qu’est-ce qui s’est passé ensuite ?» et d’y répondre. Les autres ingrédients qu’on peut ajouter à la recette sont facultatifs. L’histoire que je racontais dans Le Couperet me faisait rager, et tout naturellement cette rage transparaît. Néanmoins, mon souci premier était de suivre l’aventure de ce type. [NDLR : Le Couperet met en scène un employé sans histoire qui, se retrouvant au chômage, décide d’éliminer tous ses rivaux potentiels dans l’espoir de trouver une nouvelle position]. Dans la plupart des cas, les écrivains qui s’enorgueillissent de la soi-disant pertinence sociale de leur œuvre ne font que témoigner du monde dans lequel nous vivons en s’imaginant que leur perspective est exceptionnelle.
Mais vous, quelle est votre perspective sur la vie aux États-Unis aujourd’hui ? Avez-vous l’impression que les conditions de vie dans votre pays se sont améliorées, ou plutôt qu’elles se sont détériorées ces dernières années ?
C’est une question difficile ! Je crois que nous sommes engagés sur une pente descendante ; nous sommes passés d’une période de confort extrême à une période d’inconfort extrême. Il est trop tôt pour dire de quelle manière la colère, le désespoir et le désappointement à l’égard de la situation politique se manifesteront, mais les arômes qui nous viennent de la cuisine ne sont franchement pas ragoûtants…
Vous considérez-vous comme un écrivain cynique ?
Le cynique, c’est celui qui ne croit plus en la valeur de quoi que ce soit. Si je ne croyais en rien, je n’écrirais pas. Je me considère comme un esprit lucide, dans une société peuplée de romantiques idéalistes et candides. Prenons un exemple : dans un tas de romans, quand des bandits braquent une banque, ils trouvent toujours un espace de stationnement en face. Chez moi, plus souvent qu’autrement, mes personnages doivent courir sur trois pâtés de maison en sortant de la banque. Ce n’est pas cynique, puisque mes héros jugent tout à fait acceptable de faire un hold-up, mais c’est certainement plus réaliste que ces livres où l’on réussit à se garer juste en face d’une banque !
Comment décririez-vous vos relations avec les héros de vos romans, Dortmunder, l’implacable Parker et les autres ? Et en quoi ces relations diffèrent-elles les unes des autres ?
J’adore visiter John Dortmunder et ses amis, mais je dois faire attention de ne pas passer mes soirées au bistro avec eux… Je préfère garder mes distances avec Parker, parce que lui et moi travaillons de la même manière, en échafaudant des plans complexes et en espérant y survivre. À côté d’eux, Francis Meehan, qui n’apparaît que dans un seul livre et qui ne reviendra plus, était le personnage le plus futé, le plus prompt avec qui j’ai eu à transiger et c’est pour cette raison que je l’aimais bien. Mais, au contraire des héros de mes séries, il est allé au bout de son parcours dans ce roman.
Comment expliquer que vos romans mettent plus volontiers en scène des voleurs, des escrocs, des petits criminels que des policiers ou des détectives privés ?
Je me suis toujours davantage intéressé à la personne qui doit affronter seule l’adversité pour atteindre ses objectifs, sans soutien de qui que ce soit. Alors, il est peu probable que j’écrive un jour un roman mettant en scène l’équipage d’un bombardier, à moins que l’un des membres entreprenne de supprimer ses collègues. C’est moins la criminalité que la solitude qui me fascine et m’attire…
En tant que lecteur, quels sont les écrivains dont vous fréquentez l’œuvre avec plaisir, qu’ils soient contemporains ou pas, qu’ils pratiquent le genre noir ou pas ?
Je lis de tout, mais de moins en moins de polars. J’aimerai toujours Elmore Leonard, et j’avoue qu’à sa parution Mystic River de Dennis Lehane m’a jeté par terre. Dashiell Hammett m’a toujours plu et beaucoup influencé, parce qu’il arrivait à vous faire ressentir des émotions sans pour autant les décrire. Dans un autre genre, j’apprécie Nabokov pour la même raison.
En lisant votre plus récent roman à paraître en français, Dégâts des eaux, il m’a été difficile de ne pas voir le nom de votre protagoniste, Tom Jimson, comme un clin d’œil au romancier Jim Thompson…
Je venais tout juste de commencer mon roman quand j’ai été recruté pour écrire le scénario de The Grifters (Les Arnaqueurs, 1990), d’après le roman de Thompson. Le réalisateur Stephen Frears et moi nous sommes plongés dans Thompson durant quelques mois. Puis, alors que je commençais à écrire le scénario, la Writers Guild [NDLR : le syndicat américain des scénaristes pour la télévision et le cinéma] a déclenché une grève de cinq mois. Alors je suis retourné à mon roman et, tout naturellement, Jim m’y a suivi…
Vous avez au fil des ans publié des nouvelles, des romans jeunesse, des ouvrages dont l’action se déroule lors de la conquête de l’Ouest, mais l’essentiel de votre œuvre se classe néanmoins au rayon du roman noir. Si vous n’écriviez pas ce type de livres, quel autre genre vous intéresserait ? L’utilisation d’un artifice science-fictionnel dans Smoke (l’invisibilité) laisse croire que le genre ne vous est pas indifférent…
Le fantastique m’attire, mais un fantastique différent de celui qu’on pratique ces jours-ci. Je trouve les œuvres et l’univers de Harvey Pekar fascinants. Par contre, la science-fiction m’intéresse peu, parce que c’est le seul genre où les intrigues ne concernent pas les aspirations d’un personnage. Les histoires de science-fiction me semblent toutes articulées autour d’une planète, d’un fait scientifique ou de créatures venues d’on ne sait où. [NDLR : M. Westlake préfère apparemment passer sous silence son roman de SF intitulé Anarchaos, publié sous le pseudonyme Curt Clark en 1960].