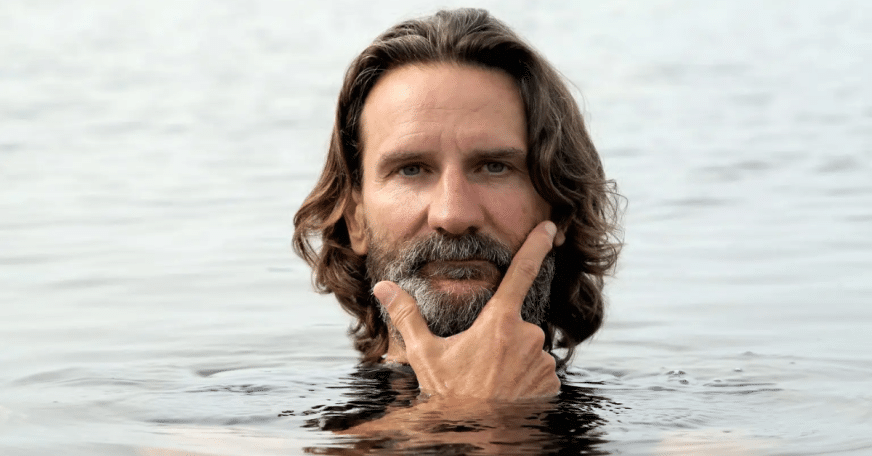En automne 2012, lorsque l’on déambulait dans les rues d’Helsinki, capitale de la Finlande, Sofi Oksanen était partout. Façades commerciales, vitrines des librairies, tramways; on se brûlait même les doigts sur des cafés à emporter sur lesquels il y avait sa photo, partout la même : veste militaire, visage affirmé, reconnaissable entre tous, où se côtoient le rose et le noir et où se déposent des lunettes rondes. L’offensive publicitaire me rappelait au passage, une année plus tôt dans les tunnels de Montréal, le visage de Catherine Mavrikakis, déguisée en détenue avec une fiche anthropométrique entre les mains pour la promotion du roman Les derniers jours de Smokey Nelson. Époque de l’image et des tendres subversions, je présume. On peut aussi simplement se réjouir de voir la littérature prendre ainsi le haut de l’affiche.
C’était perceptible dans Purge, son ouvrage précédent traduit en trente-huit langues qui a récolté non sans raison des éloges partout où il est passé : Sofi Oksanen a une étonnante voix pour sa mi-trentaine, une maturité stylistique qui justifie à bien des égards ce traitement de rockstar offert à une écrivaine qui confirme aujourd’hui sa place importante dans la constellation des plumes remuantes de la littérature européenne contemporaine.
À la sortie de Quand les colombes disparurent en finnois, le journal Helsingin Sanomat, le plus grand quotidien de la capitale finlandaise, avise : cette lecture s’avère plus difficile que Purge. On prend parfois les lecteurs pour des cons, mais cette fois, l’avertissement est vrai : Sofi Oksanen a goupillé à la plume un roman doté d’une structure tout en masques et en faux-semblants, en angles de vue confondants et en va-et-vient historiques qui font parfois perdre l’équilibre au lecteur. Le coefficient de difficulté s’élève d’un cran, mais le plaisir de lecture (celui de recevoir des uppercuts formels en pleine figure au détour d’une page) demeure intact : dans cette construction en béton armé circule une prose nerveuse et souple qui témoigne d’un sens singulier de l’image, d’une esthétique encore plus aboutie que dans ses romans précédents et d’un souci aigu pour le rythme et la sonorité des phrases, cadence aérienne que la traduction de Sébastien Cagnoli rend admirablement.
On n’est guère surpris d’apprendre que cette nouvelle reine des lettres de la Baltique, née d’un père finlandais et d’une mère estonienne, soit lectrice de Marguerite Duras : « J’ai d’abord été envoûtée par la langue de Duras, mais j’ai plus tard compris que sa manière de décrire la double identité était l’élément auquel je pouvais m’identifier facilement, ce que je n’avais pas saisi au départ », dit l’auteure de ce nouveau roman où personnages, villes et pays opprimés changent de nom sous le poids des bottes.
Automne 2012. Deux jours après sa sortie, plus de 100 000 exemplaires de Quand les colombes disparurent s’étaient écoulés en Finlande, pays de près de cinq millions d’habitants. En 1984, année où Marguerite Duras remportera le Goncourt, L’Amant aura pris un mois, en France, pour en faire autant.
Quand les colombes disparurent, c’est aussi le livre de Juudit, personnage central du roman qui évoque à la fois Madame Bovary et Anna Karénine, épouse d’un homme qui ne l’aime pas, Edgar, homme caméléon inspiré pour sa part d’Edgar Meos, complice du KGB dont les Estoniens préféreraient ne plus se souvenir, mais que Sofi Oksanen soutire de l’oubli, juste là sous le noir verni de l’histoire de ce pays d’à peine un peu plus d’un million d’âmes.
Au fil de ces pages qui sentent la crème sure, la sueur et l’acide carbolique, on pense à la ministre française de la Justice, Christiane Taubira, concluant son discours en paraphrasant Nietzsche après que l’Assemblée nationale de France eut adopté la loi autorisant le mariage pour tous : « Les vérités tuent. Celles que l’on tait deviennent vénéneuses ». À la citation, Sofi Oksanen acquiesce. Et à la fin du roman, on comprend mieux pourquoi.
Ces pages sentent aussi le chocolat, un « petit cadeau prudent que les Estoniens sous l’occupation soviétique pouvaient offrir au médecin, à une infirmière, à quiconque. On pouvait toujours dire que c’était un cadeau, et non une tentative de corruption, raconte l’auteure. L’Estonie était reconnue pour son chocolat et sa production d’alcool. De nombreux jeunes hommes estoniens ayant servi dans l’armée soviétique ont sauvé leur peau avec du chocolat et de l’alcool d’Estonie, très populaires chez les généraux soviétiques. La femme de Nikita Khrouchtchev était folle de chocolat estonien! »
En peignant des personnages troubles dont elle décline les pensées les plus profondes avec acuité, obligeant le lecteur à faire face au passé et ainsi à en recoller les douloureux morceaux, Oksanen serait-elle, à la manière d’un Thomas Bernhard ou d’une Elfriede Jelinek, une écrivaine « cheval de Troie »? « Oui, pourquoi pas? On me demande parfois si je suis aux prises moi-même avec des problèmes d’ordre moral puisque la morale de mes personnages pose problème, ils agissent de manière inacceptable. En tant qu’auteure, je n‘y vois aucun problème. Ce n’est pas le rôle de l’écrivain de condamner les personnages de ses romans. »
Bien tendue sur tout près de 400 pages, cette intrigue garde toujours en haleine et, tout en faisant œuvre de mémoire, évoque par moments le souffle haletant des romans policiers, genre où les pays nordiques font classe à part. Les pays d’Europe du Nord forment, l’interviewée me le rappelle, un groupe où 50% des romans publiés sont écrits par des femmes. Écrivaine nordique, donc? « Être qualifiée d’auteure nordique me convient, mais je me définis plutôt comme une écrivaine “postgoulag” s’inscrivant de la tradition postcolonialiste, à tout le moins lorsque mes romans se déroulent en Estonie. »
Sous l’impulsion de son indépendance, l’Estonie est aujourd’hui chef de file mondial en matière de technologie de l’information, pays wi-fi sur l’ensemble de son territoire qu’on surnomme parfois la Singapour de l’Europe. Mais ce futur a un passé que Sofi Oksanen creuse comme on retournait jadis la terre au kolkhoze, utilisant la pointe du crayon pour percer à jour, pour gratter les fraîches cicatrices laissées par la faucille, par l’histoire et sa grande hache, dirait Georges Perec, l’histoire récente de l’Estonie sous les occupations russe, allemande et soviétique. Les colombes qui disparurent, ce sont celles que mangeaient les Allemands lorsqu’ils occupèrent l’Estonie. « Pour ceux qui étaient des enfants à l’époque et qui s’en souviennent encore, ce geste avait une forte portée symbolique : les Allemands mangeaient la paix. »