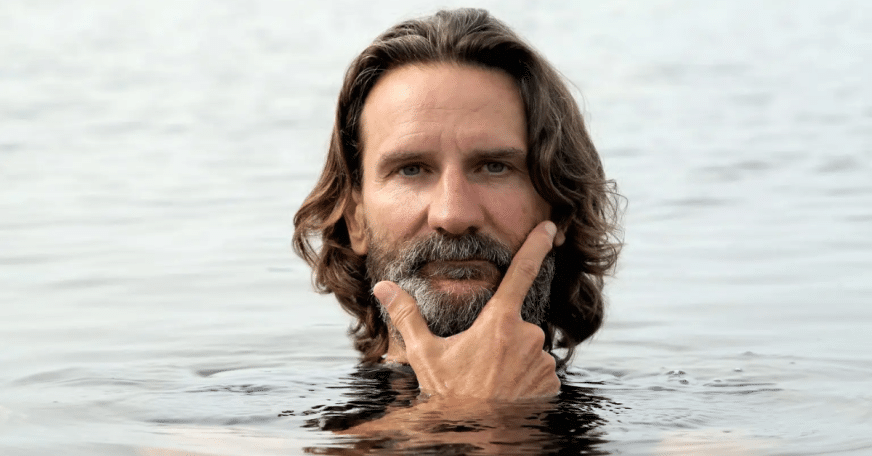La description pourrait s’appliquer à bien des patelins reculés un peu partout sur la planète. Mais ce qu’il y a de particulier avec East Village, un bled non moins perdu, ce sont ces habitants : des mennonites. Leur maître à penser, un certain Menno Simmons, a eu la riche idée de fonder il y a 500 ans une communauté religieuse ultra conservatrice où l’on interdit, sous peine de mériter une bonne tranche de courroux divin, la danse, le rock n’ roll, les bijoux, le billard et le plaisir sexuel… Et ce ne sont pas tous les pièges tendus par le Malin : il y en d’autres, beaucoup d’autres. C’est donc à East Village qu’a grandi Nomi, le personnage au centre du singulier récit qu’est Drôle de tendresse de Miriam Tœws.
Une enfance à l’eau bénite
Si c’était à refaire, Nomi lui dirait bien deux mots, à Menno. Car au fond, la jeune fille ne cherche qu’à mener une adolescence dans les règles, faite de petits excès de luxure, de péchés anodins et de longues soirées à se laisser flotter sur des airs rock, véritables hymnes à la liberté s’harmonisant parfaitement avec la consommation de petits joints roulés dans l’amour du prochain. Peut-être que Miriam Tœws, elle aussi, aurait son lot de remarques à faire à ce Menno. Elle aussi a été mennonite. Elle l’est toujours d’ailleurs : elle n’est pas une sainte ni une impie pour autant. Sa verve acidulée, parfumée de subtile ironie vaguement sacrilège, et son remarquable talent de conteuse font d’elle une écrivaine accomplie.
Dans des mots croustillants et d’une déroutante simplicité, Nomi décrit son patelin de dévots incapables d’apprécier les « bienfaits » de la modernité. Et bien qu’à la lueur du parcours personnel de Tœws, il soit tentant de croire que son roman frise le règlement de comptes, il n’en est rien. Pas de squelettes dans le placard, de nœuds de vipères à délier dans une prose vengeresse. Rien, sinon la voix d’une femme toujours souriante, en paix avec sa foi et qui, lorsqu’elle retourne chez elle, n’est pas pointée du doigt : « Mes parents n’ont jamais contraint ma sœur ou moi-même à avoir la foi. Nous formions en quelque sorte une famille plus libérale, au sein d’une communauté plus conservatrice », affirme la principale intéressée.
Jeux interdits
De son enfance, Miriam Tœws, qui vit maintenant à Winnipeg, ne semble avoir gardé que les plus flamboyants fragments, comme autant de petits miracles cruels. Elle s’en est inspirée notamment pour créer des personnages hauts en couleur, et ce, malgré leur sombre parure. Ainsi, l’oncle, un fidèle dont la foi n’a d’égale que la rigidité avec laquelle il inflige sermons et récriminations, est surnommé « la Bouche ». Quant aux grenouilles de bénitier d’East Village, elles n’échappent pas au jugement lucide de Nomi : « J’essaie d’expliquer aux gens que c’est d’abord un roman d’apprentissage, raconte Tœws. Le livre intéresse un large auditoire parce qu’il raconte l’histoire d’une petite fille qui cherche sa place dans le monde. Ce pourrait être n’importe où mais voilà, nous sommes dans une communauté mennonite. Cela n’affecte en rien les sentiments de perte et de tristesse qu’elle ressent depuis le départ de sa mère, Trudi, et de sa sœur, Tash. Elle n’a rien d’une extrémiste ni d’un esprit subversif : elle veut savoir qui elle est. Il y a encore quelque chose en elle qui persiste à entretenir sa foi. Elle croit à la tolérance, à la bonté, à l’amour ; elle n’en voit tout simplement pas beaucoup. Elle n’a rien d’une mauvaise mennonite. C’est une mennonite curieuse, plutôt. »
Premier livre de Tœws à être traduit en français, de très belle façon d’ailleurs, par Lori Saint-Martin et Paul Gagné, Drôle de tendresse abonde en moments de francs désespoirs, de craintes de la mort, de l’excommunication et de bien d’autres malaises. Mais derrière les mots se terrent les drames auxquels l’écrivaine a dû faire face, la mort de son père surtout. Le spectre du suicide et des disparitions subites hante les marges de Drôle de tendresse, pourtant porté la plupart du temps par une étonnante insouciance. Il y a donc de l’espoir en enfer. À moins que ce soit du désespoir au paradis. La perception que la communauté qui l’a vue grandir entretient de son travail n’atteint pas Miriam Tœws : « Il y a des gens qui n’approuvent pas, mais en silence. Une condamnation silencieuse, en quelque sorte. Mais j’ai grandi dans cet environnement, j’y suis habituée. »
Sur une autre note, la musique offre à Nomi un havre de paix où elle peut s’évader, vivre une fugace et bien chaste romance avec le chanteur de Led Zeppelin ou avec un George Harrison, sosie du Jésus qui veille du haut de sa pancarte aux abords du chemin menant à East Village. La plupart des disques à la maison ont été laissés là par Tash, la sœur disparue, et la fréquentation de ces souvenirs de famille, néfaste aux yeux des pontifes de la communauté, présente une conception de l’amour étrangère à celle que la jeune héroïne reçoit de ses pairs : « Lorsque l’on vit des émotions intenses, je crois qu’il est tout à fait sensé de se tourner vers la musique. Les chansons des idoles de Nomi agissent comme un baume sur sa plaie. » L’expression artistique devient, selon Miriam Tœws, refuge de la révolte et c’est ce qui, en définitive, permet d’espérer, à défaut de salut ou de promesse d’éternelle félicité, de trouver des réponses : « Il n’y a pas de place pour les gens qui ont des doutes ou des questions dans sa communauté. C’est un rôle qui revient à l’artiste, au musicien, au chanteur ou à l’écrivain. » Mission accomplie.
Bibliographie :
Drôle de tendresse, Miriam Tœws, Boréal, 360 p., 25,95 $
Avec ce troisième roman, l’auteure manitobaine a remporté l’an dernier le Prix du Gouverneur général pour la fiction en langue anglaise.