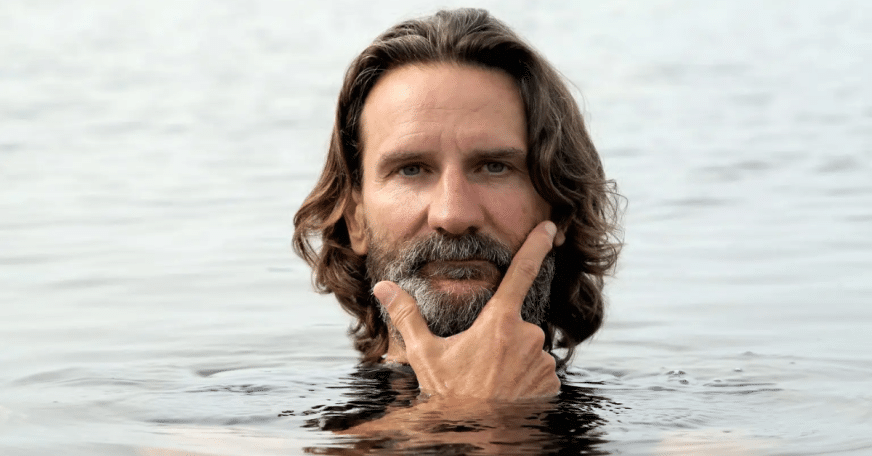Un livre vous a-t-il plus marqué que les autres ?
Une lecture fondatrice ? J’ai beaucoup lu très jeune. J’ai commencé comme tout le monde, par des livres pour enfants. Mais j’aurais du mal à dire quand ça a vraiment commencé. À un moment, lorsque j’étais adolescent, j’ai cru que ça avait commencé avec Les Fleurs du mal. C’est très flatteur de se dire cela… Alors qu’en fin de compte, ça commence avec « Oui-Oui » ou « Fantômette ». Vous voyez ce que je veux dire ? Si on est honnête, le goût de la lecture, c’est l’envie d’être pris par une histoire. Déjà, si ça se passe, c’est réussi. Ça teinte le rapport qu’on aura plus grand avec la littérature.
Lorsqu’on est enfant, l’écrit est une énigme à décrypter. On n’a pas encore la maîtrise du langage. On est fasciné par les textes de publicité ou par les BD, sans avoir l’âge de décoder les bulles. Je me souviens de ça aussi. On éprouve un agacement et en même temps une fascination à l’endroit d’une richesse, la promesse d’un trésor de sens.
Quelle est la première chose que vous ayez écrite ?
J’ai commencé à écrire à douze, treize ans. J’ai tenu un journal jusqu’à vingt-cinq ans. D’ailleurs, Le Journal d’un cœur sec a été l’arrêt de mort de mon journal personnel. J’ai eu l’impression de mettre dans la forme romancée de ce texte ce que je savais de la pratique du journal intime. Je crois d’ailleurs être allé au bout de cette expérience littéraire.
Dans ce livre, vous donnez la parole à Henry Wotton, un personnage du Portrait de Dorian Gray d’Oscar Wilde. Pourquoi ce personnage plutôt qu’un autre ?
Je voulais utiliser la forme du journal ; je ne voulais pas que ce soit personnel. C’est difficile de remonter à « la » raison, de retrouver la source totale. Disons que je voulais d’abord faire quelque chose de très loin de moi, tout en utilisant la forme du journal. Être paradoxal avec cette forme-là qui devait me conduire à parler de moi. M’éloigner de moi avec quelqu’un de plus âgé, d’un autre pays. Et encore plus loin : être quelqu’un inventé par un autre.
Il y avait aussi au même moment… c’est drôle, je me souviens très bien de ce soir-là… Je pensais à Cioran, qui avait une passion pour Emily Brontë, et je me suis mis à rêver du livre qu’il aurait pu lui consacrer. Je me suis dit : « Moi, de qui je voudrais écrire le livre ou le journal ? » J’ai pensé à quelques personnages, pour en retenir Wotton, le mentor de Dorian Gray. Il me paraissait d’un brio, d’une espèce de légèreté en même temps, d’une acidité de l’esprit, enfin, qui à l’époque me correspondait. J’admirais en tous cas la limite de ce héros-là, qui était quelque chose de fermé, quelque chose de stérile. Un être qui s’est figé dans une pose. C’est le Pygmalion dans toute sa puissance, mais dans toutes ses limites aussi. Il incarne la vie vécue par procuration, mais aussi une vie de contrôle : l’absence de liberté personnelle et le désir d’emprise sur les autres. Ce sont les thèmes que j’ai essayé de mener à bien. Avec, quand même, un personnage de jeune fille, Ellis, qui évite ce système.
Dans Maître-Chien, l’idée de faire référence à Salammbô vous est venue comment ?
Flaubert, pour moi, comme pour d’autres, c’est une figure de référence. Il s’investit complètement dans l’écriture : il en fait un monde. Et puis Salammbô, c’est un livre qui m’a beaucoup marqué, que je trouve très beau, et qui correspondait certainement au moment de l’écriture de Maître-Chien à quelque chose dans l’ordre d’un idéal. J’en parle dans le livre : cette manière de concevoir la littérature comme une manière de refuge par rapport à la médiocrité de son temps. Lorsque j’écris, il y a toujours un moment où je rends « hommage à ». Considérant que je n’invente pas grand-chose, la notion de transmission est essentielle à l’idée que je me fais de l’art. On doit passer ce que l’on a reçu, à sa manière.
Remettre en circulation ?
Holà ! Flaubert n’a pas besoin de moi pour ça ! Mais oui, comme une sorte d’hommage, une manière de passer un relais, ou un pacte mystérieux avec le lecteur.
Avez-vous une certaine idée du message que vous transmettez ainsi au lecteur ?
Ça reste ambigu. Mais cette ambiguïté, je ne vais pas la chercher : elle se révèle à moi. Quand je travaille un projet, j’ai besoin de figures tutélaires comme ça, qui m’aident. En général, mon projet génère lui-même ses références. Elles sont bienvenues, bien sûr : je n’ai pas de référence qui ne me plaise pas, ne me touche pas. Mais à un moment je constate : « Tiens, ça entre dans cette filiation-là ».
Dans ce cas, ce que vous gardez, ce qui vous intéresse vraiment, n’est-ce pas ce que vous ne comprenez pas ?
Oui. C’est très important, même pour l’auteur : qu’il y ait une grande part de ce que j’ai voulu dire qui me reste obscure. D’ailleurs, c’est proportionnel à une espèce d’obsession. J’essaie de très bien construire, que les choses soient très tendues par un sens. Qu’il y ait un fil qui tienne tous les éléments. Et en même temps, il y a ce quelque chose qui me dépasse complètement dans la portée de l’histoire, du propos. Je crois que c’est beaucoup dû à la forme : elle dépasse le projet initial, le plan. La langue, telle qu’elle résonne, par exemple, est plus chargée de sens que le sens qu’elle véhicule. C’est la question du style, de l’objet qui dépasse son propre artisan.
Avez-vous une idée préconçue de cette forme ?
J’en ai une. Mais ce que ça va rendre, ça, je ne le maîtrise pas. Je suis très attentif à la tournure des choses. Je pense qu’une forme aboutie a des résonances qui vont un peu plus loin que ce que j’ai voulu mettre. C’est une question de recherche de beauté, enfin, où chacun peut avoir sa propre définition. La mienne, ce à quoi j’essaie d’accéder, d’aboutir, est toujours plus chargée que les formes qui la composent. Ce n’est pas la perfection, non plus. Ça irradie quelque chose…
… « Quelque chose » ? Un but de l’écriture ou « quelque chose » qui s’impose de soi en écrivant ?
C’est sans doute ça, oui. Une tentative de rejoindre un idéal, et c’est dans cette tentative-là qu’on aimante une richesse de sens.
Dans Maître-Chien, Johann, le personnage principal, apparaît dans une scène où sont décrits des gratte-ciel qui attendent « un débarquement ennemi ». Deux pages plus loin, il est écrit qu’en Europe, Laurane, l’ancienne compagne de Johann, ne l’attend plus. Cette écriture par oppositions est volontaire ?
Oui, je suis un petit peu maniaque. Même si c’est discret. Vous, vous le voyez, mais on n’est pas obligé de voir ça. Ça participe au climat qu’on arrive à instaurer, ces résonances-là, ce secret. Si on en arrive à créer un climat, on arrive à créer l’empreinte que le livre va laisser. On se souvient mal de détails de l’intrigue de Le Rouge et le Noir, par exemple. Mais on se souvient du climat de la lecture. C’est un souvenir d’atmosphère. Après, on associe cette impression à tel ou tel événement de l’intrigue, à telle réplique. Mais quand on entend un titre, la première chose à laquelle on pense, c’est à un climat de lecture. Si on a réussi à le créer, c’est qu’on est parvenu à doser des liens secrets entre les éléments du livre, qui concordent un peu, qui ont la même tonalité.
Cette part de votre travail reste instinctive ?
Sans doute. Une intuition nourrie d’un métier. C’est-à-dire qu’il y a un moment où, parce qu’on a bien digéré nos lectures et qu’on continue à le faire, parce qu’on s’est suffisamment frotté aux brouillons, aux ratures et aux échecs, on a un instinct peut-être plus sûr.
La main et l’œil sont plus assurés ?
Oui. Et l’oreille aussi. Très important d’écrire à l’oreille : si ça sonne, c’est bon!
Bibliographie :
Fiasco, Phébus, 1997, 29,95 $
Journal d’un coeur sec, Phébus, 1999, 34,95 $
Les Filles de l’ombre, Phébus, coll. Libretto, 2004, 14,95 $
Aux dimensions du monde, Léo Sheer, 2004, 29,95 $
Maître-Chien, Phébus, 2004, 29,95 $