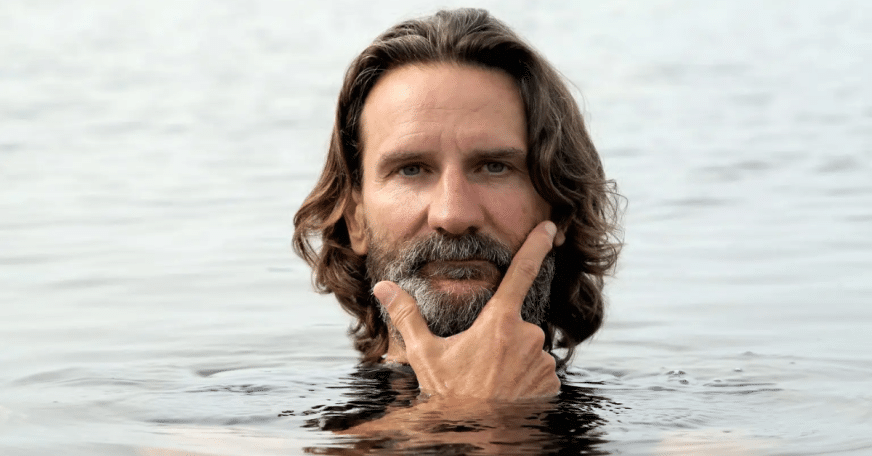Chronique d’une famille névrosée
Ancien directeur de la Midland Pacific Railroad, époux taciturne et père sévère, Albert, est un septuagénaire atteint d’Alzheimer. Son épouse Enid, femme au foyer puritaine et entêtée, n’a qu’une obsession : réunir sa marmaille pour un dernier Noël dans la maison de St. Jude. Disséminés entre New York et Philadelphie, leurs enfants, peu enthousiasmés par l’idée, redoutent le conservatisme de leurs parents. Et pour cause. Gary, l’aîné, est un morne banquier doublé d’une caricature de fils, mari et père parfait qui nie son état dépressif. Chip, le puîné, est viré de son poste d’enseignant pour avoir couché avec une étudiante. Scénariste raté angoissé par l’argent, il fuit en Lituanie jouer au webmestre pour un mafioso du coin. Quant à Denise, la benjamine, une célèbre chef, sa sexualité n’arrive pas à la cheville de ses recettes ; incapable de choisir entre son patron et la femme de ce dernier, c’est l’ambivalence même.
À constater la déprime de Gary, l’indécision de Denise, la rébellion de Chip, la vulnérabilité d’Enid ou les regrets d’Albert, il est tentant de voir dans Les Corrections une dérangeante synthèse de la famille moderne. Et pourtant non, selon Franzen : « La notion même d’une famille typique est à mes yeux un anathème. Qui voudrait être typique ? Les seules personnes que j’aie jamais rencontrées qui rêvaient d’être typiques, ou qui l’affirmaient, étaient à mon sens parfaitement excentriques, de vrais freaks. Mon livre met en scène des individualités ; j’écris pour des gens qui se sentent uniques. Il se peut que certaines angoisses du clan Lambert semblent familières, de même que leur rapport au monde, mais cette familiarité n’est qu’une amorce, pas une finalité. Ce qui semble familier n’est pas forcément typique. »
Écrire n’est pas un long fleuve tranquille
De l’étincelle originelle au mot « fin », Les Corrections constitue une longue quête parsemée d’embûches. Pendant sept ans, le romancier trime dur, écrivant parfois les yeux bandés et les oreilles bouchées dans une pièce obscure. Il jette des milliers de pages au panier et termine 80 % du roman en 12 mois. Trop anxieux pour écrire, il perd des journées entières en les terminant en soirées arrosées de vodka. Entre-temps, son mariage part à vau-l’eau et, cerise sur le gâteau, son père est emporté par l’Alzheimer en 1992.
Créé en 1994, Chip est suivi de Denise, puis de Enid, Al et Gary. « Je ne m’intéresse à un personnage que lorsque j’ai inventé une situation dramatique ou des angoisses qui m’apparaissent comme un défi d’écrivain, dont je suis susceptible d’apprendre, qui correspondent à des conflits ou des angoisses de ma propre vie. Cela dit, je n’écris pas souvent en puisant dans ma vie parce qu’elle me semble à la fois trop ennuyante et trop sophistiquée pour m’inspirer une fiction intéressante, et aussi parce que mes sentiments personnels m’empêcheraient de m’aventurer trop près de la réalité. Alors je préfère m’inspirer de l’essence d’un fait puis inventer une situation dramatique qui me permettra d’en développer à la fois l’aspect horrible et tragique. En un sens, tous les Lambert sont des répliques de moi-même, quoique les détails de leur vie soient purement fictifs. »
Jonathan Franzen conçoit donc ses personnages avant l’intrigue. Échafaudée sur un graphique, la trame des Corrections suit cinq courbes suspendues entre deux axes (X et Y). Chacune de ces courbes représente le parcours émotionnel d’un personnage, une évolution dans le temps et l’espace qui alterne entre épisodes du passé et du présent. Curieusement, la maison de St. Jude, qui occupe un rôle prépondérant et apparaît presque comme un protagoniste, ne figure pas sur le diagramme. Alors que pour Enid elle représente « sa qualité de vie », elle n’est qu’un souci matériel à régler pour Gary, un paquet de souvenirs amoureux pour Denise, des dîners malheureux pour Chip et, pour Albert, calé dans son vieux fauteuil, une réalité qui s’amenuise. Franzen avoue bonnement que parce que « ce livre relate un drame domestique […], il fallait s’attendre à ce que la maison elle-même y joue un rôle essentiel à bien des niveaux. » Cette vision de l’intrigue ne doit pas étonner ; l’auteur, né en 1959 à Western Springs, dans l’Illinois, a vécu dans une maison semblable à celle décrite dans Les Corrections.
La vie, après
Abordant tour à tour des questions assez graves : peine de mort, soulèvements politiques, magouilles financières, avancées médicales neurologiques révolutionnaires, infidélité, homosexualité, trafic de médicaments, dépression, vieillesse, maladie et mort,, le troisième roman de Franzen (The Twenty-Seventh City et Strong Motions ? non traduits) constitue un éclectique tableau d’une Amérique déchue animé par une question ancestrale : peut-on réparer ses erreurs, et à quel prix doit-on les rembourser ? En 700 pages, Jonathan Franzen ne suggère pas de solution, même si l’épilogue, particulièrement intense, s’ouvre vers un avenir plus serein : « Il m’apparaît difficile de résoudre quelque problème social que ce soit sans créer un nouveau problème social ; cette évidence — comme celle de l’échec, comme celle de la mort ? est une source d’amusement pour mes collègues romanciers et moi. »
Après un million d’exemplaires écoulés et sept mois consécutifs au palmarès du New Yorker ; les droits d’adaptation vendus au réalisateur de Billy Elliot et ceux de traduction à quelque vingt-cinq pays, on peut d’ores et déjà accoler aux Corrections le titre de premier phénomène littéraire américain du XXIe siècle. En plein cœur d’un tourbillon médiatique depuis la sortie de son livre, Jonathan Franzen commence à peine à toucher le sol. « Je suis bien sûr flatté de toute l’attention critique qu’a mérité Les Corrections mais, comme écrivain, je crois que ma tâche consiste d’abord à écrire le genre de livres que j’aimerais lire. Ce qui me réjouit le plus depuis la sortie du roman, c’est de découvrir qu’il semble y avoir beaucoup de lecteurs, beaucoup plus que je ne l’aurais imaginé, qui ont l’air d’apprécier le même genre de livres que moi. Et puis, c’est aussi réconfortant pour un écrivain de savoir qu’il a écrit au moins un livre dont il n’a plus à se préoccuper. J’ai l’impression aujourd’hui que Les Corrections peut continuer son petit bonhomme de chemin tout seul, sans moi. C’est tout un soulagement. »