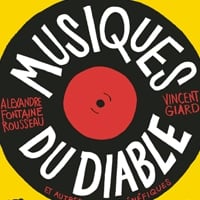Nous venions tout juste de monter dans la voiture après y avoir déposé les sacs d’épicerie. La radio s’est animée en même temps que je mettais le contact.
« Quelle est la chanson qui a changé votre vie? », demandait Marie-Louise Arsenault à une poignée d’invités. Ma fiancée et moi avons échangé un regard embêté. Pas évident, a-t-elle dit.
Comment choisir dans le tas? Et comment déterminer si une chanson a réellement altéré le cours de notre existence ou si elle s’est trouvée là, sur notre route, au moment crucial, servant simplement de balise sonore à notre autobiographie?
Qu’est-ce qui est venu en premier : la chanson ou la vie?
Cela dit, il y a bien des titres qui ont agi comme des marqueurs. Ils ont leur importance.
Money, de Pink Floyd, à 12 ans, à mon entrée dans l’adolescence et une nouvelle conscience du monde. God Save the Queen, des Sex Pistols, à 14 ans, annonce une sourde révolte d’enfant gâté. L’année suivante, Attends-moi d’Harmonium, Dazed and Confused de Led Zeppelin, Uncle John’s Band des Grateful Dead, Under My Thumb des Stones et Break on Through des Doors me font planer jusqu’à la fin de mon secondaire.
Je me souviens des nuits à écouter Siamese Dream des Smashing Pumpkins, rue Sainte-Angèle, j’ai 18 ans. Rid of Me de PJ Harvey, Dirty Boots par Sonic Youth, et Out There de Dinosaur Jr, chez mon voisin Renaud, rue Saint-Jean.
Pendant un an, tous les matins, j’ai commencé ma journée en écoutant Ouverture d’Étienne Daho, tiré de Corps et armes, en pensant à une fille. Chaque soir, Trying Your Luck des Strokes me disait qu’elle ne serait jamais mienne. Puis, il y a l’effet que produit chez moi Mustang, de Jean-Louis Murat, qui ne s’estompe pas malgré des centaines d’écoutes : c’est celui de la réalité augmentée avant l’heure, la mélancolie démultipliée par la musique, les mots, la belle voix traînante de l’Auvergnat.
Mais ces chansons ont-elles changé ma vie? Et autrement, le pouvoir de la musique existe-t-il toujours chez moi, ou était-il une affaire adolescente, de jeune adulte perméable à toutes les beautés?
C’est un livre qui allait y répondre, quelques jours plus tard. Musiques du diable et autres bruits bénéfiques, d’Alexandre Fontaine Rousseau (Ta Mère), m’est tombé dessus comme une révélation. Un espoir.
Il y a des romans qui vous donnent envie de tomber amoureux. D’autres, comme le tout récent Les égarés, de Lori Lansens (Alto), qui vous font apprécier d’être simplement vivant et né n’importe où ailleurs que dans la famille de merde du narrateur perdu en montagne.
Musiques du diable, lui, m’a rappelé ce qu’est vraiment la musique. Ce bouquin, qui rassemble les albums favoris de son auteur (illustrés par Vincent Giard) entre 2010 et 2015, m’a fait réaliser que j’avais tenu la musique pour acquise, et qu’elle m’avait donc laissé en plan.
D’actrice de ma vie, de moteur, elle s’était muée en une sorte de mobilier sonore qui venait simplement combler le silence, de liste de lecture en liste de lecture, avec ou sans algorithme.
Peu importe si les trois quarts des groupes dont parle Fontaine Rousseau m’étaient inconnus. J’avais envie de les écouter tous. Ce que je me suis mis à faire. Année après année, un album après l’autre. Son humour et son intelligence, la candeur des révélations qu’il étale avec simplicité sur les effets que lui procurent ces artistes : tout cela ranimait chez moi l’idée semi-comateuse d’une musique qui parle aux tripes et à l’intelligence. D’une musique exempte de descriptions stériles, d’étiquettes faciles. Une musique qui ne fait pas que meubler la vie, comme un divan, un frigo, et l’aimant dessus, mais qui donne du sens aux choses, qui enrichit l’expérience humaine.
Et si elle n’est pas un moteur de changement, une charnière, ça ne fait rien. Parce qu’elle est peut-être encore mieux que ça.
Je me suis surpris à sortir mes bouquins de Nick Tosches (Les héros oubliés du rock’n’roll et un recueil de ses meilleurs textes en anglais, The Nick Tosches Reader). J’ai cherché mais jamais trouvé le Greil Marcus que je croyais posséder (Mystery Train). J’ai relu des trucs tordants de Lester Bangs. Et puis aussi quelques critiques au vitriol ou imbibées d’un bonheur quasi extatique, découpées dans Télérama et Les Inrocks.
Je lisais tous ces gens, et je me répétais : voilà ce qu’est la musique. C’est un truc au centre de la vie. C’est pas consensuel. C’est pas unanime. Ça n’a même pas à être rassembleur.
« La critique musicale, c’est rendu ben, ben dull », disait l’auteur de Musiques du diable au collègue Dominic Tardif dans Le Devoir.
Peut-être le symptôme d’une époque qui s’excuse presque d’être là, la musique et sa critique sont devenues l’affaire de gens qui confondent l’analyse, l’objectivité et l’apologie du goût des autres. C’est rendu qu’il faut s’excuser de ne pas aimer. Ou presque. Et depuis quand, au juste, l’art est-il objectif?
Ce bouquin est un ricaneur fuck you au journalisme propre et lisse. Il célèbre une musique qui appartient à celui qui l’écoute et y trouve refuge. Parce qu’elle répond au monde de l’intime.
Elle offre une prise à laquelle s’arrimer dans ces vies de chaos, de quoi filtrer toute la merde qui s’y déverse. Elle donne du sens, de la beauté. Elle offre un matériau presque infini avec lequel façonner nos fantasmes et éponger nos pertes.
Il y a des livres qui donnent envie d’aimer, disais-je. Musiques du diable m’a fait retomber amoureux de la musique. Et si je ne sais pas trop pour les chansons, je tiens ici un livre qui a changé ma vie, tout en me faisant éclater de rire toutes les dix minutes.
Et puis écrire à son sujet m’a permis de me rappeler de la chance que j’ai. Parce que la fille de la chanson de Daho et de celle des Strokes est aujourd’hui celle avec laquelle je fais l’épicerie.