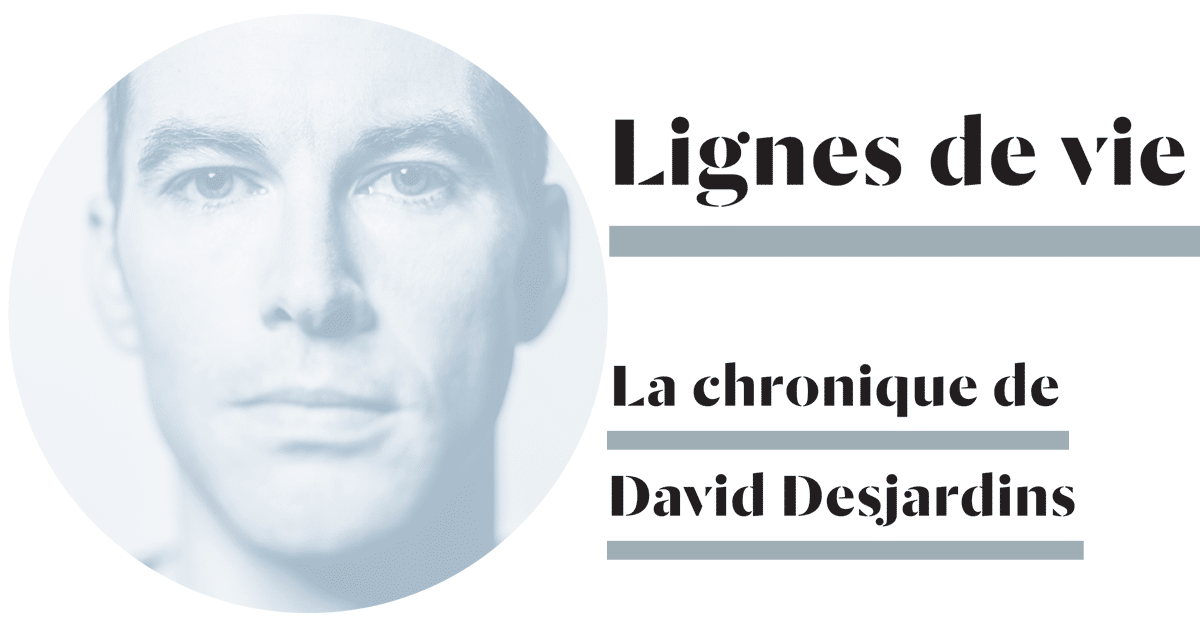C’est un truc qui s’ouvre quelque part entre la tête et le cœur. Une brèche.
Et si je peux me permettre : ce n’est pas vrai que c’est par là qu’entre la lumière. C’est par là qu’elle en sort.
Le plus souvent il n’y a rien à faire. La joie nous quitte, lueur liquide s’écoulant en rigoles, devenant un long ruisseau visqueux, impossible à endiguer, qui se déverse dans le néant de l’implacable drain des jours perdus. Ni tout le sport ni toute la dope ni toutes les nuits à danser ni les téléséries inhalées en un long rail de divertissement ni la bouffe avalée sans mâcher ni la colère ni l’achat compulsif ni le théâtre des réseaux sociaux n’y peuvent quoi que ce soit.
Ces heures d’éveil se déroulent dans un étrange brouillard. Ce sont des jours fantômes.
Cela m’arrive beaucoup moins souvent qu’avant, presque plus jamais, en fait, mais en lisant Le jeu de la musique de Stéfanie Clermont, j’avais le sentiment de passer le doigt sur les cicatrices des mille blessures invisibles qui m’ont autrefois fait tituber jusqu’au sommeil, bien que parfaitement sobre, incapable que j’étais de comprendre comment vivre dans un monde qui ne semblait pas vouloir de moi, comme je ne voulais pas de lui.
Une profonde mélancolie qui trouve sa plus funeste expression dans le suicide du personnage de Vincent, qui ouvre et ponctue tragiquement cette série de récits habiles, brillant par sa véracité comme l’unicité de ton qui tient l’ensemble en un solide ballot littéraire.
Ce geste, épouvantable, est une sorte de feu de tristesse autour duquel les personnages que l’on suit à différentes périodes de leur vie exécutent une sorte de danse macabre, condamnés, qu’ils semblent, à évoluer dans l’obscurité promise à ceux qui n’entrent pas dans l’étroit carcan socialdu auto-boulot-Costco.
À celles, aussi, qui n’ont pas la joie facile. Celles pour qui l’amour est un casse-tête auquel il manque toujours une pièce, et les amitiés un complexe rhizomede jalousie, de culpabilité, d’affection et autres non-dits qui pourrissent nos pensées.
Cette jeunesse-là se noie. Dans la dope et l’alcool. Elle cumule les boulots merdiques, le BS, les études qui n’en finissent plus, les conversations sans fin sur les mouvements étudiants, Occupy, le féminisme radical ou pas. « She’ssobusybeing free », chante Joni Mitchell, dans Cactus Trees, ne reste plus de temps pour vivre. Ou chercher où loge son bonheur.
Est-ce que cette tristesse permanente est le prix à payer pour s’affranchir du monde? Ou simplement de l’enfance, du début de l’âge adulte où nous sommes encore beaux et fous, épris de choses entières, totales, sans compromis.
Ce n’est pas un livre magique. Les chapitres s’accumulent comme un poids sur les épaules du lecteur qui prend ces destins en charge. C’est un ouvrage qui hante. Avec quelques idées qui sont comme des pointes de lumière, presque aveuglante dans ce brouillard de sentiments, de souvenirs, de désirs devenus désastres.
« Tu oublies que chaque fois que quelqu’un t’a trouvée, c’est que tu étais toi aussi sortie à sa recherche. » Boum. Leur passivité est une forme de sabotage.
L’autodestruction plane aussi dans le Delete de Daphné B. (L’Oie de Cravan). Sous forme de tout, y compris de suicide, encore.
Il plane… Disons qu’il plombe, plutôt.
Errances analogues, couchées sur le papier pour parvenir à se lever de son lit le matin. Ou au pire l’après-midi.
Heureusement qu’il y a le geste d’écrire pour passer à travers cette déprime d’avenir bloqué et d’amours amères. Et la musique, les chants cathartiques d’Edward Sharpe, ou la possibilité de fuir vers Taïwan pour y enseigner l’anglais.
Même si la fuite s’avère vaine, on en ramène de petites perles de sagesse qui permettent de retourner les clichés comme un gant : « Les voyages forment la jeunesse, même pas vrai. La jeunesse forme les voyages et tout ce qu’on pense y trouver. »
Cela peut se produire à tous les âges : découvrir qu’on nous avait menti. Qu’on ne peut pas faire tout ce qu’on veut dans la vie. Même pas vrai. On fait ce qu’on peut. Ce sera peut-être même suffisant.
Le discours ambiant est un leurre. Une marmite remplie d’or au bout de l’arc-en-ciel.
Au fond, il faudrait répéter que ce sera dur. Que la quête du bonheur est une course à obstacles où la vie vous fait en plus quelques jambettes. Que les convictions sont lourdes à porter, si bien qu’elles deviennent un fardeau, qu’elles rendent malheureux. Que l’amour est parfois un poisson qu’on attrape en espérant qu’il continuera de frétiller même en le conservant hors de son élément.
On devrait nous dire plus tôt qu’il faudra composer avec cette mélancolie qui est imbriquée dans la nature humaine, qui en est le tissu, la fibre, mais qu’on tente d’oublier parce qu’on ne sait qu’en faire, parce qu’elle nous gêne dans notre course vers le bout de l’arc-en-ciel.
Les livres? Au mieux, ils nous font sentir moins seuls. Ils nous font réaliser que cette mélancolie est affaire de condition humaine. Et la lecture un vecteur d’empathie.
Ceci n’est pas une autre chronique sur la beauté dans la fêlure. Ce qui m’intéresse, c’est d’en suivre le tour, d’entrer dans la tête, de sonder l’âme humaine. Belle, pas belle, je m’en fous de plus en plus. Je ne cherche plus de médicament dans les livres.
Alors je cherche quoi? Je cherche un geste, une main qui s’agite hors de l’eau. L’acte d’écrire pour s’en sortir. Je cherche dans les livres une preuve de vie.