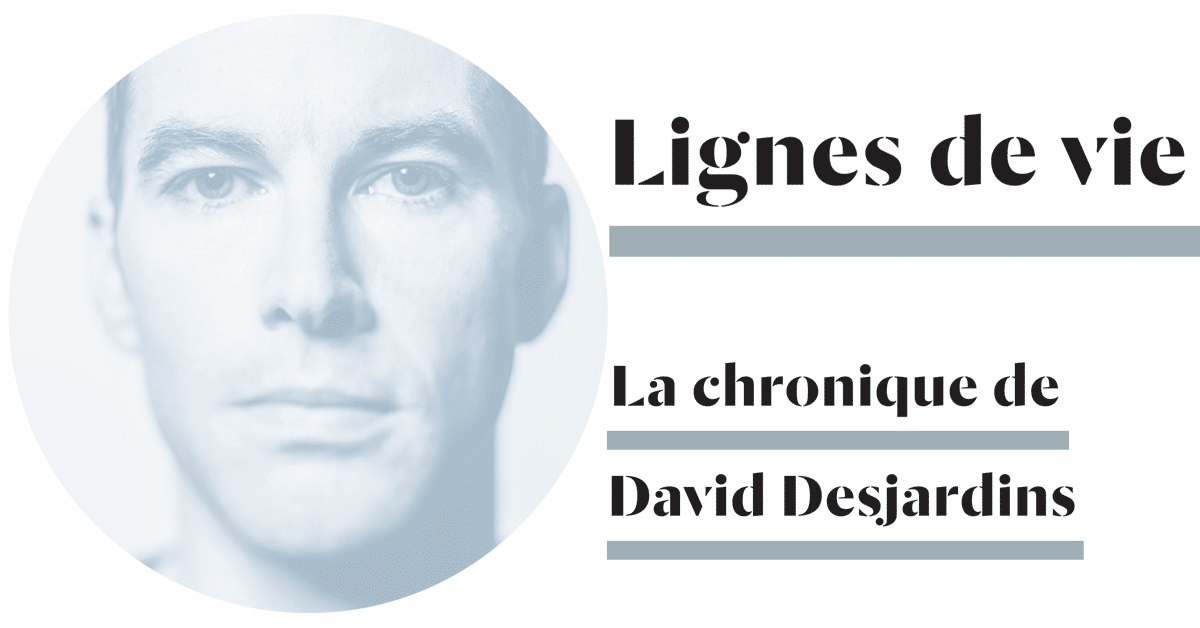Il n’y a pas plus fictif que le personnage que chacun se façonne pour l’envoyer vaquer à mille occupations dans le monde extérieur. La vérité? Elle est ailleurs, en nous, dans un tumulte d’idées et de sentiments qui ne nous honorent pas nécessairement. D’où le secret auquel ils sont le plus souvent confinés.
Ce domaine de l’intime ne reste accessible que pour ceux qui ont le privilège d’obtenir la clé de cet espace où s’accumulent nos névroses, dans un foutoir semblable à celui des casiers d’entreposage d’un épisode de Storage Wars.
Mais chaque porte en cache une autre, et le dévoilement de notre vérité profonde est le plus souvent involontaire. Notre personnage est si lisse, et comme rien n’y colle, il est tellement plus facile à faire évoluer dans le monde. Comme dans tout bon récit, il faut un événement, une perturbation, pour que la vérité fasse craquer la façade.
C’est là, à chaque drame, chaque crise, chaque étonnante anecdote qui rompt avec l’image projetée sur l’écran social que, généralement, je répète pour une millième fois au moins qu’on ne connaît pas les gens.
Dans les couples, le mystère est plus insondable encore. Il n’est pas double, mais démultiplié. Chacun y trimbale sa part de secrets, qu’il dévoile à l’autre à l’envi, ou pas du tout. Puis il y a la vie du couple, ses rapports, relevant eux aussi d’un monde réservé aux membres de la secte conjugale… selon le degré de discrétion de chacun.
Couple parfait dont on devine qu’il laisse fermenter le pire sous son vernis ou duo gueulard dont les chicanes de surface dissimulent des troubles d’ordre tectonique : rien n’est jamais totalement vrai dans les dehors conjugaux. Sauf dans les romans, bien sûr. Parce qu’il n’y a pas plus authentique qu’un personnage qui n’a ni ego ni image sociale à défendre devant nous, et dont l’auteur sonde la vie intérieure pour que son lecteur et sa lectrice puissent enfin se reconnaître réellement dans quelque chose.
Pas besoin que le miroir nous renvoie une image identique. C’est le poids des secrets que l’on partage avec les personnages qui nous soulage du nôtre.
J’ai ainsi passé quelques décennies cathartiques avec Corinne et Russell Calloway, le couple dont Jay McInerney tisse l’union depuis Trente ans et des poussières, puis dans La belle vie, et enfin, dans le très beau Les jours enfuis. Toujours avec Manhattan en toile de fond. Les gens riches et célèbres. Et mille désirs, d’autres vies et de réussites professionnelles. Celui de durer, aussi, dans ce monde qui vous pousse sans cesse dans les bras de la nouveauté, soit-elle dans les rayons chez Brooks Brothers ou dînant en face de vous dans un restaurant à la mode du Meatpacking District.
Habile, McInerney joue d’ellipses, puis remonte le fil des ruminations de ses personnages pour mieux exposer ce qui les anime. Derniers des romantiques au milieu des gratte-ciel indifférents, Corinne et Russel luttent. Entre eux, parfois contre eux-mêmes. Surtout en faveur de l’art et de l’amour, contre le pouvoir et l’argent.
Le vieil ami de Bret Easton Ellis construit des figures complexes, bourrées de contradictions, hantées par le passé. Non pas seulement en raison des secrets qu’ils trimbalent, comme les bruits de chaîne d’un spectre bidon dans un épisode de Scooby-Doo. Mais surtout parce que ces jours enfuis témoignent de nos renoncements, de nos mauvais choix, de cette vie qui file trop vite. « The days run away like wild horses over the hill », dirait Bukowski.
Toujours le couple. Complètement dément dans le I Love Dick de Chris Kraus. Ici, au sein d’une autofiction qui relève autant de la littérature que de l’art actuel : si les références à Sophie Calle dans ce bouquin complètement déjanté sont explicites, c’est parce que l’auteure s’adonne au même dévoilement que l’artiste dans son œuvre-filature Prenez soin de vous, que j’avais vue il y a quelques années au Musée national des beaux-arts de Québec. Chez Calle, l’objet de l’obsession est un ex. Pour Kraus, il s’agit de Dick, rencontré une seule fois, mais dont elle tombe amoureuse en lui écrivant des lettres… avec son mari, ce qui recolle le tandem essoufflé, et le fait imploser aussi…
Tout est fou et parfait dans ce livre aux personnages détestables et attachants. Kraus y démonte la mécanique du couple, et celle du désir, elle en étend les pièces au sol puis en fait le rigoureux inventaire, dans un degré d’impudeur favorable au bouillon de culture du malaise qu’est ce livre. Mais c’est la découverte de l’autre qu’elle fait à travers cet exercice épistolaire qui est fascinante. Une œuvre commune qui fait de leur cri existentiel un chant choral, mais plus encore, leur permet de vivre ensemble, vraiment. « … ils se couchèrent, épuisés, habitant pour la première fois le même temps et le même espace », écrit-elle.
Plutôt que la vérité, c’est le secret qui préserve l’union de Lotto et Mathilde, les protagonistes du magnifique Les furies, de Lauren Groff, avalé d’un trait pendant les vacances l’été dernier.
Les furies est une célébration. Une fable jubilatoire sur le pouvoir de l’amour, mais surtout celui des femmes à l’intérieur de la cellule bicéphale du couple, et plus encore en dehors. C’est une ode au sexe comme ciment conjugal. Un déploiement d’intelligence, de tendresse et de secrets tenus au chaud dans le cœur d’un amour immense.
Combat contre le temps, contre ces jours qui nous glissent trop souvent des mains plutôt que de fondre sur nos langues, le couple est lui aussi une fiction que nous créons et envoyons dans le monde. Il est un idéal. Celui que nous imaginons, sculptons, que nous voudrions durable et puissant. Mais pour cela, nous disent tous ces auteurs, il faut l’élever. Au-delà de l’arrangement, par-delà la famille et les constructions sociales.
Le mariage – religieux, symbolique, ou union de fait – n’est pas un contrat. C’est un combat contre l’ennui. C’est une manière d’inventer sa vie, de se fabriquer un monde à l’intérieur du monde, souvent même contre celui-ci. C’est à la fois une fusion et une danse sur la frontière floue des individualités. C’est un jeu avec le secret, la vérité, la fiction, qui, s’il ne nous écrase pas vivants, nous projette vers quelque chose de plus grand, qui nous dépasse.
Bref, c’est un art.