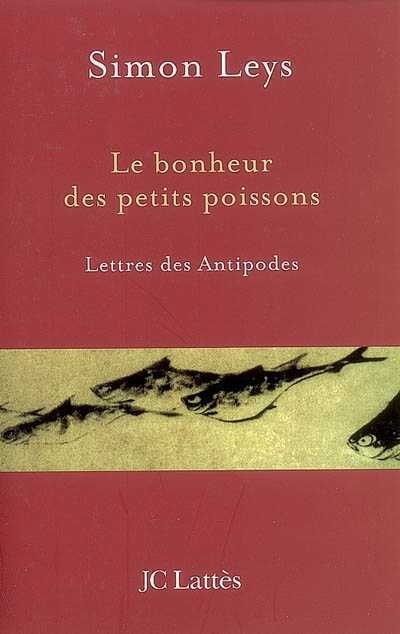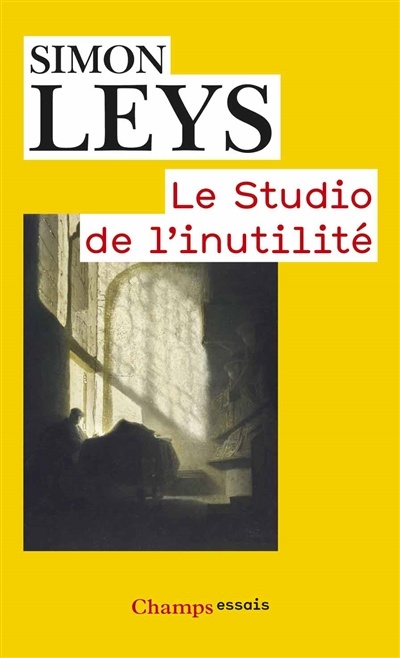Simon Leys est mort chez lui, à Rushcutters Bay dans la banlieue est de Sidney, le 11 août 2014. Le lendemain, au Dakota Building de New York, Lauren Bacall fermait définitivement ses yeux. J’ai noté dans un carnet ces deux disparitions, d’un sinologue et d’une star; inutilement, car je n’oublierai jamais ces êtres-là, un intellectuel qui se méfiait des emballements d’intellectuels et la veuve de Bogart que j’avais vue en chair et en os au Palace Theater de Manhattan en 1970 dans Applause, une comédie musicale (très en dessous du film dont elle s’inspirait, All About Eve de Mankiewicz) qu’elle électrisait de sa présence.
Pourquoi les réunir, ce sinologue homme de lettres discret et la star brûleuse d’écran? Lui l’avait admirée dans The Big Sleep, dans Key Largo, j’imagine qu’il l’a vue dans ce film américain des années 50, Blood Alley, dont l’action (la traversée du détroit de Formose par des Chinois opprimés fuyant à Hong-Kong) se déroule au temps de la Chine communiste, cette Chine de Mao et sa Révolution culturelle dont il fut le premier, lui, Pierre Ryckmans, s’inventant le pseudonyme de Simon Leys, à dénoncer la barbarie, la grande arnaque intellectuelle et, comme il osa l’écrire dans Les habits neufs du président Mao en 1971, en plein délire mao-mao-parisianiste, « cette lutte pour le pouvoir, menée au sommet entre une poignée d’individus, derrière le rideau de fumée d’un fictif mouvement de masse ».
Né à Bruxelles en 1935, fils d’éditeur, Pierre Ryckmans avait à 19 ans participé à un voyage d’étudiants en Chine et là commença sa fascination pour la culture chinoise, son histoire, son art, sa calligraphie. Pour s’ouvrir à cet univers, il va apprendre et maîtriser la langue et puis il fera plusieurs séjours à Singapour, à Taïwan, à Hong-Kong; la Chine contemporaine qu’il va avoir sous les yeux, avec quelque chose de Voltaire dans le regard, un sens de la justice aigu, va le bouleverser. Le choc se produira à Hong-Kong un jour de 1967 lorsqu’il découvre devant sa porte un journaliste chinois agonisant après avoir été torturé par les nervis de Mao. En trois ans, il rédige ce fameux livre, Les habits neufs du président Mao, immense pavé dans la mare de la France où le culte de Mao est à son comble, où les intellectuels (surtout ceux du groupe Tel Quel, dirigé par Sollers) vont stigmatiser Leys, le traiter de vil capitaliste, et révéler sa véritable identité (ce qui était une incitation à son élimination…). Leys devenait pour l’intelligentsia de gauche le sorcier à chasser. Trente ans plus tard, Sollers a reconnu la justesse d’analyse de Leys et qualifiera son attitude d’alors (sa croyance en la Grande Révolution culturelle prolétarienne, la mise aux fers de Simon Leys) d’erreur de jeunesse…
Il ne faudra jamais oublier cet homme qui vient de mourir en Australie, où il vivait « far from the madding crowd », exilé volontaire, l’allié de personne, et Internet est là pour revoir cet Apostrophes d’anthologie où, en 1983, il faisait face à l’intellectuelle communiste italienne Maria Antonietta Macciocchi, l’auteure de la brique De la Chine. Tranquille, posé, Simon Leys, après l’avoir écoutée, laissa tomber : « De la Chine, c’est… Ce qu’on peut dire de plus charitable, c’est que c’est d’une stupidité totale, parce que si on ne l’accusait pas d’être stupide, il faudrait dire que c’est une escroquerie… ». Le lendemain, les ventes des livres de Macciocchi chutaient brutalement, définitivement.
Ce serait une erreur de croire que Simon Leys ne fut qu’un sinologue, le Voltaire de Mao. Il fut aussi un chroniqueur littéraire de premier plan, un des plus importants, car il était un intellectuel d’une rare exigence morale qui, avec ironie, causticité, férocité parfois et curiosité toujours, a profondément commenté la littérature d’hier et d’aujourd’hui et fréquenté les écrivains dans leurs œuvres avec une admirable attention, jamais de complaisance. Un critique idéal, c’est-à-dire un grand lecteur, qui savait évoquer les faiblesses d’un auteur que, par ailleurs, il admirait, comme Conrad, Gide, Orwell, Michaux, Nabokov ou le prince de Ligne qui, écrivait-il dans son dernier ouvrage, Le studio de l’inutilité, était dans les lettres et les arts un « amateur » au sens le plus profond, le plus complet et le plus fécond du terme, mais qu’il « ne résistait jamais à la tentation d’un mauvais jeu de mots »… Angelo Rinaldi, du temps de ses chroniques assassines à L’Express, et Bernard Frank, du temps de ses chroniques aériennes au Nouvel Observateur, avaient quelque chose de Leys, mais Simon Leys était unique.
Normalement, Simon Leys n’aurait pas sa place ici, dans la chronique En état de roman, car, s’il a écrit un roman – La mort de Napoléon (Éditions Hermann, 1986, épuisé) où il imagina que ce n’était pas l’empereur qui était mort à Sainte-Hélène mais un sosie que l’homme d’État avait engagé avant de fuir pour vivre incognito -, il n’est pas un romancier. Il est un écrivain. J’admirais tant la plume de ce compagnon de route littéraire que je me permets de lui faire une place, accompagné de Lauren Bacall, sous cette enseigne dont je vous rappelle que je l’ai prise chez Simenon : « Ça n’est jamais deux fois la même chose; mais on peut dire que ça naît fortuitement, c’est-à-dire que je m’aperçois que je suis en état de roman, que j’ai besoin de me mettre dans la peau de quelqu’un autre, que j’en ai assez de ma peau à moi ».
S’agissant de Simenon, Leys occupait depuis 1990 à l’Académie royale de langue et de littérature françaises de Belgique le fauteuil de l’auteur des « Maigret » (pas loin de celui de Marie-Claire Blais). Dans son discours de réception, ayant à faire l’éloge de son illustre prédécesseur, lui dont les lecteurs savaient qu’il n’avait pas de penchant particulier pour l’ « industriel des lettres », comme il osait le nommer, évoquant ses 57 traductions, ses 450 romans et ses supposées 10 000 femmes séduites, il ajouta ceci qui était du pur Leys : « Au fond, la grâce d’écrire des romans est un peu à l’image de la grâce de Dieu : arbitraire, incompréhensible, et d’une sublime injustice. Ce n’est pas un scandale que des romanciers de génie s’avèrent être de pauvres types; c’est un réconfortant miracle que de pauvres types s’avèrent être des romanciers de génie ».