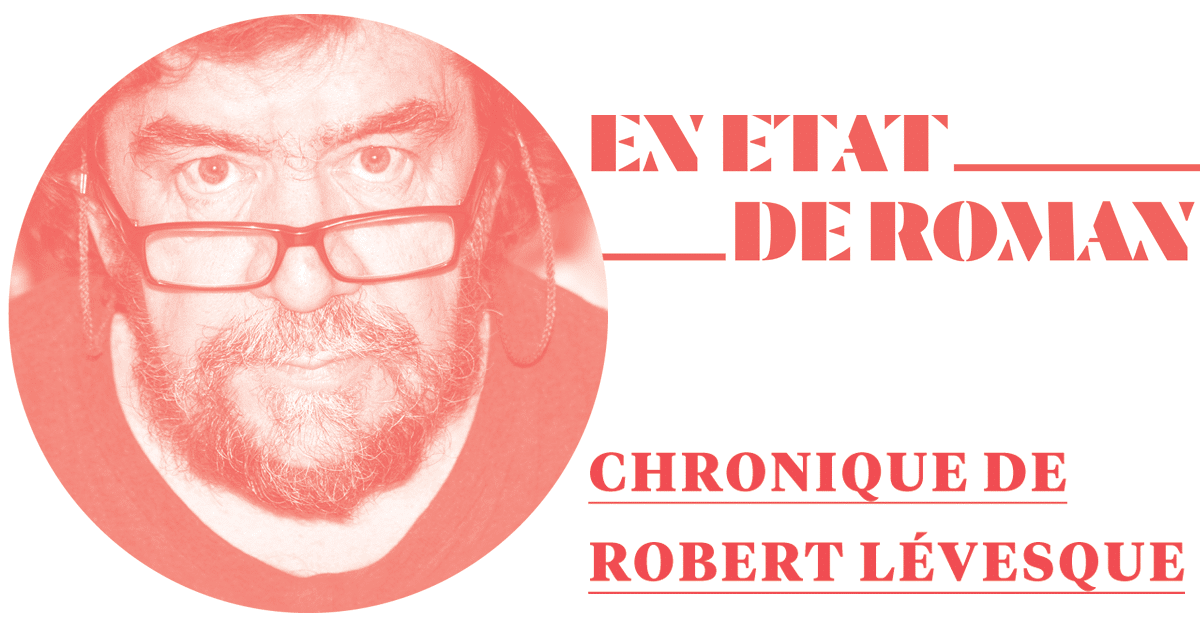Virginia Woolf, sa contemporaine mais à mille lieues de lui question de littérature, confia à son Journal, le 17 juin 1918, qu’elle considérait que le romancier si populaire H. G. Wells, qu’elle trouvait « épais, formidable de stature », était « pour le reste, du genre joueur de cricket professionnel ».
Dans ses savoureux mémoires, Voices, publiés en 1983 (Voix dans la nuit chez Phébus en 2004), l’Américain européanisé Frederic Prokosch se rappelait d’une conversation à Cambridge où, ayant demandé à un illustre professeur et à sa femme quels étaient selon eux les romanciers vivants « dignes d’être approuvés », le nom de Wells fusa aussitôt mais ce fut tranchant : « Bien entendu, il est exclu ».
Wells se trouvait exclu d’évidence du groupe des romanciers « dignes d’être approuvés » par le couple Leavis (lui irascible, elle menaçante, précise le suave Prokosch) car l’aréopage agréé par ce couple comprenait James Joyce, Virginia Woolf, D. H. Lawrence, E. M. Forster, T. F. Powys et L. H. Myers. Notons le chauvinisme des Leavis (aucun n’ayant cité Céline, Hemingway, Kawabata, Faulkner), et notons que l’époque avait horreur des prénoms composés, les initiales faisant florès : H. G., D. H., E. M., T. F., L. H.; j’ai une pensée pour le poète américain e. e. cummings qui, lui, tenant non seulement à ses initiales, les imposait en lettres minuscules…
Entrée en matière de guingois pour causer du romancier H. G. Wells, je vous l’accorde, mais c’est que je n’ai pas en haute estime cet écrivain britannique qui a trop écrit, 45 romans, des contes, des nouvelles, des essais, dont la presque totalité de l’œuvre est tombée dans l’oubli, mis à part (c’est pour cela qu’H. G. Wells survit et renouvelle son lectorat à chaque génération depuis sa mort en 1946) ses quatre romans de science-fiction qu’il écrivit au début de sa carrière, quatre romans inoubliables aux histoires bouclées en quatre ans, de 28 à 32 ans, dont les titres sont à eux seuls des promesses renouvelables de lecture passionnante.
Le premier, paru en 1895, La machine à explorer le temps. Suivirent comme s’il était pris d’une rage d’écrire, de faire frémir, L’île du docteur Moreau, L’homme invisible, et, tout aussi chef-d’œuvre que les trois premiers, La guerre des mondes. Un quatuor de choc. Et autant de chocs pour les jeunes lecteurs et les moins jeunes du monde entier, comme les Tintin mais en mode épouvante.
Fils d’une servante et d’un fainéant, qui dut bosser (caissier chez un drapier) pour fréquenter une école normale de science à South Kensington où il eut la chance d’avoir un savant comme professeur (le grand-père d’Aldous Huxley qui laissera lui aussi un roman assuré d’une solide postérité, Le meilleur des mondes, à la tonalité plus pessimiste que La guerre des mondes de Wells), le jeune Wells se débrouillera très vite pour vivre de sa plume (il ne voyait pas d’autre chose à faire), articles remarqués, nouvelles publiées, piges, une ambition avec un grand A et incidemment l’achat d’une bécane qui ne sera pas sans importance car, comme il l’avoua plus tard dans Une tentative d’autobiographie, découvertes et conclusions d’un cerveau très ordinaire, paru en 1934, sa pratique quotidienne du vélo devint une discipline, c’est en pédalant qu’il réfléchissait à ses idées de fiction, à ses livres, à ces imaginations fantasques comme voyager dans le temps, se rendre invisible, créer des humains avec des greffes sur animaux, assister à l’envahissement du pays par des extraterrestres. Ces quatre romans-là écrits, publiés, salués, encensés, primés, réédités, traduits, qui seraient tous adaptés au cinéma, l’installèrent dans le confort et il abandonna la bicyclette.
S’ensuivrait au début du XXe siècle une série ininterrompue (il publie comme il respire) de livres, des romans d’amour, des essais sociologiques, des récits de guerres dans les airs, des portraits de couples (dont Mariage, plus de 550 pages), des histoires de fourmis (bien avant celles de Bernard Werber), des esquisses d’histoire universelle, des récits de voyage dont un en Russie avant la Révolution où il soutient le tsarisme et un autre après la Révolution où il louange le bolchevisme, bref Herbert George Wells usina sa vie durant toutes sortes de bouquins aujourd’hui livrés à la poussière des bibliothèques publiques s’ils ont échappé aux pilonnages.
Les Leavis de Cambridge, couple universitaire guindé dont se moque Frederic Prokosch dans Voices, n’étaient pas du genre à avouer le plaisir qu’ils auraient pris à lire La machine à explorer le temps car ils étaient trop bien collés au leur, victorien à l’os, ni à aimer s’imaginer disparaître de la vue de leurs contemporains comme Griffin qui réussit, après avoir rendu un chat invisible, à se rendre invisible lui-même et à en vivre les terribles conséquences, ni à apprécier le trip de se retrouver en l’an 802,701 où le monde est petit de taille dans des vêtements de coupe uniforme et menacé d’être dévoré la nuit par les Morlocks remontés des profondeurs de la terre, et encore moins à frémir de voir des hommes-bêtes répugnants briser leurs vacances dans une île où un médecin amoral se spécialise dans les greffes les plus folles… « Bien entendu, il est exclu ».
La célébrité d’H. G. Wells atteindra des sommets moins élevés que ceux de Charles Dickens, mais tout de même assez hauts, et l’homme (d’allure respectable d’un Jacques Parizeau) aura toujours su défrayer les manchettes mais pas nécessairement dans les pages littéraires des journaux de Fleet Street, plutôt dans les rubriques politiques et mondaines. D’une part, il frayait avec les grands, Lénine puis Staline, des présidents américains dont Theodore Roosevelt, dînant au Kremlin comme à la Maison-Blanche, causant de sa grande utopie, celle de voir le monde unifié, l’Est et l’Ouest allant la main dans la main.
Outre ce profil politique naïf, Wells laissa dans son sillage le portrait particulièrement prononcé d’un homme à femmes. « Aimer les femmes est une nécessité vitale, incontrôlable », écrit Laura El Makki, sa plus récente biographe. Il les multipliait : ici une fille de pasteur, là une étudiante, ici une lectrice, là une collègue romancière, voire une épouse malheureuse, une rousse étrangère, et pire, une amie de sa femme, car le chaud lapin s’était marié avec une compréhensive femme qui lui passa tout et s’occupa de ses manuscrits, étant sa première lectrice, une remarquable et dévouée compagne qui lui cacha même qu’elle préférait lire Proust et Katherine Mansfield plutôt que – outre ses quatre chefs-d’œuvre de science-fiction – les romans annuels de son mari aux sujets inépuisables et banals…