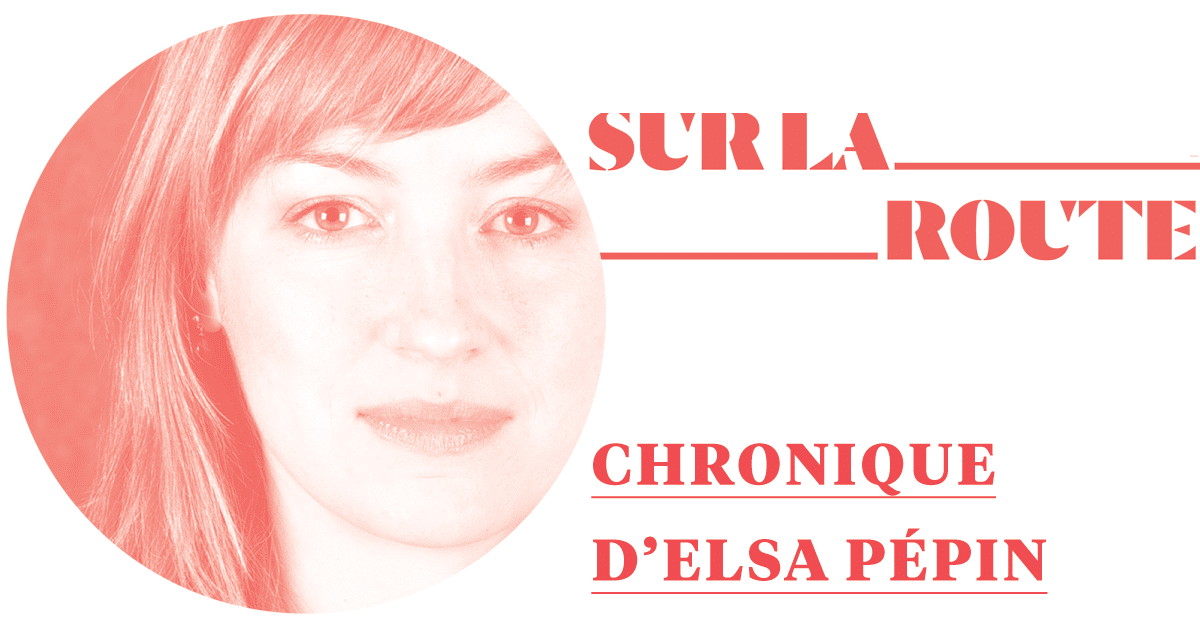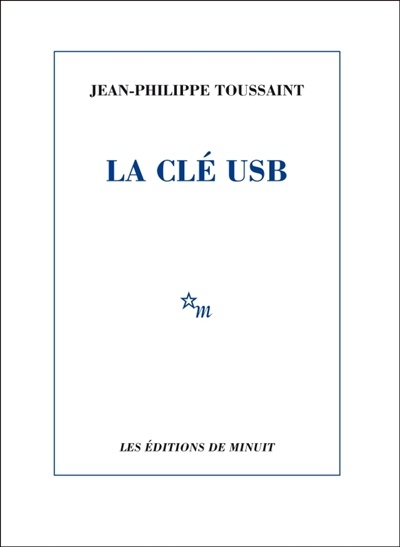Face à la souffrance, notre esprit trouve parfois des détournements pour ne pas voir ce qui fait mal. Deux livres nous racontant comment faire dévier la douleur nous la ramènent finalement en face.
C’est d’abord l’histoire d’un amour particulier pour une couleur, en l’occurrence le bleu. Entre la confession amoureuse et le traité philosophique, Bleuets raconte l’influence de cet amour dans la vie de la narratrice et sa tentative pour s’en libérer. Renouant avec une construction par fragments flirtant librement avec l’essai, la poésie, l’autobiographie et la théorie littéraire, l’Américaine Maggie Nelson promet d’expliquer notamment en quoi des lambeaux de sacs de poubelle bleus sont pour elle des empreintes de Dieu! Elle cite des poètes, philosophes et musiciens qui ont pensé, écrit, chanté le bleu ou eu un intérêt pour les couleurs à un moment de leur vie. Entre le bleu Yves Klein, les Blue Devils de Lowell et le goût pour « l’heure bleue » de Joan Mitchell, les anecdotes foisonnent et assez vite surgit en contrepoint un second récit personnel, parallèle et en même temps lié à l’autre. « Je désire que tu cesses de me manquer », écrit Nelson, lançant une adresse à l’amoureux qui a rompu avec elle.
Croisant les deux histoires amoureuses, Nelson détourne son attention d’une douloureuse séparation vers une couleur lui permettant de réfléchir à l’amour. Détournement, soit, mais le bleu finit par se fondre à la personnalité de l’auteure et à permettre de multiples entrées dans sa psyché et son imaginaire. « Et quel genre de folie est-ce là de toute façon, être amoureuse de quelque chose qui est par nature incapable de vous aimer en retour? », demande-t-elle, ajoutant que « personne ne sait vraiment ce qu’est la couleur (Peut-elle mourir? A-t-elle un cœur?) ».
Jouant de manière inusitée entre la théorie et l’intime, Nelson compose un récit unique sur le deuil amoureux, la perte, la guérison. Le bleu devient un prétexte, un outil, un axe pour faire dévier la souffrance de l’être perdu, mais aussi un révélateur. « J’ai surtout l’impression de me transformer en servante de la tristesse », écrit-elle, résistant toutefois à faire entrer l’amour dans un mode d’emploi ou une grille d’analyse cartésienne. « La psychologie clinique oblige tout ce que nous appelons amour à rentrer dans des cases du pathologique, du délirant ou du biologiquement explicable », se plaint-elle, refusant d’adhérer à la conclusion de sa psy : « S’il n’avait pas menti, ça n’aurait pas été lui. »
Affranchie des codes littéraires, Nelson poursuit une démarche littéraire hors catégorie où s’interpénètrent les genres, les formes et les registres, élargissant pour le bonheur des lecteurs le prisme habituel de l’analyse et du discours. À l’instar de son précédent ouvrage, Les Argonautes, qui semblait mieux cerner son sujet toutefois, elle cite abondamment un corpus mêlant théorie littéraire, poésie, philosophie et vécu en un étrange tissage intuitif donnant lieu à de fulgurantes beautés comme à certains passages plus fades. L’étude chromatique mute en enquête sur les ténèbres du deuil amoureux, la solitude, le spleen, l’anxiété qui les accompagnent. Et le bleu, « ce fol accident produit par le vide et le feu », devient bien plus qu’une couleur : « un élément, un cœur, un esprit », une manifestation de la beauté à laquelle toutes les associations deviennent signifiantes parce que liées au sujet qui écrit. « Mais si l’écriture déplace effectivement l’idée — si elle l’expulse, pour ainsi dire, comme on ferait passer de l’argile humide par un trou —, où finit l’excès de matière? » Si avec le temps, l’être perdu cesse de nous manquer, il laisse une trace, nous confie Nelson. Et ce livre forme un écrin merveilleux pour tous les enténébrés du deuil qui choisissent de regarder encore la lumière.
Un long détour
Dans un tout autre registre, le héros de La clé USB détourne aussi son attention d’une douleur mais de manière inconsciente. Fidèle à son habitude, Jean-Philippe Toussaint construit un récit réaliste d’une précision chirurgicale sur nos obsessions contemporaines. Il s’attarde à un fonctionnaire travaillant à la Commission européenne pour une unité de prospective stratégique, spécialiste du blockchain, une technologie de stockage des transactions. Le héros se fait approcher par des lobbyistes et offrir un voyage à Dalian, en Chine, en parallèle d’une conférence qu’il doit donner au Japon. Ce blanc de quarante-huit heures dans son emploi du temps, cette « zone d’ombre », cette absence ou cette parenthèse, crée un court-circuit dans sa vie, génère une suite de catastrophes — il se fait voler son ordinateur dans une salle de bain, n’arrive pas à livrer sa conférence — et constitue, un peu à la manière du bleu chez Nelson, un élément sur lequel projeter ses inquiétudes, ses angoisses et ses peurs.
Ce blanc est causé par la découverte d’une clé USB contenant des informations confidentielles, mais l’essentiel réside dans le fait qu’il a caché avoir trouvé cette clé, provoquant la rupture dans sa vie. À son retour à Bruxelles, retrouvant son père mourant, cet expert de l’avenir de l’alimentation, de l’OTAN — mais jamais de son propre avenir —, sera rattrapé par la vie, l’émotion et se demande s’il n’a pas « construit des sujets d’inquiétude artificiels pour [s]e détourner de l’anxiété plus foncière, la seule qui importait […], la vraie nature de l’angoisse qui [l]’étreignait ».
Savante et drôle, cette incursion de Toussaint dans le roman d’espionnage est absolument réussie, faisant de ce récit sous tension qui parodie la culture technologique et critique le délitement d’un certain humanisme européen une étonnante étude de l’intimité d’un homme dans son lent effondrement. Le dénouement rappelle combien nous sommes forts pour trouver des subterfuges pour nous détourner de la douleur, et combien il faut parfois de longs détours pour y revenir, même si on la drape d’un bleu profond ou la cache dans une clé USB.