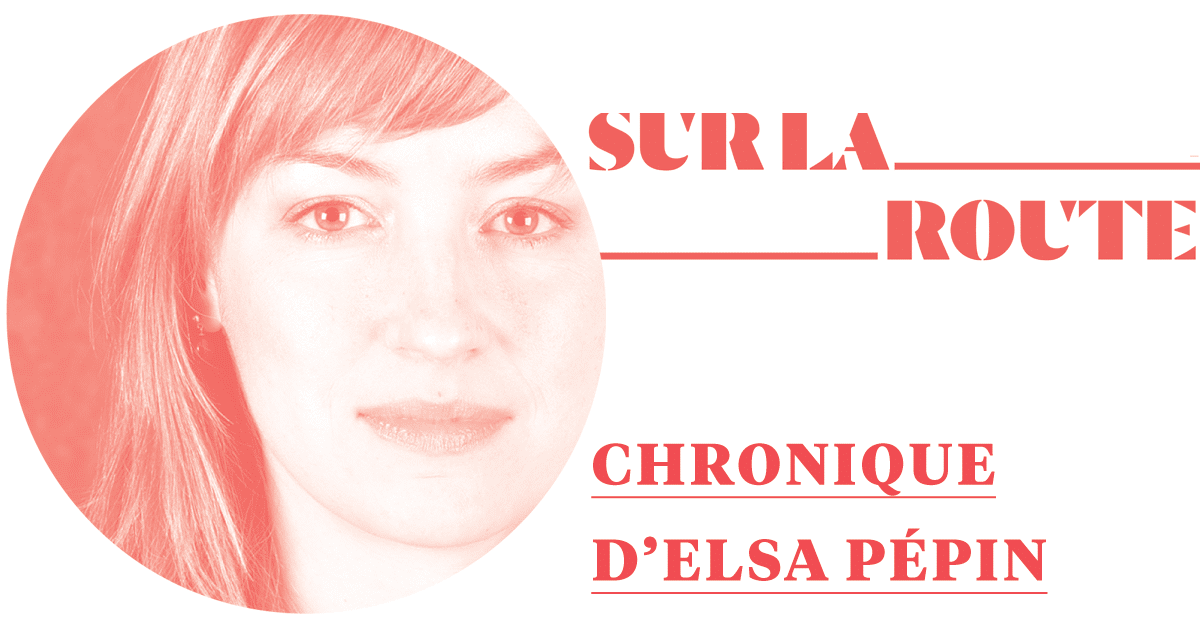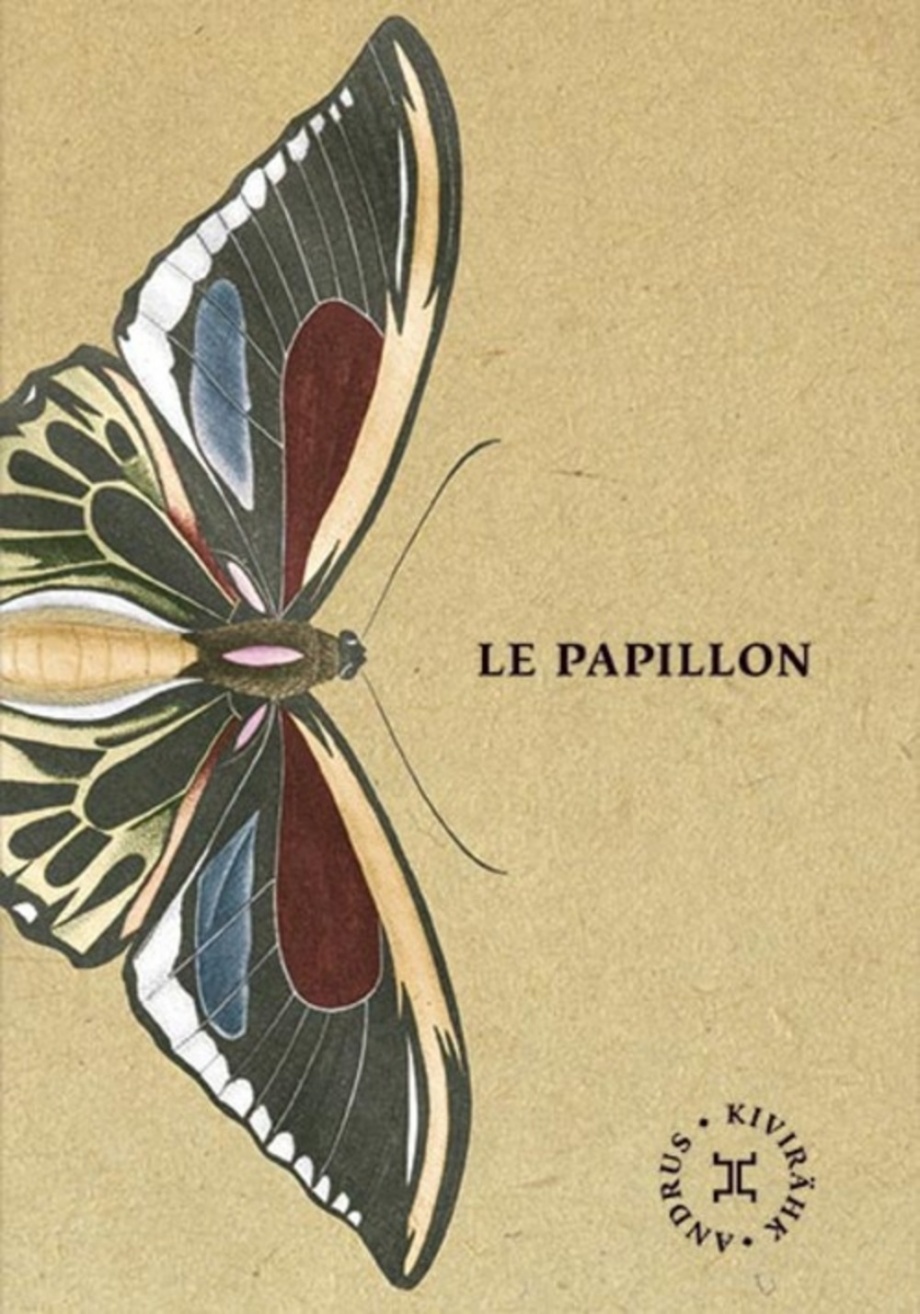C’est l’histoire d’un chien tuant un papillon. Qu’ils soient vrais ou les symboles d’un plus grand combat entre la mort et la vie, au lecteur de décider, mais, chose certaine, l’écrivain estonien Andrus Kivirähk sait équilibrer avec justesse fiction et réalité pour créer un conte aussi noir que magique avec Le papillon.
En plein cœur d’un pays au-dessus duquel plane la menace imminente de la guerre, où chacun, obsédé par le présent et sa survie, n’a plus le loisir de rêver, August Michelson passe d’une vie de serrurier à l’usine à celle de comédien à l’Estonia, un théâtre qui va devenir sa seconde nature, la source miraculeuse où s’abreuver dans un monde de misère. « On venait de me repêcher dans la rivière et on m’avait mis à sécher au soleil, me destinant au grand feu qui apporterait un peu de réconfort à ce monde humide et détrempé. »
Un peu sur le mode de La vita è bella de Roberto Benigni, Le papillon fait fleurir la joie de vivre et le rêve à même la morosité et l’horreur. L’imaginaire devient échappatoire d’une réalité sans espoir. Réunis autour de l’Estonia, le narrateur et sa bande – personnages loufoques et improbables qui valent à eux seuls le détour – partagent une aventure proche des contes de fées, balisée par la fête, la danse, mais aussi la mort, souvent jouée sur le mode comique à la manière des écrivains d’Europe de l’Est. Ainsi, lorsque la vodka offerte aux obsèques de leur ami Johanson leur monte à la tête tel un philtre ensorcelé, ils se mettent à voir de petits diablotins noirs et cornus déambuler sur la table et flâner entre les saucisses, mais aussi : Johanson lui-même! Le discours empreint de lyrisme de leur camarade trépassé, qui ne lui ressemble pas, amène le narrateur à conclure que la mort change un homme. Entre bouffonnerie et tragédie, l’auteur ose un amalgame baroque d’une étonnante unité.
S’il est drôle et attachant, le narrateur du récit est aussi un homme louche qui annonce d’emblée qu’il nous ment. Revenu de la mort pour nous raconter son histoire, il est libre face à la réalité et entretient une étrange relation avec le mensonge et la vérité. « Ne croyez pas tout ce que je raconte! Ou au contraire, croyez-y! Quelle différence y a-t-il, au fond, entre la vérité et le mensonge? » « Lorsque la tromperie vous a laissé en bouche sa douce saveur, il coûte d’y renoncer, tant après cette bouchée friande on trouve un goût de sciure à l’invariable et austère réalité. »
Faisant le choix de l’imaginaire, le narrateur nous emporte donc dans un récit féérique où il est question de femmes-oiseaux donnant naissance à un papillon, Érika, la future femme du narrateur. Il y a aussi un curieux chien gris qui rôde, annonçant la mort imminente. Fable symboliste mais aussi bien campée durant cette période d’entre-deux-guerres, où l’Estonie vécut une parenthèse de paix, le roman allie réalisme et imaginaire avec un surprenant aplomb. Le papillon désigne à la fois Erika et l’Estonia, ce théâtre qui, tel que le papillon « ne vivant que pour la beauté », « faible et fragile », et que le « temps met à mort sans pitié », plane « au-dessus de la terre, dans une citadelle à laquelle aucune rue ne donnait accès et où régnaient les rêves et l’imagination ».
Jouant la mort sur scène, les comédiens disent montrer que la mort peut aussi être belle et non définitive, car l’acteur revient ensuite, bien vivant, saluer le public. Un autre répliquera qu’au contraire, jouer la mort revient à la banaliser. De la même manière, Le papillon est aussi le livre d’un mort qui s’adresse aux vivants comme pour profiter de la sagesse post mortem. Prendre la parole après la mort n’est-elle pas la plus belle des revanches sur sa disparition?
Rite profane
La nature exposée fait aussi dialoguer un vivant avec un mort, et pas n’importe lequel! Il s’agit du crucifié, sous la forme d’une statue, que le héros du roman est invité à restaurer. L’homme vit au pied d’une montagne dont il connaît tous les passages. Pour gagner sa vie, il fait traverser la frontière à des hommes et des femmes, des réfugiés. « Pour moi, ce sont des voyageurs d’infortune qui en ont eu trop à la fois », explique le narrateur, évoquant sans la nommer la crise actuelle des migrants. L’honnête homme attire malgré lui l’attention sur lui, le jour où il accompagne un écrivain dans la montagne qui décide de faire un livre de sa traversée. Du jour au lendemain, l’humble passeur est taxé de « saint des montagnes ». « La célébrité est une dérision », affirme le narrateur, dont l’histoire croisera celle du crucifié, autre bon samaritain devenu célèbre.
Avec l’élégante sobriété qui caractérise l’écriture d’Erri De Luca, le lecteur suit cet homme rejeté de son village pour avoir dévoilé au grand jour le passage secret de la montagne, et qui s’attarde à la réparation d’un Christ grandeur nature, qui doit être découvert d’un drap ajouté pour dissimuler son sexe, désigné ici par la « nature ». Ce qui devait être un simple travail artisanal de restitution s’avère être une aventure profonde et mystérieuse développée entre le restaurateur et cette représentation de la mort. Après des tractations avec les gens d’Église, l’homme finit par retirer le drapé et découvrir un sexe en érection. Face à la puissante nature de ce moribond, l’homme choisit d’approfondir son enquête sur les conditions de l’agonie du Christ. Quelle température faisait-il en ce vendredi du supplice? Il s’approche de la statue comme d’une personne malade et part à la rencontre de l’être vivant derrière la représentation. Il va jusqu’à se faire lui-même circoncire pour se fondre dans le rôle, « une méthode Stanislavski poussée à l’extrême »!
Accompagné de son frère jumeau, mort à l’âge de 6 ans, mais présent dans ses pensées depuis cinquante ans, l’homme parvient à dialoguer avec ce mort statufié, tout en écoutant son frère défunt en lui. « Il y a de la place en chacun de nous pour accueillir les absents », affirme-t-il. Et d’évoquer par son étude du corps blessé et de sa nudité la compassion à tous ces autres corps blessés par la politique.
Récit à plusieurs niveaux de lecture à l’instar des paraboles bibliques, ce récit à la langue simple et précise parvient à montrer le surgissement du sacré dans la vie d’un homme qui n’a aucun goût pour le mystère, et qui, par ses expériences concrètes, explique la miséricorde, la charité et la compassion humaines. Une des grandes qualités de l’écrivain italien (prix Femina étranger en 2002 pour Montedidio) consiste à mêler humour et érudition sans jamais pavaner. Inspirant.