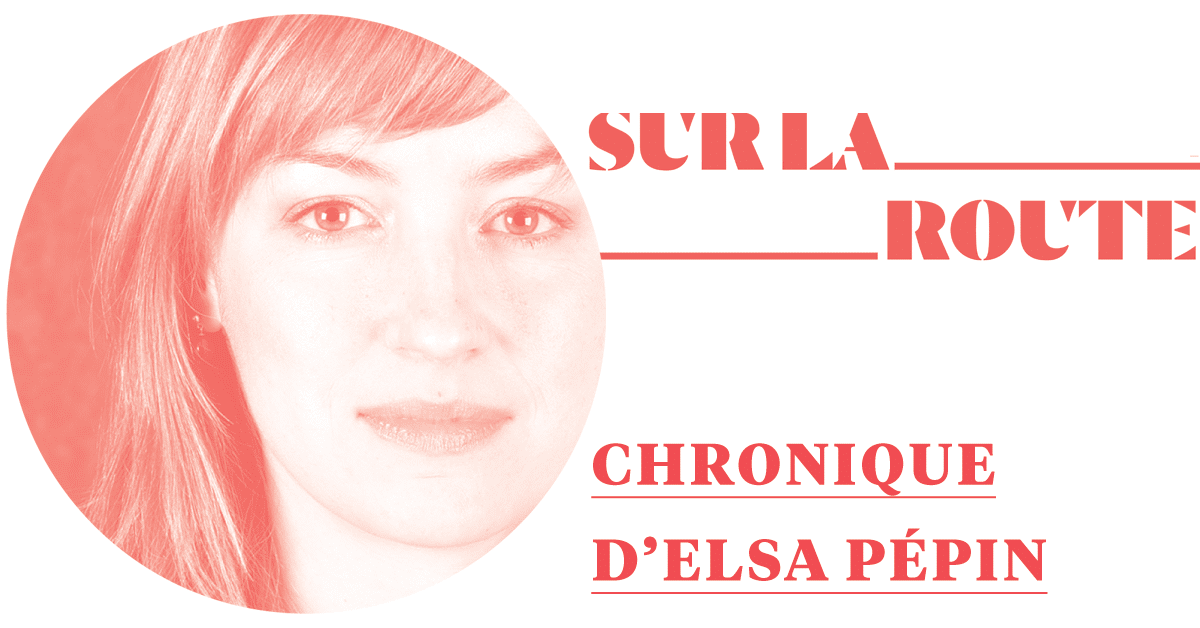Il ne se passe presque rien. Pourtant, une fois le livre refermé, force est d’admettre que tout y est. Tout ce qui fait la vie, en somme, et qui n’a rien à voir avec les grandes péripéties des épopées classiques. Maître dans l’art de rendre compte de ces infimes détails qui tissent la matière brute de l’existence, l’auteur norvégien Karl Ove Knausgaard crée plutôt une fresque intime absolument unique et surprenante où le récit nous pénètre comme une drogue.
L’écrivain a choisi de raconter sa vie dans un projet titanesque intitulé Mon combat, faisant ironiquement référence au Mein Kampf d’Hitler. Or, là où le chancelier affirmait des vérités, Knausgaard doute, hésite, se présente sous un jour sans fard ni pudeur, souvent désavantageux, mettant son âme à nu en tâchant de n’omettre aucune pensée, aucune gêne, aucun sentiment. En résulte un roman autobiographique monumental, dont quatre des six tomes publiés sont parus en français, et qui lui a valu un immense succès mondial, mais aussi des réprimandes de sa famille, abondamment mise en scène dans ses livres.
Le quatrième tome, Aux confins du monde, se lit très bien sans avoir lu les précédents. Y sont rapportés les moindres faits et gestes, parfois les plus triviaux, et les pensées du jeune homme qui, à l’âge de 18 ans, obtient son premier emploi comme professeur dans un bled éloigné du Nord de la Norvège. On suit durant un an son quotidien d’enseignant, d’apprenti écrivain et de noceur invétéré, ainsi que sa découverte du désir et de ses douloureux caprices. Un long retour en arrière nous le fait aussi connaître plus jeune, entre autres dans la relation compliquée qu’il entretient avec un père autoritaire et instable.
Les scènes en apparence anodines, racontées avec la perspective de l’adulte, acquièrent de l’intérêt parce que Knausgaard interrompt son récit par des apartés qui les mettent en scène en écrivant, aujourd’hui. La violence du père, terrorisante pour les deux fils, devient gigantesque, observée avec une vie de distance. L’adolescent en pleine découverte de soi, avec toutes les incertitudes, les tâtonnements et les excès que cela suppose, raconte ses premiers trous de mémoire alors qu’il buvait jusqu’à ne plus se souvenir de rien. « J’avais disparu, j’étais vide, j’étais dans le vide de mon âme, je ne sais pas décrire mon état autrement. Qui est-on quand on ne sait pas qu’on existe? Qui est-on quand on ne se souvient pas qu’on était? »
Entre ses absences, son désir naissant, incontrôlable et bancal, et ses projets de devenir un grand romancier, le narrateur devient un être familier qui nous livre avec une vérité et une sincérité déconcertantes sa vie la plus intime. Fin portraitiste des sentiments et des subtilités de la pensée, Knausgaard nous inocule littéralement sa vie au compte-gouttes, nous confiant ses plus secrètes réflexions, ses états d’âme les plus confus dans une prose d’une vitalité parfois brouillonne, mais toujours vibrante, hypnotique, comme la vie. Nous sentons, souffrons, jouissons, pleurons avec ce jeune garçon qui cherche tant bien que mal à faire coïncider son être intérieur avec l’image qu’il projette, vaste projet universel s’il en est un.
Knausgaard nous transmet ses sensations dans une démarche qui n’est pas sans rappeler À la recherche du temps perdu de Proust, où la lenteur et la longueur du récit font l’expérience de lecture. La complexité de la vie se traduit par la transformation de l’être profond, mais la plongée intérieure de l’auteur se fait ici dans un style sobre, minimaliste, souvent même lapidaire. Le jeune homme du début n’est pas exactement le même que celui qu’on quitte en refermant le livre, et d’avoir traversé avec lui ce passage nous transforme aussi.
Retour vers soi
L’auteure islandaise Audur Ava Olafsdottir nous livre également une sorte de récit de formation de soi, cette fois sur fond d’un monde dévasté. Le narrateur d’Ör, qui signifie « cicatrices » en islandais, n’a pas touché à une femme nue depuis huit ans et cinq mois. Depuis que Gudrun l’a quitté. Entre les visites à sa mère malade, obsédée par les guerres mondiales, et les échanges avec sa fille Nymphéa, Jonas Ebeneser envisage son suicide. Afin d’épargner à sa fille la découverte de son corps, il décide de s’exiler dans le pays le moins recommandé, le moins touristique, un pays détruit par la guerre, innommé, mais qui a tout des pays du Moyen-Orient. Il emporte avec lui une perceuse (pour pouvoir installer le crochet auquel il compte se pendre) et son journal intime, dans lequel il redécouvre le jeune homme qu’il était.
Ce voyage final devient celui d’une rencontre de soi et un exercice de relativisme face à la douleur extrême des gens touchés par la guerre. Jonas y rencontre des personnes qui ont besoin de lui, pour réparer lampes, murs, conduites d’eau, mais aussi pour le reste. Petit à petit, il retarde sa mort, développe des relations personnelles.
Bien que la trame ne soit pas des plus originales, Ör charme par sa beauté étrange, la singularité du ton de tragique légèreté, si unique à l’auteure de Rosa Candida, toujours à la fois fantaisiste et profonde.
Découpé en courts chapitres aux titres poétiques (« Plus nous nous élevons plus nous paraissons petits aux regards de ceux qui ne savent pas voler »), ce roman rend hommage aux peuples touchés par les guerres : peuples oubliés, dénaturés, sauvagement arrachés à leur humanité, mais aussi à la reconstruction qui s’ensuit. Olafsdottir explore le territoire des blessés, depuis le corps avec ses cicatrices jusqu’au pays détruit par les bombes. « Sais-tu que dans certains coins du monde, les cicatrices inspirent le respect, lance Svanur, l’ami du narrateur. Une grande et impressionnante cicatrice révèle une personne qui a regardé la bête sauvage les yeux dans les yeux, qui a affronté sa propre peur et a triomphé. »
« Depuis que tu es sorti du ventre de ta mère, 568 guerres ont été menées dans le monde », dit la mère du narrateur, personnage loufoque, parmi les plus réussis du livre, et qui lui déclare : « Au lieu de mettre fin à ton existence, tu n’as qu’à cesser d’être toi et devenir un autre. » Une belle invitation, embrassée par Jonas, mais devenir un autre, c’est aussi devenir soi.