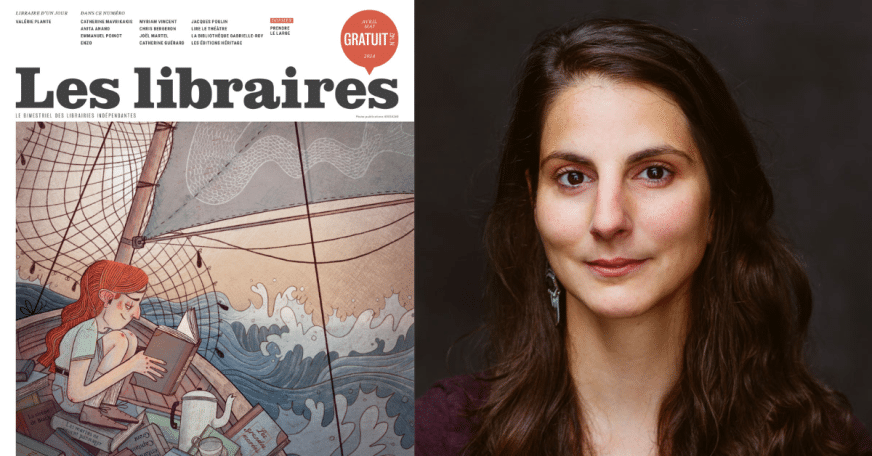Enfin, de bonnes nouvelles! Après avoir été négligée par la télévision nationale, la culture effectue cet automne un retour en force au petit écran. Nos deux réseaux publics ont respectivement lancé avec la rentrée un magazine hebdomadaire (On fait tous du show-business, le dimanche en fin d’après-midi à la télévision de Radio-Canada) et un autre, quasi quotidien (Ça manque à ma culture, du lundi au jeudi en début de soirée à Télé-Québec).
C’est la sympathique Catherine Perrin qui anime On fait tous du show-business, dont la production a été confiée aux gens de chez Bubbles, malgré l’échec relatif de leur récent magazine de la même eau (Prochaine sortie). Diffusée devant public en direct d’un resto du Vieux-Montréal, où défilent chroniqueuses et chroniqueurs aux visages plus ou moins familiers, l’émission rappelle La Bande des six, qui demeure un modèle du genre. Et même si on peut contester l’équation réductrice du titre (le monde du spectacle n’englobe tout de même pas l’ensemble de nos pratiques culturelles!), la première m’a semblé de bon augure. Dommage que la tradition implique un jour et une heure de diffusion peu susceptibles de garantir un record d’audimat.
Du côté de Télé-Québec, on a misé sur les artisans PixCom (Les Choix de Sophie, Cent Titres) et sur le comédien et chanteur Serge Postigo pour ouvrir nos soirées culturelles sous le signe de la décontraction et de la convivialité. Devant un auditoire studio, les chroniqueuses et chroniqueurs de Ça manque à ma culture, au même titre que les artistes, présentent différentes facettes de l’actualité artistique et littéraire à l’animateur, dont la cote d’amour devrait à tout le moins assurer à l’émission des cotes d’écoute honorables.
Ces nouvelles, on le devine, ont de quoi ranimer l’espoir dans le milieu du livre, qui depuis des années se plaint à juste titre de l’exiguïté de l’espace médiatique consacré à la littérature en particulier. On ne le dira jamais assez: si l’on veut se doter d’une culture nationale, une culture plus large et diversifiée que la production de l’industrie, il faut pouvoir donner à tous les avatars de celle-ci des tribunes pour rejoindre son public naturel. Les œuvres culturelles, et plus précisément les œuvres littéraires, n’existent que dans la mesure où elles trouvent preneurs et preneuses. Et dans un monde idéal, la télévision — le plus accessible, le plus démocratique des médias électroniques — peut ouvrir une fenêtre sur l’univers des arts et des lettres. Un monde idéal, j’insiste: un monde où la télé ne passerait pas le plus clair de son temps à se pourlécher compulsivement les pattes à la manière d’un gros matou narcissique.
Tous les écrivains, éditeurs et libraires vous le diront: une apparition à la télévision à une heure de grande écoute a souvent fait la fortune d’un livre et, du coup, autant aidé à la santé de la littérature et de ses artisans qu’à celle de l’industrie éditoriale qui les soutient. Depuis une couple d’années, la seule émission qui stimule l’intérêt du public lecteur, c’est le talk-show Tout le monde en parle, animé par Guy A. Lepage. Pourtant, ainsi que je l’ai fait remarquer ailleurs, même si des auteurs et des écrivains y sont régulièrement invités, il est rare que l’on y cause de littérature autrement que par la bande. Ce n’est pas une critique, juste une constatation. Pour avoir déjà eu Guy A. Lepage comme Libraire d’un jour, nous le savons cultivé et friand de lectures ET de littérature. Toutefois, il n’a aucune ambition de devenir le Bernard Pivot de notre télé, et Tout le monde en parle ne sera jamais ni Apostrophes ni Bouillon de culture. C’est ce qui rend l’avènement d’une véritable émission littéraire à l’antenne de la télévision nationale encore plus nécessaire…
Il suffit de relire le pamphlet du journaliste Jacques Keable, La Grande Peur de la télévision: le livre (Lanctôt, 2004) pour constater à quel point les rapports entre notre télé et la littérature ont toujours été problématiques. Paradoxe des paradoxes, alors que «la lecture demeure l’activité de loisir préférée des Québécois», dixit Keable, «l’exception ponctuelle confirmant la règle, le livre est absent des ondes québécoises depuis la naissance de la télévision, en 1952!» Pourquoi? Est-ce que c’est par la peur de la pensée et du terrorisme de la consommation qui imposeraient le divertissement plutôt que la réflexion, ainsi que le suggérait dans son éclairante préface mon prédécesseur à la présidence de l’Union des écrivaines et écrivains québécois, Bruno Roy? La question demeure entière, surtout à l’heure où l’on se restreint à la seule actualité culturelle en nous répétant avec l’air d’y croire qu’ «on fait tous du show-business.»
Mais pourquoi cracher par anticipation dans la soupe? Pour le moment, réjouissons-nous de ce que la télévision donne l’impression d’avoir (re)découvert un continent perdu. Et laissons la chance aux arpenteurs-géographes de celui-ci.