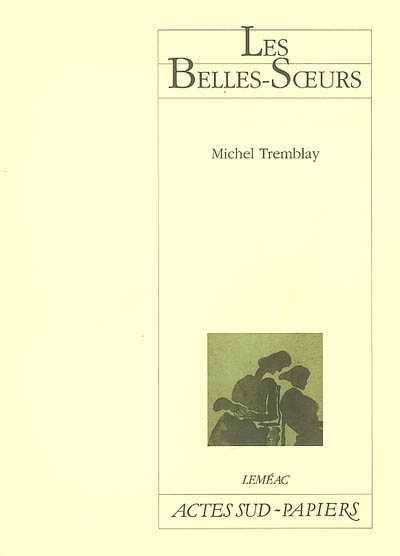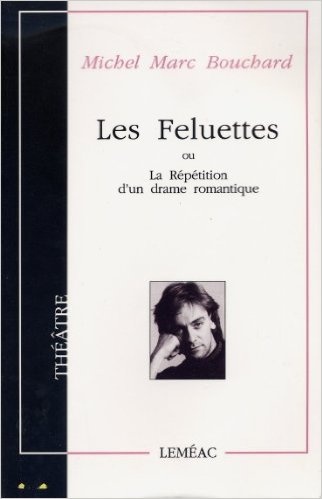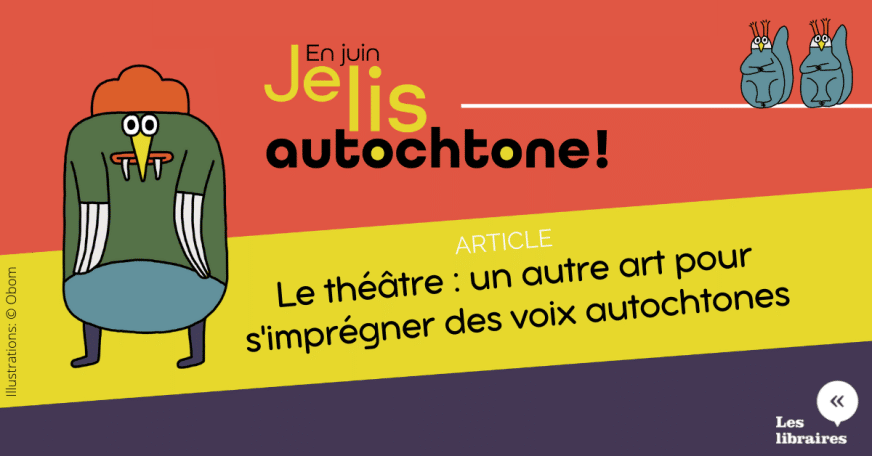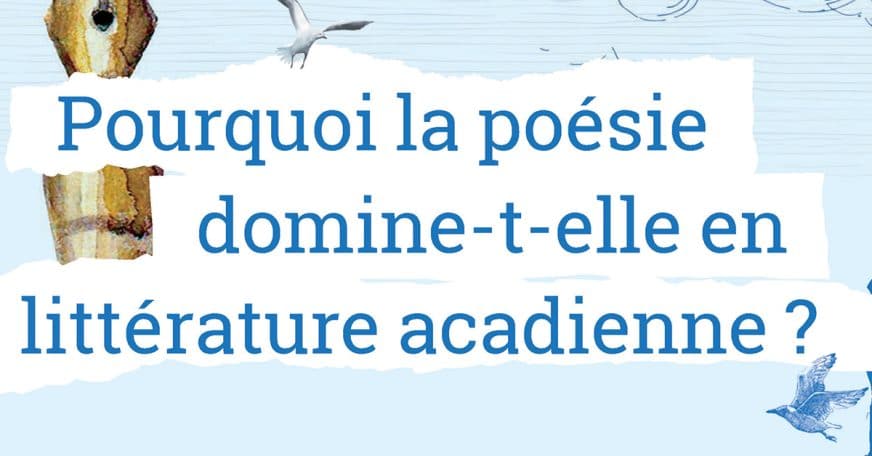En parcourant le théâtre québécois d’hier à aujourd’hui, on constate qu’à peine sorti de l’ombre, celui-ci possède déjà une personnalité bien campée et une ligne du temps qui révèle une scène, une parole, un peuple aussi créatif qu’assoiffé.
Les premières manifestations théâtrales au Québec existaient bien avant qu’on nomme le territoire. « Les danses rituelles de Peaux-Rouges[i] » exprimaient déjà à part entière ce qu’en somme notre théâtre moderne révèle : notre besoin de communion. Si l’on veut dater un premier texte répertorié, il faut remonter en 1606 avec Théâtre de Neptune de Marc Lescarbot, une « gaillardise en rimes » qui marquait le retour du sieur. C’est ce texte qui définit le début du théâtre canadien-français, « bien que ceci constitue une sorte d’anachronisme, la pièce ayant été jouée à Port-Royal, en Acadie[ii]! » Aux XVIIe et XVIIIe siècles, le théâtre continue à se jouer, connaissant des périodes plus ou moins creuses selon l’influence du clergé ou des gouvernements plus conservateurs qui apposent sur la pratique le couperet de la censure. Cependant, ce sont surtout des pièces anglaises et françaises qui sont jouées par des troupes d’ailleurs et d’ici. Il y a bien quelques créations qui se font, mais elles n’ont pas passé l’épreuve du temps. Il faudra attendre le XXe siècle pour qu’advienne une véritable écriture dramaturgique québécoise, dans le fait qu’elle a perduré, mais aussi qu’elle parle de nous.
En 1921 est créée au Théâtre Alcazar à Montréal Aurore l’enfant martyr. Les comédiens Léon Petitjean et Henri Rollin s’inspirent des faits divers pour transposer au théâtre cette histoire connue par tous d’une fillette maltraitée jusqu’à la mort par sa belle-mère avec le consentement tacite du père de l’enfant. Cette histoire, qui vient avec de scabreux détails et un procès au terme duquel la marâtre sera condamnée à la pendaison (elle recevra finalement une sentence d’emprisonnement à vie), fait partie de l’actualité récente lorsque la pièce est jouée pour la première fois. Cette pièce fut un immense succès. Elle aborde de manière sensationnaliste la notion du mal, de la faute et de la sujétion. Ici, la réalité est au service de la fiction et la dépasse largement. La bibliographie de Petitjean et Rollin s’arrête cependant avec Aurore.
Gratien Gélinas : le patriarche
C’est à Gratien Gélinas que revient le titre de « père » du théâtre québécois. Auteur, comédien, metteur en scène et directeur de théâtre, Gélinas écrira ce que d’aucuns appellent la première pièce du répertoire québécois. Tit-Coq sera représentée pour la première fois le 22 mai 1948. Enfant illégitime, Arthur Saint-Jean, alias Tit-Coq, trouvera auprès de Marie-Ange l’espoir d’échapper à sa condition et de combler son besoin d’appartenance. Son rêve s’effondre lorsqu’il revient de la guerre et qu’il voit que sa douce a déjà pris mari. La pièce ne prend pas clairement parti entre le devoir de se conformer et l’intérêt d’outrepasser les règles pour respecter l’intégrité du cœur. Mais les questions sont lancées, par ailleurs dans une société où le clergé et la morale ont beaucoup d’emprise, et en plus dans un contexte qui concernait directement l’époque, c’est-à-dire le départ à la guerre et la situation parfois, sinon plus difficile, du retour.
Les années 50 marquent l’entrée en scène de Marcel Dubé. Avec la pièce Zone créée en 1953, une certaine révolte contre les conventions d’une société trop lisse se fait entendre par la voix d’une bande de jeunes adultes. L’écriture de Dubé montre sans compromis les faux-semblants de la bourgeoisie et le leurre des apparences. Le théâtre de Françoise Loranger, lui, relève plutôt du soulèvement intime. « Les conflits essentiels ne naissent jamais de situations sociales ni de l’affrontement entre les générations; ce sont d’abord des conflits intérieurs à la conscience qui s’éveille[iii]. » Ainsi trouve-t-on dans Encore cinq minutes, lancée en 1967, le personnage de Gertrude qui décide de partir de la maison familiale après n’avoir vécu que pour combler les besoins de son mari et de ses enfants.
Prendre possession de sa langue
L’année 1968 marque sans conteste un tournant majeur dans l’histoire du théâtre québécois avec l’arrivée de la pièce Les belles-sœurs de Michel Tremblay. L’utilisation du joual vient bouleverser les codes tacites de l’art théâtral. Plusieurs s’insurgent contre le fait que la langue populaire puisse se faire entendre sur une scène, croyant qu’elle n’est pas assez noble pour obtenir ce privilège. Mais au-delà de la langue, la pièce possède une forme originale qui alterne entre les monologues et les chœurs. Elle donne pour la première fois toute la parole au peuple, qui plus est à des femmes. « Maudite vie! J’peux même pas avoir une p’tite joie, y faut toujours que quelqu’un vienne toute gâter! Vas-y aux vues, Linda, vas-y, sors à’soir! Fais à ta tête! Maudit verrat de bâtard que chus donc tannée! », dira le personnage de Germaine Lauzon à sa fille. Symboliquement, il s’agissait de s’affirmer, de nommer haut et fort notre existence, de faire advenir un Québec décomplexé. Aujourd’hui, en sachant le succès international qu’ont eu Les belles-sœurs et les nombreuses traductions que la pièce a générées, on comprend à quel point Tremblay venait d’inscrire le théâtre québécois dans une dimension universelle. En parallèle, des pièces significatives comme Les grands soleils de Jacques Ferron, Le chemin du Roy de Loranger et Claude Levac, Hamlet, prince du Québec de Robert Gurik continuent à poser des questions sur le pouvoir et l’identité.
Un théâtre politique et social
La décennie 70 marque l’arrivée d’un cas particulier qui préfigure néanmoins l’éclatement que prendra bientôt le théâtre au Québec : Claude Gauvreau et sa pièce La charge de l’orignal épormyable. Gauvreau écrit cette pièce en 1956 à la suite de son internement en institut psychiatrique. Témoignant de son avant-gardisme, ce n’est qu’en 1970 qu’elle sera montée pour la première fois. Gauvreau ne fait pas que jouer avec la langue, il la réinvente complètement. L’« exploréen », nom donné à cette langue inventée, procède d’une décomposition des mots et se situe à mi-chemin entre le langage parlé et l’onomatopée. L’usage de ce vocable permet de faire état d’une société bien-pensante qui rejette tous ceux qui ne parlent pas le même langage. Les envolées poétiques grandiloquentes sont aussi une sorte de rempart contre le détournement de sens que n’hésite pas à utiliser le langage commun : « La parole logique apparaît chez Gauvreau comme le monopole d’une communauté dominante[iv]. » La sensibilité de Mycroft, le personnage principal de la pièce, le rend vulnérable aux yeux des autres qui associent sa différence à la folie. Mais ce sont aussi ces émotions à vif qui lui permettront de résister, entre autres par les moyens de création qu’elles lui donnent. Au-delà des questions de folie et de l’anticonformisme, Gauvreau en appelle à un plus grand humanisme.
Quelques années plus tard, nous verrons l’apparition au théâtre du romancier Réjean Ducharme qui aime nous surprendre avec sa langue inventive. Ines Pérée et Inat Tendu (1968 dans sa première version, 1976 dans sa version actuelle) et Ha Ha!… (1978) évoquent les grands axes de la nature humaine, capables du meilleur, mais peut-être surtout du pire. Toujours, ce sont des êtres naïfs et assoiffés d’amour qui sont immuablement trompés. Le monde ducharmien rapporte la complexité de la nature humaine, parfois retorse jusqu’à l’ignoble.
C’est aussi l’époque du Grand Cirque Ordinaire qui propose une forme de dramaturgie novatrice avec la création collective. Des étudiants de l’École nationale de théâtre à Montréal quittent en bloc l’institution qui les mène à jouer un théâtre conventionnel qui ne leur ressemble pas. Ils joignent alors le comédien Raymond Cloutier qui arrive tout juste d’Europe avec une multitude d’idées en ébullition. Le Grand Cirque s’inscrit dans le sillon de la révolte de 1968 et « une volonté de libération, de retour aux sources de création et un besoin de communiquer directement avec le monde sans passer par les schémas européens ou bourgeois […][v] ». Est ainsi créée à partir d’improvisations la pièce T’es pas tannée Jeanne d’Arc? (1969). Nettement engagée, cette pièce soulève les points communs entre le destin de la guerrière sainte sacrifiée et le peuple québécois.
Objectifs similaires du côté du Théâtre Expérimental de Montréal dont l’histoire commence en 1974 avec « trois amants de la chose théâtrale, Pol Pelletier, Robert Gravel et Jean-Pierre Ronfard, réunis autour d’un repas de lentilles-saucisses pour jeter les bases d’un théâtre de recherche […][vi] ». Naît alors une autre façon de concevoir le théâtre. C’est aussi à cette époque qu’apparaîtront les premiers jalons, plantés par Gravel et Yvon Leduc, de la Ligue Nationale d’Improvisation (LNI). Le TEM privilégie un partage égal du pouvoir, une responsabilité individuelle face à l’œuvre collective et une prise de toutes les décisions à l’unanimité. Il se veut sans a priori, à part peut-être celui de ne pas en avoir. Mais en 1978, certaines femmes actives dans le théâtre revendiquent davantage de place et choisissent de se dissocier pour former le Théâtre Expérimental des Femmes (TEF). C’est de là que sera aussi refondé le TEM pour devenir le Nouveau Théâtre Expérimental (NTE), encore présent sur nos scènes aujourd’hui.
Dans le sillon des revendications féministes qui émergent dans la société québécoise, le théâtre des femmes prend parole. Elles souhaitent revisiter la représentation stéréotypée qui est faite d’elles en remettant en question les archétypes de la jeunesse, de la beauté, de la maternité et du corps féminin. La création collective La nef des sorcières et la pièce Les fées ont soif de Denise Boucher font partie des annales de ce genre. À leur création (respectivement en 1976 et 1978), ces pièces font grand bruit. Les représentations des Fées engendrent une véritable polémique, entre autres de la part du clergé. Par une injonction de la cour, elle sera interdite de représentation parce que jugée blasphématoire.
Retour en force du dramaturge
Les années 80 voient l’arrivée d’une écriture nouvelle. « Ce qui distingue d’emblée cette dramaturgie […] c’est l’accent mis sur l’esthétique (littéraire, dramaturgique, théâtrale) plutôt que sur la portée sociale des textes[vii] » comme on pouvait le voir dans la décennie précédente. La fresque monumentale que représente Vie et mort du roi boiteux de Ronfard en est un bon exemple. Fidèle à sa démarche créative qui se veut festive et populaire, Ronfard compose un cycle hétéroclite qui forme pourtant un ensemble cohérent. D’une durée de quinze heures, cette pièce épique montre la grande fabulation du monde et ce qui divise et rassemble les êtres.
Ce sera aussi l’apparition d’écrivains dramaturgiques, tel Normand Chaurette avec Rêve d’une nuit d’hôpital (1980), une pièce où le vrai et le faux sont remis en doute avec au centre le personnage de Nelligan comme représentant de cette dualité. Illusion, réalité et identité sont au cœur de l’écriture de Chaurette qui a écrit jusqu’à ce jour une quinzaine de pièces. Dans un même spectre, il faut nommer la pièce Being at Home with Claude (1985) de René-Daniel Dubois qui interroge d’une autre façon les profondeurs de l’âme humaine et de ses frontières avec une histoire de crime passionnel.
De son côté, Michel Marc Bouchard écrit Les feluettes ou la répétition d’un drame romantique en 1987 et Les muses orphelines en 1988. Tandis que dans la première sont abordés les thèmes des amours interdites et de la trahison, la deuxième remue de douloureux secrets de famille. Bouchard compte dans sa théâtrographie plus d’une vingtaine de pièces dont plusieurs ont fait l’objet de traduction ou ont été adaptées au grand écran. Amours et vérité y sont fréquemment exploités.
En 1986, Robert Lepage crée Vinci, dont il sera à la fois l’auteur, le metteur en scène et le seul comédien sur scène. Déjà avec cette première pièce, on peut appréhender le monstre théâtral qu’il deviendra internationalement. Cette pièce demande à un seul acteur de jouer plusieurs personnages et propose une réflexion sur notre rapport à l’art. En 1994, il fonde Ex Machina, une compagnie de création multidisciplinaire. La première production à prendre l’affiche sous cette bannière sera la saga Les sept branches de la rivière Ota jusqu’à la création récente de 887 (2015) qui traite des méandres de la mémoire. Contrairement aux auteurs des années 80 cités plus haut, Lepage appartient au théâtre de l’image qui procède d’une écriture scénique visuelle plutôt que de se concentrer sur le texte.
Dans les années 1990, nous ferons connaissance avec la parole poétique de Daniel Danis. « SHIRLEY : Toute ma peau se sent comme un arbre déesse. La déesse des bois met un pied à terre. Un tapis d’humus et de branches se déroule jusqu’à la source[viii]. » Les pièces Celle-là et Cendres de caillou sont toutes deux créées en 1993. Dans chacune d’elles, nous retrouvons des personnages aux prises avec des drames personnels qui creusent en eux un indélogeable mal de vivre. De son côté, Serge Boucher, qui nous parle aussi de souffrance, choisit plutôt d’employer la forme réaliste, comme on peut le lire dans Motel Hélène (1997) : « JOHANNE : […] je l’sais pas, je l’sais-tu c’que j’ai dit, mais j’sais que je l’ai pris, je l’ai crissé dehors, j’ai dit j’pense : “Tu vas rester là jusqu’à c’que ton père arrive”, chu rentrée dans maison, j’ai barré la porte, J’AI BARRÉ LA PORTE, pour pu qu’y rentre dans maison, J’AI ENFERMÉ MON P’TIT DEHORS… »
Une première pièce d’Olivier Choinière, Le bain des reines (1998), le consacre tout de suite au rang de dramaturge avec une nomination au prix du Gouverneur général. Son théâtre expose ses fondements jusque dans le renouvellement de la forme, en présentant par exemple une pièce déambulatoire pour un spectateur à la fois (Beauté intérieure, 2003), tandis que dans une autre, cinquante acteurs se trouvent simultanément sur la scène (Chante avec moi, 2010). Dans le théâtre de Choinière, la société québécoise est réfléchie, autant dans l’œil du spectateur qui le regarde que dans le prolongement de la pensée.
Un nouveau millénaire à imaginer
Les années 2000 seront marquées par le Libano-Québécois Wajdi Mouawad qui entame avec Littoral (1997) le premier volet du cycle « Le sang des promesses », une tétralogie dont les autres titres sont Incendies (2003), Forêts (2006) et Ciels (2009). Autre important ambassadeur du théâtre québécois à l’étranger, Mouawad donne toute liberté aux acteurs pour ensuite procéder à la mise en forme d’un texte. Son écriture narrative aborde la mécanique de la transmission et du poids de la lignée. « Loup : D’où ça vient tout ça? Cette douleur? Qu’est-ce qui t’a fait si mal et qui, malgré la beauté de ton visage, Luce, t’a si horriblement déchirée, a déchiré ma mère et continue encore à me déchirer? », lit-on dans Forêts.
S’impose dans la plus récente dramaturgie l’auteur Christian Lapointe caractérisé par son exigence et l’audace de ses propositions. En 2006, il écrit C.H.S. (pour Combustion Humaine Spontanée) qui explore l’élément du feu, autant intérieur qu’extérieur, qui éclaire autant qu’il consume. François Archambault se fait aussi remarquer avec plus de vingt œuvres qui jettent une lumière sur notre société de performance et d’excès (La société des loisirs, 2003; Tu te souviendras de moi, 2013).
Conclusion d’un trop bref article qui voulait parler d’un très vaste sujet
Comme tout survol, le présent texte ne prétend aucunement à l’exhaustivité et reconnaît les nombreux absents. Nous avons passé sous silence le théâtre jeunesse, le théâtre d’intervention, nous n’avons pas même souligné les revues, les festivals et les maisons d’édition qui l’honorent. Nous avons passé outre des noms signifiants. Mais plutôt que d’en concevoir un regret, nous préférons penser qu’il reflète simplement la grande richesse et l’infinie diversité d’une théâtralité qui est bel et bien en marche.
[i] ROUX, Jean-Louis, « Le théâtre québécois », Europe, no 478-479, fév.-mars 1969, p. 222, cité par Jean-Cléo Godin dans Théâtre québécois I, Éditions BQ, 1988, p. 24.
[ii] GODIN, Jean-Cléo et Laurent Mailhot, Théâtre québécois I, Montréal, BQ, 1988, p. 24.
[iii] Ibid, p. 175.
[iv] http://id.erudit.org/iderudit/65202ac [consulté le 15 mai 2016].
[v] http://id.erudit.org/iderudit/036688ar [consulté le 15 mai 2016].
[vi] http://www.nte.qc.ca/historique/ [consulté le 15 mai 2016].
[vii] GODIN, Jean-Cléo, « Création et réflexion : Le retour du texte et de l’auteur » dans Lafon, Dominique (dir.), Le théâtre québécois : 1975-1995, Montréal, Fides, 2001, p. 58.
[viii]http://www.logomotivetheatre.fr/DocPro/Cendres_de_cailloux/cendres_dossier_pedagogique.pdf [consulté le 16 mai 2016].