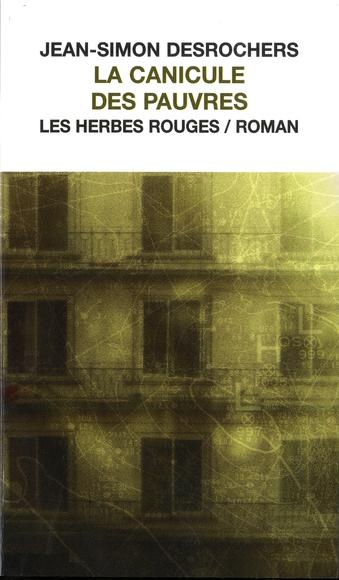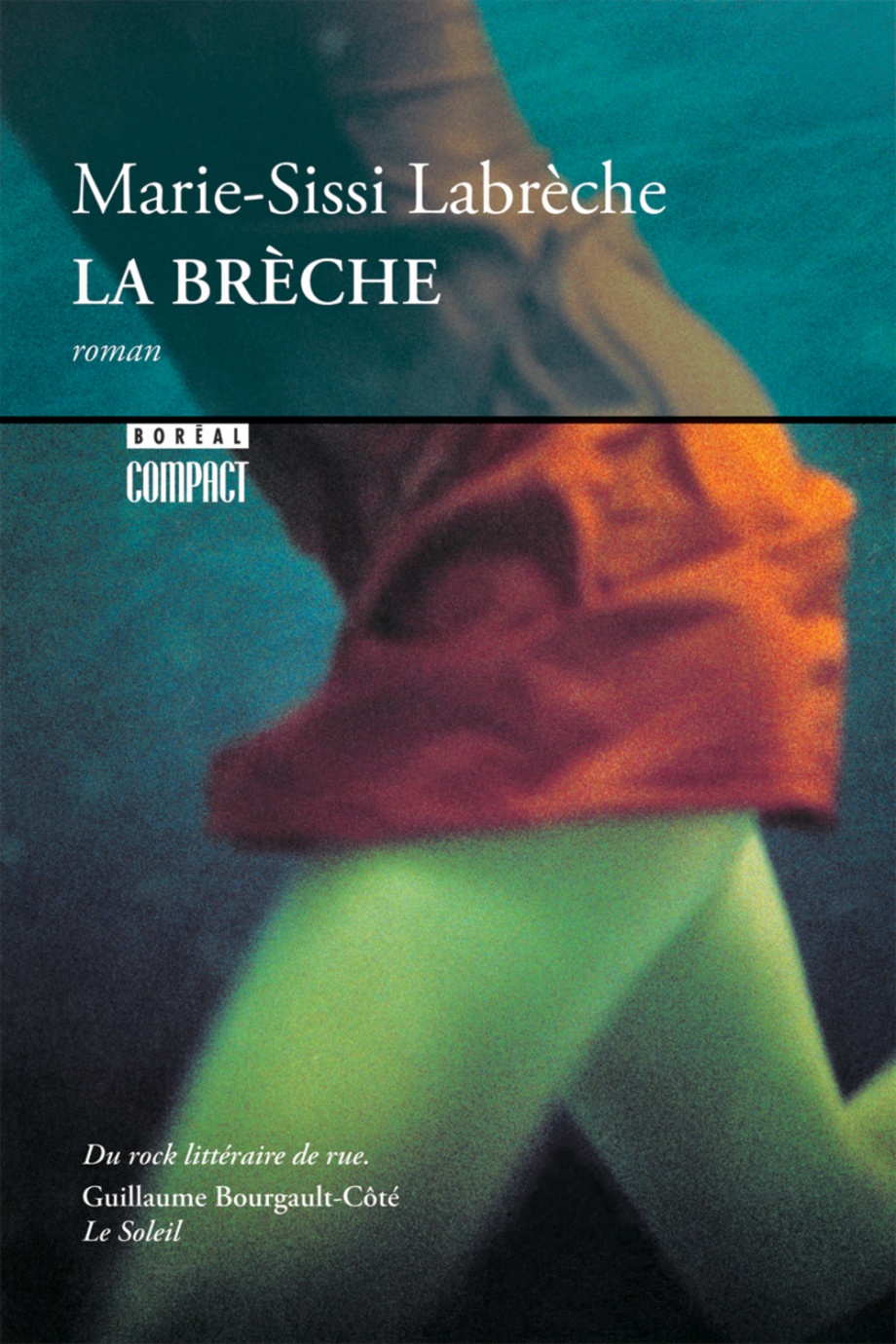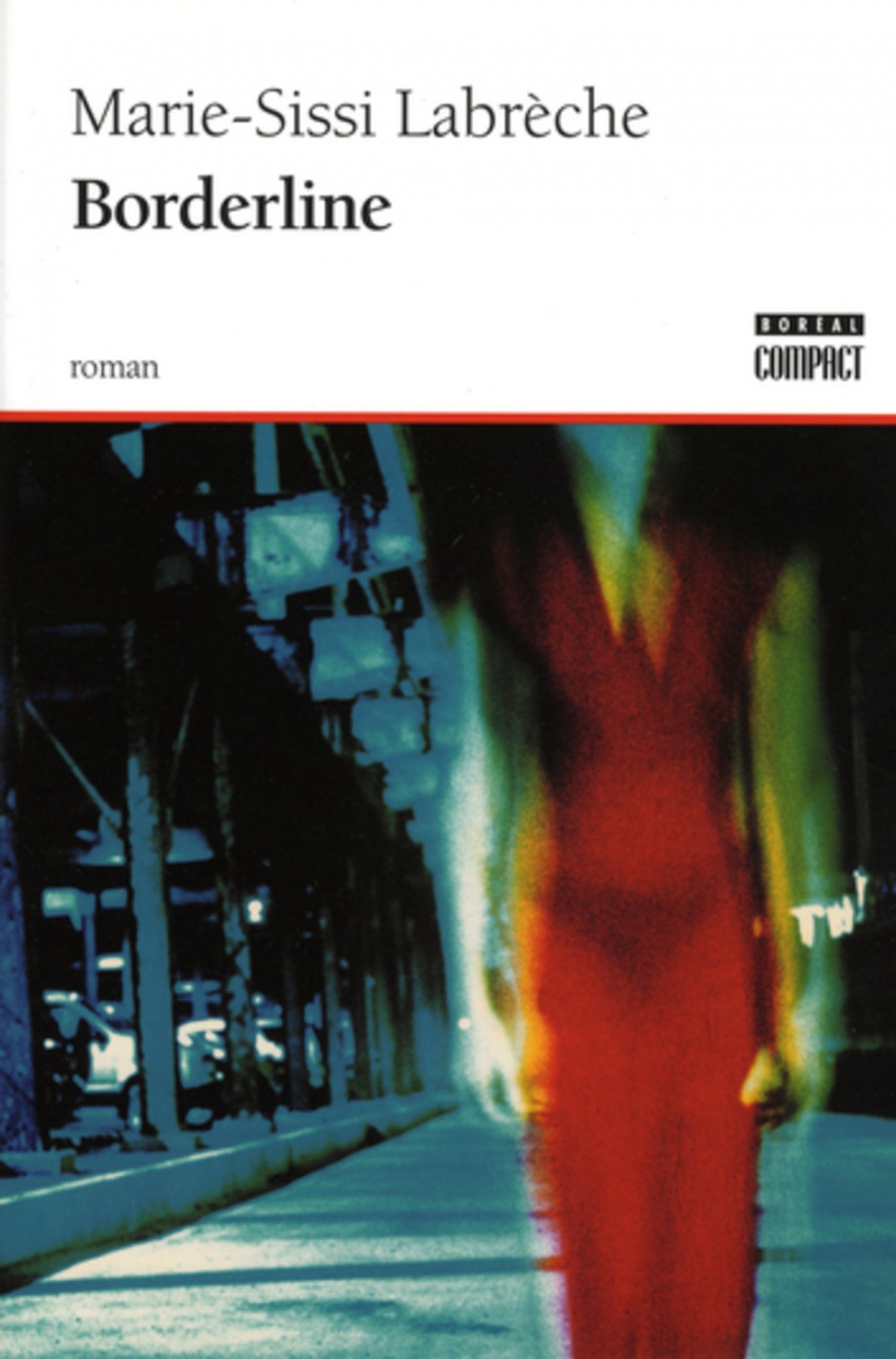Beaucoup d’œuvres littéraires sont adaptées pour le cinéma et le Québec ne fait pas exception. Comment fait-on pour passer d’un média à l’autre sans trop y perdre au change? Quelles qualités doit posséder un scénariste pour réussir la transition sans trop de heurts? Nous avons demandé à quatre auteurs – Patrick Senécal, Marie-Sissi Labrèche, India Desjardins et Jean-Simon DesRochers – qui ont eu la difficile tâche de transposer leurs propres œuvres à l‘écran de nous en dire quelques mots. Finalement, qui, du film ou du livre, sera le meilleur?
Parfois né d’un coup de cœur d’un réalisateur pour l’histoire d’un livre, d’autres fois amorcé par les supputations d’un producteur qui croit au potentiel particulier d’un récit, le film issu d’une fiction littéraire a sûrement sa raison d’être. À moins qu’il soit plus facile de partir d’une œuvre déjà écrite que de créer de toutes pièces un scénario original? Pas nécessairement. Car entre l’écriture d’une œuvre littéraire et celle d’un scénario, il y a tout un monde.
Alors que le romancier est le maître d’œuvre de sa création, le scénariste agit plutôt à titre de technicien de l’écrit qui codifie et organise les différents éléments. Le métier d’écrivain en est un libre et solitaire, tandis que le scénariste est régi par des contraintes venues de plusieurs intervenants. Tandis que l’écrivain tient mordicus à sa virgule, le scénariste doit pouvoir sabrer des paragraphes entiers, voire des chapitres complets et il est au service d’une machine complexe. Certains sont même mis à contribution lorsqu’il s’agit de l’adaptation de leur propre œuvre, ce qui peut rendre la chose encore plus délicate.
Les défis sont effectivement nombreux pour ces auteurs qui se transforment en scénaristes de leur propre œuvre. Il faut d’abord accepter les contraintes qu’exige la lourde logistique du cinéma. India Desjardins, auteure de la populaire série de huit romans jeunesse « Le journal d’Aurélie Laflamme », en sait quelque chose. En 2010, sort le film adapté du premier tome de la série et, en 2015, un deuxième film se consacre aux deux derniers tomes. Sur les deux productions, elle travaille au scénario. « C’est un style d’écriture très différent. Un roman exprime des états, un film nécessite des actions. […] Un autre défi est également de faire le deuil de l’histoire racontée au départ. Il faut la raconter de façon différente de ce que tu avais eu en tête la première fois, tout en respectant ce que tu voulais dire initialement. »
Mêmes propos du côté de l’auteur de polars et de livres d’horreur Patrick Senécal. Ce dernier a scénarisé trois de ses romans, Sur le seuil (2003), 5150, rue des ormes (2009), Les sept jours du talion (2010), et travaille présentement à l’adaptation de son roman jeunesse Sept comme setteur. « Le plus gros défi est de rendre concrète l’intériorisation des personnages. On peut être dans la tête d’un personnage dans un livre, mais pas dans un film. Même si on fait appel à toutes sortes de trucs cinématographiques (voix off, hallucinations, caméra subjective), on n’est jamais dans la tête de quelqu’un avec autant de force que dans un roman. Le cinéma, c’est l’art du concret », explique l’auteur-scénariste. Il faut alors arriver à faire passer les pensées et les intentions avec les images, cette fois-ci, et non plus qu’avec les mots. Il y a bien les dialogues qui demeurent, mais ils n’assument pas la portée narrative du film. « L’autre défi est la déconstruction d’un langage pour le reconstruire dans un autre. Certaines idées, certaines images fonctionnent dans un livre, mais pas du tout dans un film, et on ne sait pas trop pourquoi au juste. Il faut trouver l’équivalent au cinéma, trouver une image qui sera différente que l’idée du roman, mais qui voudra dire la même chose », poursuit Senécal. La scénarisation serait donc plus une affaire de traduction que toute autre chose. Le pari se situe davantage sur le plan de la transposition des conventions que dans l’écriture en tant que telle.
Car au cinéma, le véritable auteur c’est le réalisateur. C’est sa vision qui prime et c’est lui qui devient le conteur. Il utilise les outils à sa disposition qui, au-delà des mots, sont entre autres l’éclairage, l’angle de la caméra, les acteurs, la nature des plans, le choix des séquences. C’est surtout lui qui a le dernier mot au montage quant à l’ordre et au rythme des images qui détermineront la trame narrative de l’œuvre et donneront toute la facture au film. L’auteure Marie-Sissi Labrèche, qui a scénarisé le film Bordeline (2008), un hybride de son roman du même nom et du livre La brèche, a été avisée dès le départ : « Roger Frappier, le producteur, m’avait dit : “Regarde, c’est ton univers, mais ça va être le film de Lyne” [Charlebois, la réalisatrice]. Donc, il fallait que je transfère mon univers à quelqu’un qui allait en faire quelque chose d’autre. Ça demande une certaine dose d’humilité. » Le fait de devoir travailler en collaboration demande aussi à l’écrivain de s’adapter puisqu’il est habitué de faire cavalier seul dans la création. Le travail en équipe peut favoriser l’émulation d’idées, mais augmente également la possibilité des différences de points de vue. On ne peut pas rester sur ses positions. L’ouverture et les concessions sont primordiales : les puristes de leur œuvre n’ont qu’à repasser. Et plus que tout, il faut garder en tête que l’action prime sur le discours. « Au cinéma, c’est ça l’affaire, on veut pas le savouère, on veut le vouère! », renchérit Marie-Sissi Labrèche.
Pour ce qui est de la fameuse affirmation qui soutient que le livre est meilleur que le film, les auteurs-scénaristes interrogés nuancent en évoquant le caractère différent des deux médias. L’auteur Jean-Simon DesRochers, qui vient de scénariser le film Ville-Marie (2015) et qui est en train d’en faire de même avec La canicule des pauvres, son propre roman, croit plutôt qu’il est inutile de les comparer, puisque chacun exprime les choses à sa manière : « Tout peut être dit ou révélé, il suffit de trouver la manière, l’angle, la forme. Ce n’est qu’une question de code. Rien ne résiste au texte. Rien ne résiste à l’image. Et c’est parfait ainsi. »
Mais tous sont d’avis que le roman en dit plus que le résultat cinématographique. « On est condamné à être déçu par le film, même si celui-ci est très bon, dit Senécal. Quand on a aimé un roman, nous nous sommes construit nos propres images à partir des pages et des mots, nous avons créé notre film personnel. Trois cents personnes qui lisent un roman imaginent trois cents films différents, ce qui est la grande force du roman : l’évocation. » Comme l’auteur de romans est seul dans la partie, il peut aller sans compromis au bout de ses visées. La littérature permet cette liberté à e autre pareille. « Sans parler que la littérature saura toujours nous faire vivre des expériences uniques, très intérieures, très intimes. Sans parler que la littérature dépasse amplement les frontières du récit : vous iriez voir l’adaptation cinématographique d’un livre de poésie? (Quoique ça donnerait peut-être des propositions intéressantes!) », conclut DesRochers. L’idée est lancée!