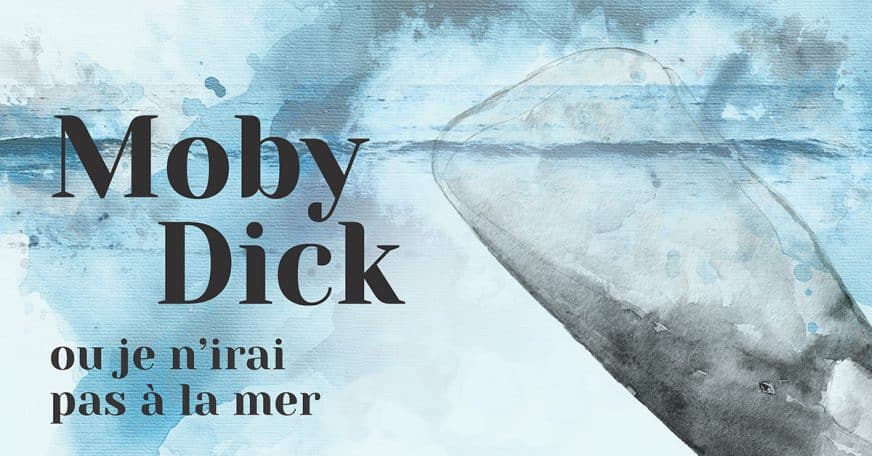Tout d’abord, les présentations. Julio Cortázar est né à Ixelles, en 1914. Bien qu’il ait vu le jour en terres belges parce que son paternel y travaillait pour une délégation diplomatique, sa famille retourne en Argentine quand le petit Julio n’a que 4 ans. De santé fragile, l’enfant puise l’aventure dans les livres en dévorant tous les Jules Verne de la bibliothèque de sa mère. Cela n’est sûrement pas étranger au fait qu’il choisira les lettres et la philosophie comme champ d’études.
Ce qui pousse Julio Cortázar à se dédier à l’écriture, c’est la découverte du surréalisme par la lecture d’Opium (Stock), de Jean Cocteau. Ne prenons, à titre d’exemple, que cet extrait et nous comprendrons: «Plus on est avide, plus il est indispensable de reculer coûte que coûte les bornes du merveilleux». C’est d’ailleurs ce merveilleux qui donne de la force à l’univers cortázien. Le reste relève du mystère. Certains appellent ça le génie.
Avec Cortázar, on accepte volontiers les mondes souterrains, parallèles, ceux qui se trouvent dans l’intervalle. Il révèle ce fabuleux principe d’incertitude qui voue toute précision à être inexacte. Fabuleuse incertitude, oui, car l’improbable comporte beaucoup plus de possibles que le factuel figé. L’esprit est une fenêtre et non un espace clos. Cortázar me donne envie de m’abandonner au bonheur inouï de m’inventer, de me «désencarcaner» l’esprit des lieux communs pour laisser paraître d’autres visions. Cortázar s’«applique» à créer du désordre et m’invite à faire vœu de liberté.
Dans un de ses contes, «quelque chose» d’invisible et d’innommable prend peu à peu plus d’espace dans ma propre demeure, d’où je finis par être chassée. Et grandit en moi ce sentiment d’étrangeté que l’on ressent quand quelque chose agit en soi, presque contre – ou au-delà de – sa volonté.
Dans une nouvelle, un homme est littéralement gobé par une photo sur un mur et se retrouve prisonnier de celle-ci, l’auteur faisant croire que ce qui semble n’est pas ce qui est. «De toute façon, si l’on sait se méfier des erreurs du regard, regarder devient chose possible; […] savoir dépouiller les choses de tous ces vêtements étrangers.»
Pendant qu’une femme sert le thé à ses convives, elle vit simultanément une autre vie, dans une autre ville où elle souffre, tendant au lecteur le miroir qui lui permettra de voir tous les masques successifs qu’il porte.
«Et après avoir fait tout ce qu’ils font, ils se lèvent, se baignent, se talquent, se parfument, se coiffent, s’habillent, et ainsi, progressivement, redeviennent ce qu’ils ne sont pas.» Et vlan! Voilà le lecteur pris en flagrant délit d’infidélité envers lui-même! Eh oui, avec Cortázar, on en prend parfois aussi sur la gueule.
Cortázar lui-même disait: «Si soudain je disparais au beau milieu d’une phrase, je ne serais pas vraiment surpris.» Il est bien conscient que tout est possible et qu’un mot peut tout avaler. Rêve, réalité, imagination cohabitent également, affectueusement pourrais-je dire. En témoigne Marelle (Gallimard), le roman aux rêves fous, où toute la force et la tragédie d’une jeunesse qui cherche à subjuguer le réel sont mises en scène: «L’absurde c’est de trouver devant ta porte le matin la bouteille de lait et ça te laisse froid parce que tu en as déjà trouvé une hier et que tu en trouveras une autre demain. C’est ce croupissement, le c’est ainsi, la douteuse carence d’exceptions. Je ne sais pas, il faudrait essayer un autre chemin.» Dans ce roman, c’est tout le jeu de la vie qui se retrouve dans la poésie, le jazz, l’amour et l’amitié.
Je dois justement ma première lecture de Cortázar à une grande amie qui faisait un séjour en Argentine. Me transmettant sa découverte, elle ne m’a pas simplement refilé «une belle suggestion de lecture», elle m’a ouvert à un monde magique, perpétuel, surnaturel, mais humain, riche et infini comme le sont l’amitié et les œoeuvres d’exception.
Marelle, Gallimard, 602 p. | 23,50$
Crépuscule d’automne, Corti, 346 p. | 42,95$