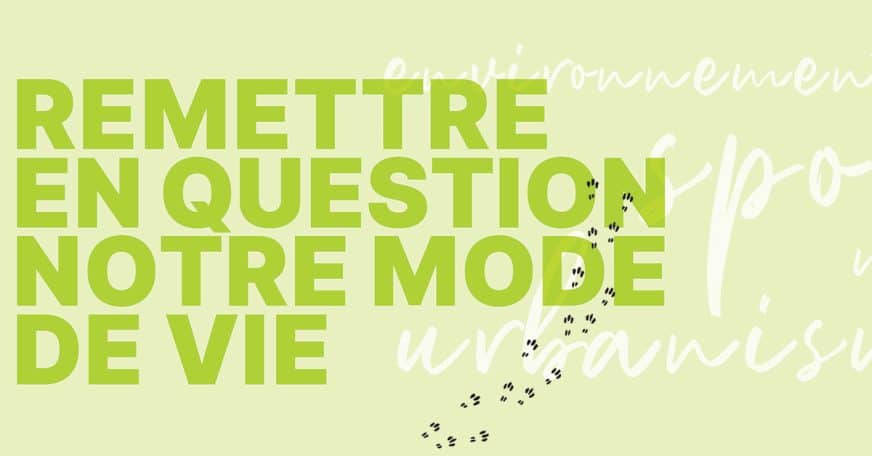La barbarie, nous tenons plus que jamais à ce qu’elle soit enchaînée sur les rives d’un monde lointain. Les actes des Américains à l’étranger, nos actes mêmes pour ainsi dire, il est en effet moins que jamais permis de les remettre en cause. Surena Thobani, professeure en études féministes de l’Université de Colombie britannique, l’a appris à ses dépens. Le 1er octobre, cette ancienne présidente du Comité d’action national sur le statut de la femme s’est fait rabrouer d’un océan à l’autre, y compris au Parlement, parce qu’elle a osé déclaré une évidence fort documentée lors d’une conférence à Ottawa: « Du Chili au Salvador, au Nicaragua et à l’Irak, la piste suivie par la politique étrangère [américaine] est maculée de sang ». Or si tant est que l’on tient, avec la political correctness à affirmer que « nous sommes américains », pareils propos apparaissent bien sûr insoutenables, parce qu’ils renvoient soudain à notre bonne société une image d’elle-même violemment niée. Car si la barbarie, c’est avant tout l’horreur de l’autre et l’amour narcissique de soi, comment peut-on soudain permettre, surtout en temps de guerre, qu’une partie de cette identité idéalisée soit niée ?
Nous ne pouvons nous trouver en situation d’être barbares puisque « nous sommes tous américains ». Alors tout est bon pour établir la valeur des civilisés que nous sommes. Les jours de prières, les forces militaires auxquelles nous prêtons notre concours ne bombardent pas l’Afghanistan. Elles prennent aussi grand soin de ne par larguer de bombes sans larguer aussi plusieurs rations alimentaires. Et Donald Rumsfeld, secrétaire à la « défense », s’excuse même à l’avance des morts civiles qu’ils « pourraient causer » avec ces bombardements massifs. Vous voyez ? L’honneur de la civilisation est parfaitement sauf.
Sur le sol afghan, le grondement des explosions, les cyclones de feux, les sifflements de la mitraille, les bruits sourds et terribles provoquent tout de même ce que Clausewitz, le grand théoricien de la guerre, a résumé en une sensation: la « chamade infernale ». Un témoin de la première semaine de bombardement : « Les explosions étaient si grandes et si massives que cela ressemblait à un tremblement de terre, à une bombe atomique larguée sur Kaboul. » (National Post, 12-10-01) Et que fait l’ONU, instance supposée voir au règlement juridique de pareilles questions ? Elle se révèle impuissante, encore une fois. Ce qui ne l’empêche pas de recevoir, au moment même où sa déficience apparaît encore une fois flagrante, le prix Nobel de la Paix ! Ce prix, on s’en souviendra, avait déjà couronné en 1973 Henry Kissinger, l’ancien secrétaire d’État américain dont on connaît désormais le culte qu’il voue à la guerre et son importance dans la poursuite et le développement de conflits, tant au Vietnam, au Laos, au Cambodge, qu’au Chili, en Uruguay, en Argentine ainsi que dans plusieurs autres pays.
Peut-on aujourd’hui mettre en cause la politique étrangère américaine ? Guerre oblige, toutes discussions de ce type semblent bannies de la place publique. Dans la plupart des quotidiens canadiens, même les militants « anti-mondialisation » passent désormais pour rien de moins que des supporters du terrorisme international. William « Pit Bull » Johnson est loin d’être seul, hélas, à aller jusqu’à décrire l’inoffensive Naomi Klein, auteur de No Logo, comme pervertie par la culture même de ceux que l’on doit combattre aujourd’hui au nom même de la Civilisation (Globe & Mail 11-10-01). Cela est presque devenu monnaie courante. Ne pourrait-on pas aussi dire, en si bon chemin, que les José Bové, René Riesel et autres critiques de la mondialisation sont carrément des criminels ?
Dans pareille situation, qui peut s’étonner qu’un émir arabe qui offre 10 millions de dollars aux victimes de la tragédie du 11 septembre tout en regrettant certains aspects de la politique étrangère américaine puisse être rabroué par le maire de New York ? Pour le bon maire Giuliani, la critique de l’émir « fait partie du problème ». La solution ? Le président Bush l’a exprimée lui-même tout de suite après la tragédie : la consommation. « Allez magasiner », a-t-il dit, tout en indiquant qu’il s’occuperait pour sa part de bombarder.
Le plus dégueulasse, quoi qu’on en dise, ce n’est jamais la guerre. La guerre est ce qu’elle doit être. Un fléau. Non, le plus dégueulasse, c’est le discours sur l’horreur tenu par des gens pour qui la guerre et l’humanité ne sont que pure conversation. Cela donne par exemple de petites phrases terribles et sanglantes comme celle que publiait dans Le Devoir du 15 septembre Jocelyn Létourneau, un distingué professeur de l’Université Laval, parlant de haut lui aussi d’une lutte de la « civilisation » contre la « barbarie » tout en laissant filer ceci : « Désormais, un rat doit être appelé un rat, reconnu comme tel et distingué des autres espèces ». Car voyez-vous, selon ce monsieur comme pour le bon maire Giuliani, il ne faudrait pas chercher à comprendre la haine qui éclabousse plus que jamais le monde puisque ce serait « ouvrir le chemin à l’éventuelle justification, voire à l’atténuation et à l’excuse de l’insensé. » En d’autres termes, il faudrait foncer tête baissée sur les « barbares », comme le fait l’armée américaine, sans se poser de questions sur la course du monde tel qu’il va. Pour un professeur, réclamer ainsi une condamnation tout azimut plutôt qu’un effort de compréhension de la complexité de notre monde, c’est une démission intellectuelle pour le moins inattendue. Il devrait pourtant être encore possible de dire l’horreur de toutes les violences.
Nous entrons dans une période au sens moral pervers où la terreur semble vouloir prendre racine en lieu et place de toute politique internationale. Et en un temps pareil, la démission intellectuelle, tout comme la guerre, ne peut correspondre qu’à un très grave fléau.