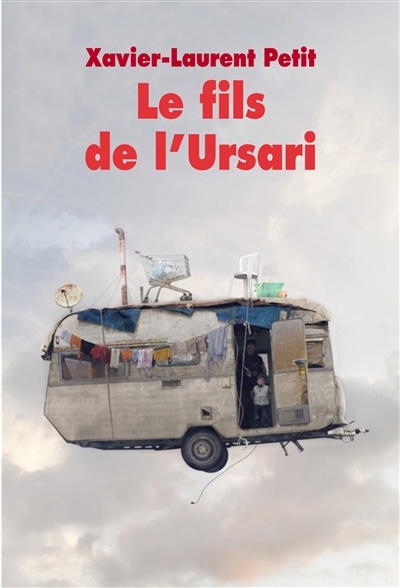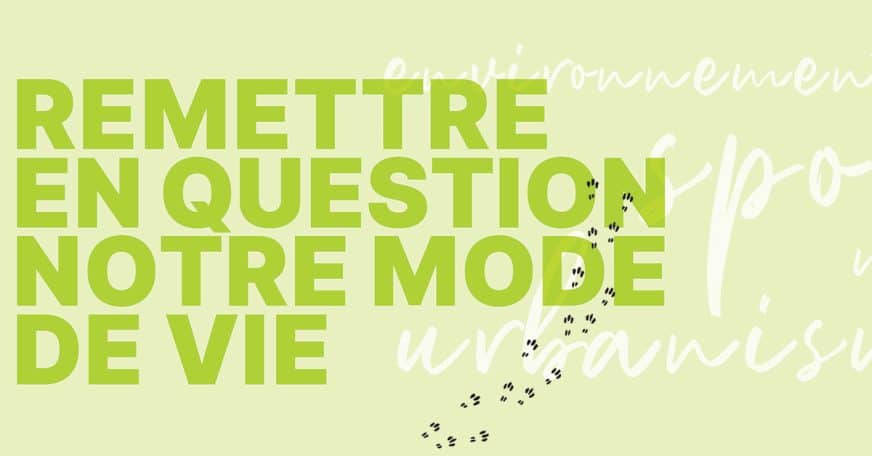Le récent bombardement de témoignages portant le mot-clic « agressionnondénoncée » devrait à lui seul faire la preuve que la lutte des femmes n’est pas résolue. Repoussant la destruction, c’est par la création que certaines femmes ont choisi de mener le combat pour se dire, se constituer et, avant tout, exister.
Exister sur papier
Dans l’introduction de son ouvrage De Marie de l’Incarnation à Nelly Arcan (Boréal), Patricia Smart raconte que, désirant d’abord faire un ouvrage sur l’autobiographie féminine au Québec des origines à nos jours, elle s’est trouvée devant un « territoire vaste, mais plutôt désert ». Entre la publication de l’autobiographie de Marie de l’Incarnation en 1654 et celle de Claire Martin en 1965-1966, pratiquement aucune femme ne s’est commise dans ce genre littéraire. Les rares femmes qu’elle a pu recenser lui ont livré leur âme au moyen de leur correspondance, leurs journaux intimes, leurs mémoires et des textes d’autofiction. Grâce à elles, l’histoire du Québec nous est révélée, de même que (et peut-être surtout) la place restreinte réservée à leur sexe. Qu’elles soient mystiques s’abandonnant dans la foi à Dieu, filles obéissantes, promises au mariage, épouses dévouées, amantes éperdues, mères résolues ou objets du désir des hommes, chacune de ces femmes laisse entrevoir le malaise de devoir s’effacer pour se mouler dans le rôle que lui attribue le fait biologique de n’être pas née homme. Consciemment ou non, la plupart d’entre elles arrivent cependant à se réapproprier un « je », un « moi », une âme, par l’écriture. Plutôt que d’aller piger dans les textes recensés des extraits qui pourraient simplement appuyer une ligne directrice prédéterminée, Patricia Smart met en lumière ces écrits et les laisse s’exprimer. À travers eux, c’est la voix de ces femmes que nous brûlons, nous aussi, de connaître davantage.
Exister en images
Comme pour l’autobiographie, le cinéma est un territoire où les femmes ne sont pas légion. Avec 40 ans de vues rêvées, le collectif Réalisatrices équitables et la maison d’édition Somme toute font un devoir de mémoire envers toutes ces cinéastes qui ont tracé les routes du 7e art québécois au féminin et qui continuent à le faire. Par le truchement d’une soixantaine de portraits, on rencontre des femmes à la feuille de route impressionnante (Mireille Dansereau, Anne-Claire Poirier) ou récemment entamée (Chloé Robichaud, Anne Émond) et à l’imaginaire différent. La plupart parlent de la difficulté de trouver le financement pour leurs films. Certaines lancent l’hypothèse que cela est dû à une certaine peur du milieu relativement à des thématiques féminines qui traitent de l’intime et qui sont, aux yeux de l’industrie, moins « grand public » ou populaires. Plusieurs s’ouvrent sur tous les rôles qu’elles ont dû exercer avant qu’on leur fasse enfin confiance pour tenir les rênes d’un projet. Certaines, de guerre lasse, se sont tournées vers d’autres formes d’art pour s’accomplir librement. Mais il est un point sur lequel toutes ces femmes s’accordent : le désir et le besoin de la création, l’envie pressante de s’exprimer par les images. À lui seul, cet argument justifie largement l’existence de cet ouvrage!
Exister par les racines
L’urgence de s’exprimer est aussi au cœur du dernier roman de Nancy Huston, Bad Girl : classes de littérature (Actes Sud). Par l’entremise du personnage de Dorrit, son alter ego, l’auteure retrace son parcours de vie. Elle s’ouvre sur différents traumatismes, dont celui d’être le fruit d’une grossesse non désirée, qui l’ont amenée à l’écriture. En remontant son arbre généalogique jusqu’à ses arrière-grands-parents, l’auteure démontre, par une forme de suite logique, comment certaines fondations de notre individu sont déjà posées avant même notre naissance. Ainsi, la petite Nancy/Dorrit apprendra très tôt à lire et à écrire et trouvera dans les livres des amis pour combler l’absence de ses parents. Pour racheter le déficit d’attention dont souffre son père, elle voudra passer de longues heures à se concentrer et à rédiger. Pour garder un contact avec sa mère vivant au loin, elle composera de longues lettres, puis, pour s’en détacher, elle délaissera sa langue maternelle. Généralement, elle s’expliquera les gens qui l’entourent en en faisant des personnages. Mais, plus que tout, la création littéraire sera une planche de salut pour échapper à la tyrannie du corps et de l’image qui accompagne le fait d’être née femme.
Exister à en crier
Caitlin Moran en connaît un rayon sur la tyrannie des apparences inhérente à la gent féminine. Taxée de « garçon manqué », traînant ses rondeurs dans les rues de son Wolverhampton natal, elle apprend très tôt à compter sur son intelligence et sa verve pour évoluer dans la vie. Dès la puberté, elle se tourne vers les grands écrits féministes pour se comprendre, s’expliquer et se construire. Avec son jubilatoire Comment peut-on (encore) être une femme? (Flammarion), elle invente manifestement un nouveau style : le féminisme « gonzo ». Préférant se réapproprier le terme plutôt que de laisser d’autres en faire une utilisation négative, elle se proclame « féministe enragée » et décortique, par des anecdotes autobiographiques, quelques-unes des étapes constituantes de la vie de femme. Sans souci d’objectivité et avec un franc-parler déconcertant, celle qui a remporté le British Press Award pour ses éditoriaux dans le Times disserte avec la même ferveur de masturbation, d’avortement, de la tonte des poils pubiens ou des bars de danseuses. On ne saurait assez louer l’esprit et l’humour qui animent Caitlin Moran, on ne saurait assez souhaiter que ce livre soit lu par toutes les jeunes filles et une bonne partie des hommes afin que l’on puisse tous ensemble et sans peur monter sur une chaise et déclarer haut et fort « Je suis féministe »!