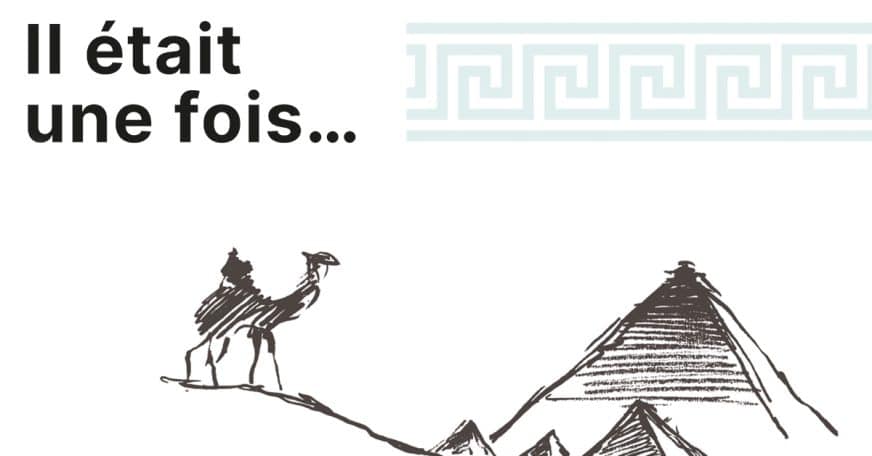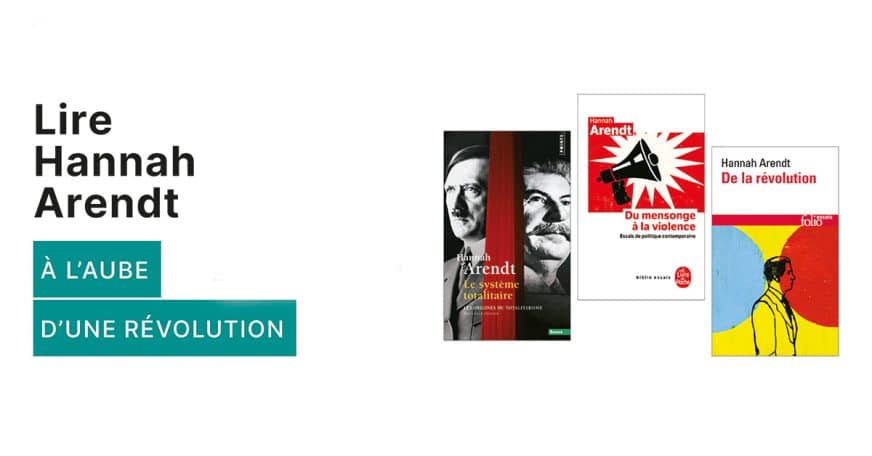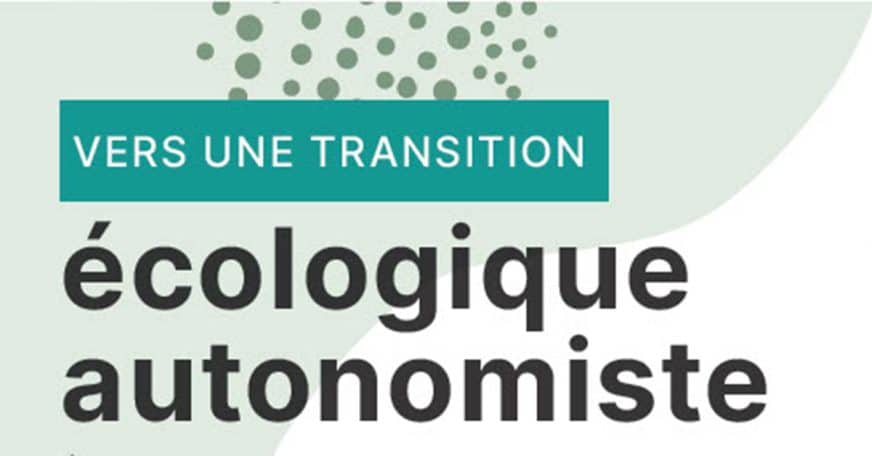Désacraliser la violence
Dans un dialogue avec Benoit Chantre autour du De la guerre de Clausewitz, René Girard revisite ses théories développées au fil d’une œuvre qui a l’originalité de lier anthropologie, philosophie, religion, histoire et littérature.
Quelques mots d’abord sur le principe mimétique, au centre de sa vision et qui est une «imitation du modèle qui devient imitateur à son tour et entraîne un conflit redoublé de deux rivaux […] qui fait se ressembler de plus en plus les adversaires». En d’autres mots, c’est la guerre, la violence sacrée, à la base de toutes les civilisations humaines archaïques et modernes et qui s’exprime sous diverses formes par le sacrifice d’une victime émissaire, à la fois coupable du désordre et restauratrice de l’ordre, sacrifice qui permet aux communautés humaines de ne pas s’autodétruire, la violence étant détournée sur une victime désignée. Ce qu’apporte le christianisme, c’est la révélation que les victimes sont toujours innocentes et que Dieu est à leur côté. Avec la Passion, Jésus se place au centre même de la mécanique sacrificielle et en éclaire tous les rouages: il défait le sacré en en révélant la violence. Il faut renoncer au mimétisme pour qu’arrête de se déchaîner la spirale de la violence et ainsi en finir avec l’inhumanité de l’humain.
À l’intérieur même de la Bible figure un texte plus intuitif que prophétique, Girard expliquant que «le christianisme est la seule religion qui aura prévu son propre échec. Cette prescience s’appelle l’apocalypse». Les textes apocalyptiques imaginent ce qu’il adviendra de l’humain si l’homme ne met pas un terme à la violence sacrée; ce sera la guerre non de Dieu contre les hommes, mais la guerre totale entre les hommes. Le Royaume entrevu est hors de notre portée, mais «la dévastation n’est que de notre côté». Et Clausewitz? Cette «montée aux extrêmes», il en a eu l’intuition lorsque dans la première partie de son œuvre séminale sur l’art guerrier, il souleva le voile de la logique exterminatrice et de l’avènement de la guerre totale. De la Révolution française (première guerre citoyenne) et Waterloo en 1815 sortiront le ressentiment et la violence mimétique, exponentielle, accélérant la montée aux extrêmes: 1870, 1914-18, 1939-45, pour en arriver au terrorisme religieux côtoyant la guerre classique, violences additionnées de l’inhumanité triomphante dans laquelle l’humain a de plus en plus l’intuition qu’il se dirige vers une impasse.
Patrouilles perdues
«Je veux seulement que demeure la trace de mes pas […]. Elle sera bien utile à ceux qui ne viendront pas après nous. Rappelez-vous, mon Maître: l’humanité est une patrouille perdue.
— Est-il vraiment trop tard? Ne peut-elle rebrousser chemin?
— Non, on lui tire dans le dos.
— Comme c’est affligeant, une si vieille personne.»
Tulipe, Romain Gary
Cette intuition est au cœur de l’œuvre entière de Romain Gary. L’on croirait qu’il est inutile de présenter l’inventeur d’Émile Ajar, mais il y a pourtant dans l’œuvre foisonnante de cet écrivain tout un pan méconnu qui allait à contre-courant de son époque et qui, enfin, peu à peu remonte à la surface. De Tulipe à La Danse de Gengis Cohn, Gary utilise un humour rageur aux accents prophétiques pour dénoncer la mainmise des idéologies sur l’humain. Alors que la guerre fait rage et que Gary aviateur bombarde les pays occupés dans ce qu’on a appelé «la guerre juste», il pose dès ses premiers livres une question dont la formulation et le sens sont immédiatement occultés: «L’homme est-il allemand?» Gary avait envoyé à Louis Jouvet dès 1946 une adaptation théâtrale de Tulipe, texte plus près de la fable que du roman, échec commercial et critique lors de sa parution et même ensuite. C’est ce texte qui paraît aujourd’hui.
En 1946, paria tout juste sorti de Buchenwald, Tulipe part pour New York, monte une escroquerie spirituelle en devenant le «blanc Mahatma de Harlem» et fonde l’association Pitié pour les vainqueurs car, dit-il, «lorsqu’une guerre est gagnée, ce sont les vaincus qui sont libérés, pas les vainqueurs». Dans un accès de ferveur prophétique, il regarde dans une boule de cristal: «Je vois celui qui mourra sur la croix et celui qui, parti d’Espagne, découvrira un monde nouveau…» Son associé dans la supercherie lui soulignant qu’il regarde dans le mauvais sens, il regarde de nouveau: «Je ne vois rien. Un grand rien […] Je vois de la cendre partout.»
La Route de McCarthy: de la cendre partout, un homme seul avec son jeune fils, et rien. Que le vent, plus d’oiseaux, la mer est grise et vide. Aucune suite à donner à l’histoire, car quel sens donner à la vie si la mémoire ne sert plus qu’à transmettre les souvenirs d’un monde à jamais disparu? Il ne s’agit pas de science-fiction et aucune explication n’est donnée. Que quelques souvenirs, rêves qui reviennent hanter l’homme. Il n’a pas de nom, il est «l’homme» et son fils, «le petit». Le décor: brûlé, gris et noir, le froid, la faim, l’errance. Et le danger. Car les quelques hommes qui continuent d’errer, que sont-ils devenus après la fin de l’histoire?
C’est dans un style totalement dépourvu d’effets, avec des phrases qui collent aux gestes de l’homme et du fils jusqu’à nous communiquer la fatigue, la faim et la peur que Cormac McCarthy a écrit ce chef-d’œuvre. Le lien avec Gary? L’homme et son fils rencontrent un vieillard sans âge sur la route. Écoutez comme il parle, comme un écho direct à Tulipe et à la trace des pas qui seront utiles à «ceux qui ne viendront pas après nous»: «Les choses iront mieux lorsqu’il n’y aura plus personne […]. On se sentira tous mieux. On respirera plus facilement.»
Pourquoi continuer d’avancer comme une patrouille perdue? Parce que l’homme a «charge d’âme». Il a un fils, qui n’a jamais connu le monde d’avant. Et parce qu’il faut à tout prix ne pas abandonner le fils, malgré la tentation toujours présente de l’impossible et ultime acte protecteur. Le fils ayant offert de la nourriture au vieillard, ce dernier dit à l’homme:
«Peut-être qu’il croit en Dieu.»
L’homme: «Je ne sais pas en quoi il croit.»
Le vieillard: «Ça lui passera.»
L’homme: «Non. Sûrement pas.»
La Route est un récit d’une force peu commune, faisant surgir en quelques mots une émotion violente qui laisse passer, en plein milieu de l’apocalypse et du désespoir, un minuscule «peut-être». C’est ce «peut-être» qui lie Girard, Gary et McCarthy.
Bibliographie :
Achever Clausewitz, René Girard et Benoit Chantre, Carnets Nord, 368 p., 45,95$
Tulipe ou La Protestation, Romain Gary, Gallimard, coll. Le manteau d’Arlequin, 80 p., 17,95$
La Route, Cormac McCarthy, De l’Olivier, 256 p., 29,95$