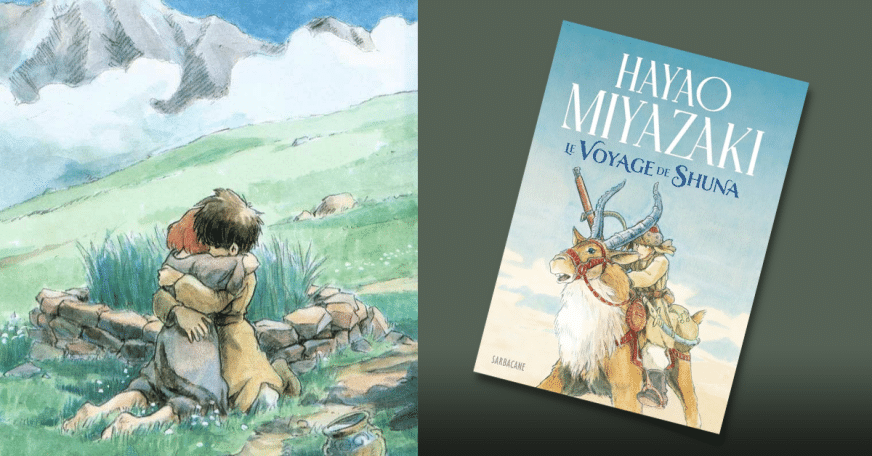Sur le plan historique, la bande dessinée (tebeo) espagnole est une des plus riches. D’abord utilisée comme outil de propagande pour les partis de gauche pendant la Guerre Civile et sous la dictature de Franco, elle s’illustre sur le plan mondial, à partir des années 70, comme l’une des premières à s’adresser directement aux adultes, et non seulement aux enfants, petits et grands. Des années 60 aux années 80, des auteurs et dessinateurs audacieux s’inspirant grandement du surréalisme de Dalí ou de Buñuel ont contribué à en faire une des formes du neuvième art les plus foisonnantes d’Europe. Puis, presque noyée sous les vagues déferlantes du manga japonais et du comic à l’américaine, elle refait aujourd’hui surface dans les œuvres d’auteurs dont le talent de conteur n’a d’égal que leur style unique. Je vous propose un panorama de quelques-uns de ces bédéistes qui ont su tirer profit de l’expérience de leurs prédécesseurs tout comme de leurs envahisseurs.
La série «En sautant dans le vide» nous raconte l’histoire de trois adolescents adeptes de parkour: une course à obstacles qui remplace les haies par des éléments urbains préexistants. Ce sport extrême exige de la rigueur et de l’audace, qualités dont Luna, Edu et Raul font preuve dans l’exercice de leur passion… mais très peu dans leurs vies personnelles. Avec comme toile de fond un quartier populaire d’une Barcelone grouillante et rongée de l’intérieur par les petits criminels, nos trois protagonistes se retrouvent pris dans un triangle amoureux et impliqués à leur insu dans les manigances d’un «Roi de la rue» aux tendances psychopathes. Man, l’auteur, arrive à rendre chacun des tomes essentiels au développement de l’histoire. Le scénario et surtout le visuel sont indéniablement influencés par le manga, le premier servant de prétexte au second. Par ses personnages, qui possèdent tous une part d’ombre qui les rend intéressants, mais aussi par sa maîtrise de la case ― l’usage particulier qu’il en fait et ses couleurs toutes en nuances ―, Man arrive à ressortir du lot.
Parrainés dès leurs débuts par des bédéistes hispaniques de renom tels que Morvan, Miralles et Munuera, Raul et Roger nous donnent, avec «Jazz Maynard», une trilogie barcelonaise ayant pour théâtre le quartier pourri d’El Raval. Collectionneur de crimes et délits, Jazz Maynard décide soudainement de quitter son quartier natal et ses mauvaises fréquentations pour les États-Unis, où il gagne sa vie comme trompettiste. Dix ans plus tard, il doit retourner au bercail pour y ramener sa sœur, qu’il a tirée des griffes d’un réseau de prostitution. Sitôt revenu, il retrouve un vieil ami… et un vieil ennemi qui souhaite utiliser ses talents pour perpétrer le vol du siècle, sans quoi, il tuera sa sœur. Même si on a vu mille fois cette histoire de criminel repenti qui doit commettre un dernier coup, les procédés narratifs qui nous y mènent sont si parfaitement utilisés et maîtrisés par les deux auteurs que le résultat semble tout nouveau. Caractérisé par un rendu monochrome (tout entier dans un camaïeu de sépia) plutôt qu’un foisonnement de couleurs, les illustrations donnent une certaine sobriété au récit, un certain classicisme qui sied bien à la musique jazz. Le trait, un dérivé texturé de la ligne claire, donne aux personnages des visages à la fois caricaturaux et d’une beauté presque idéale.
Dans la même veine que «Jazz Maynard», mais repoussant plus loin encore les limites, nous est proposée la série «Ken Games», trilogie (pas encore complétée) dont chacun des tomes se consacre à un des différents personnages qu’il met en scène, c’est-à-dire deux amis, Pierre et TJ ainsi que Anne, la petite amie du dernier. Chacun d’eux a un secret qu’il cache aux deux autres: ainsi, Pierre prétend poursuivre ses études de doctorat en mathématiques alors qu’il a abandonné pour se consacrer à la boxe; TJ prétend travailler dans une banque alors qu’il est joueur de poker professionnel et Anne prétend être enseignante au primaire à TJ et serveuse à Pierre, mais aucun des deux ne pourrait soupçonner son réel métier… Robledo et Toledano s’illustrent ici comme le duo infernal de la bande dessinée. Il est rare de trouver de tels bijoux d’albums, qui ne délaissent ni le suspense ni la profondeur des personnages et dont chacune des cases, sans exception, semble avoir été longuement pensée et retravaillée. Les innovations graphiques des illustrations sont surprenantes et semblent inventer une nouvelle dimension (la 2e ½, peut-être?).
Finalement, pour terminer ce panorama, le dernier, mais non le moindre, qui réinvente la bande dessinée à sa façon bien à lui: Enrique Fernandez. Il s’était d’abord fait remarquer avec son adaptation très imaginative du Magicien d’Oz. À la fois à la barre du scénario, des dessins et de la couleur, il prouve, avec La mère des Victoires, toute l’étendue de son talent et de son génie. Dans un monde où la guerre en cours est devenue le principal show de téléréalité commenté de la même manière que le patinage artistique, le lieutenant Kataoka se bat pour avoir le commandement d’une machine de guerre appelée la Mère des Victoires à la place du fils de la femme qu’il aime. Dans ces prémices seulement, on sent le potentiel d’aventure et d’émotions de cette histoire classiquement, mais admirablement racontée. Quant aux illustrations, elles sont la quintessence du mouvement, de la lumière et de l’imagination en 2D; le fait que l’auteur provienne du cinéma d’animation y est sans doute pour quelque chose. Si les bédéistes espagnols des années à venir n’ont ne serait-ce que la moitié du talent de Fernandez, nous n’aurons plus qu’à nous incliner devant leur grandeur.
Bibliographie :
Home Sweet Home. Jazz Maynard (t. 1), Raule et Roger, Dargaud, 48 p. | 23,95$
Feuille. Ken Games (t. 2), Robledo et Toledano, Dargaud, 48 p. | 23,95$
Le dernier pas. En sautant dans le vide (t. 5), Man, Dargaud, 64 p. | 22,95$
La mère des victoires, Enrique Fernandez, Delcourt, 64 p. | 24,95$